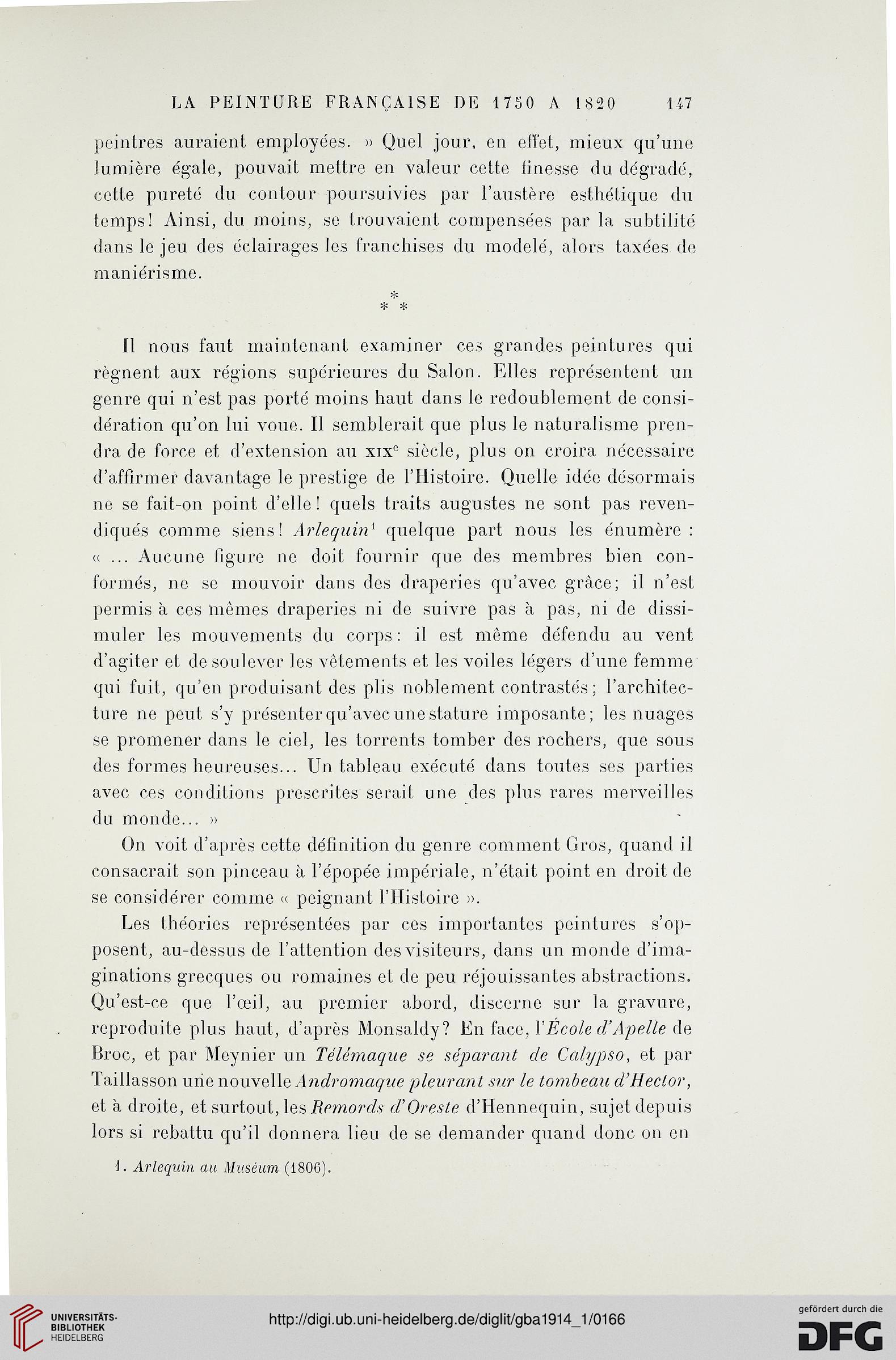LA PEINTURE FRANÇAISE DE 1750 A 1820
U1
peintres auraient employées. » Quel jour, en effet, mieux qu’une
lumière égale, pouvait mettre en valeur cette linesse du dégradé,
cette pureté du contour poursuivies par l’austère esthétique du
temps! Ainsi, du moins, se trouvaient compensées par la subtilité
dans le jeu des éclairages les franchises du modelé, alors taxées de
maniérisme.
*
❖ ❖
Il nous faut maintenant examiner ce.s grandes peintures qui
régnent aux régions supérieures du Salon. Elles représentent un
genre qui n’est pas porté moins haut dans le redoublement de consi-
dération qu’on lui voue. Il semblerait que plus le naturalisme pren-
dra de force et d’extension au xixe siècle, plus on croira nécessaire
d’affirmer davantage le prestige de l’Histoire. Quelle idée désormais
ne se fait-on point d’elle ! quels traits augustes ne sont pas reven-
diqués comme siens! Arlequin1 quelque part nous les énumère:
<( ... Aucune figure ne doit fournir que des membres bien con-
formés, ne se mouvoir dans des draperies qu’avec grâce; il n’est
permis à ces mêmes draperies ni de suivre pas à pas, ni de dissi-
muler les mouvements du corps : il est même défendu au vent
d’agiter et de soulever les vêtements et les voiles légers d’une femme
qui fuit, qu’en produisant des plis noblement contrastés ; l’architec-
ture ne peut s’y présenter qu’avec une stature imposante; les nuages
se promener dans le ciel, les torrents tomber des rochers, que sous
des formes heureuses... Un tableau exécuté dans toutes ses parties
avec ces conditions prescrites serait une des plus rares merveilles
du monde... »
On voit d’après cette définition du genre comment Gros, quand il
consacrait son pinceau à l’épopée impériale, n’était point en droit de
se considérer comme « peignant l’Histoire ».
Les théories représentées par ces importantes peintures s’op-
posent, au-dessus de l’attention des visiteurs, dans un monde d’ima-
ginations grecques ou romaines et de peu réjouissantes abstractions.
Qu’est-ce que l’œil, au premier abord, discerne sur la gravure,
reproduite plus haut, d’après Monsaldy? En face, Y École d’Apelle de
Broc, et par Meynier un Télémaque se séparant de Calypso, et par
Taillasson une nouvelle Andromaque pleurant sur le tombeau d'Hector,
et à droite, et surtout, les Remords d'Oreste d’Hennequin, sujet depuis
lors si rebattu qu’il donnera lieu de se demander quand donc on en
■J. Arlequin au Muséum (1806).
U1
peintres auraient employées. » Quel jour, en effet, mieux qu’une
lumière égale, pouvait mettre en valeur cette linesse du dégradé,
cette pureté du contour poursuivies par l’austère esthétique du
temps! Ainsi, du moins, se trouvaient compensées par la subtilité
dans le jeu des éclairages les franchises du modelé, alors taxées de
maniérisme.
*
❖ ❖
Il nous faut maintenant examiner ce.s grandes peintures qui
régnent aux régions supérieures du Salon. Elles représentent un
genre qui n’est pas porté moins haut dans le redoublement de consi-
dération qu’on lui voue. Il semblerait que plus le naturalisme pren-
dra de force et d’extension au xixe siècle, plus on croira nécessaire
d’affirmer davantage le prestige de l’Histoire. Quelle idée désormais
ne se fait-on point d’elle ! quels traits augustes ne sont pas reven-
diqués comme siens! Arlequin1 quelque part nous les énumère:
<( ... Aucune figure ne doit fournir que des membres bien con-
formés, ne se mouvoir dans des draperies qu’avec grâce; il n’est
permis à ces mêmes draperies ni de suivre pas à pas, ni de dissi-
muler les mouvements du corps : il est même défendu au vent
d’agiter et de soulever les vêtements et les voiles légers d’une femme
qui fuit, qu’en produisant des plis noblement contrastés ; l’architec-
ture ne peut s’y présenter qu’avec une stature imposante; les nuages
se promener dans le ciel, les torrents tomber des rochers, que sous
des formes heureuses... Un tableau exécuté dans toutes ses parties
avec ces conditions prescrites serait une des plus rares merveilles
du monde... »
On voit d’après cette définition du genre comment Gros, quand il
consacrait son pinceau à l’épopée impériale, n’était point en droit de
se considérer comme « peignant l’Histoire ».
Les théories représentées par ces importantes peintures s’op-
posent, au-dessus de l’attention des visiteurs, dans un monde d’ima-
ginations grecques ou romaines et de peu réjouissantes abstractions.
Qu’est-ce que l’œil, au premier abord, discerne sur la gravure,
reproduite plus haut, d’après Monsaldy? En face, Y École d’Apelle de
Broc, et par Meynier un Télémaque se séparant de Calypso, et par
Taillasson une nouvelle Andromaque pleurant sur le tombeau d'Hector,
et à droite, et surtout, les Remords d'Oreste d’Hennequin, sujet depuis
lors si rebattu qu’il donnera lieu de se demander quand donc on en
■J. Arlequin au Muséum (1806).