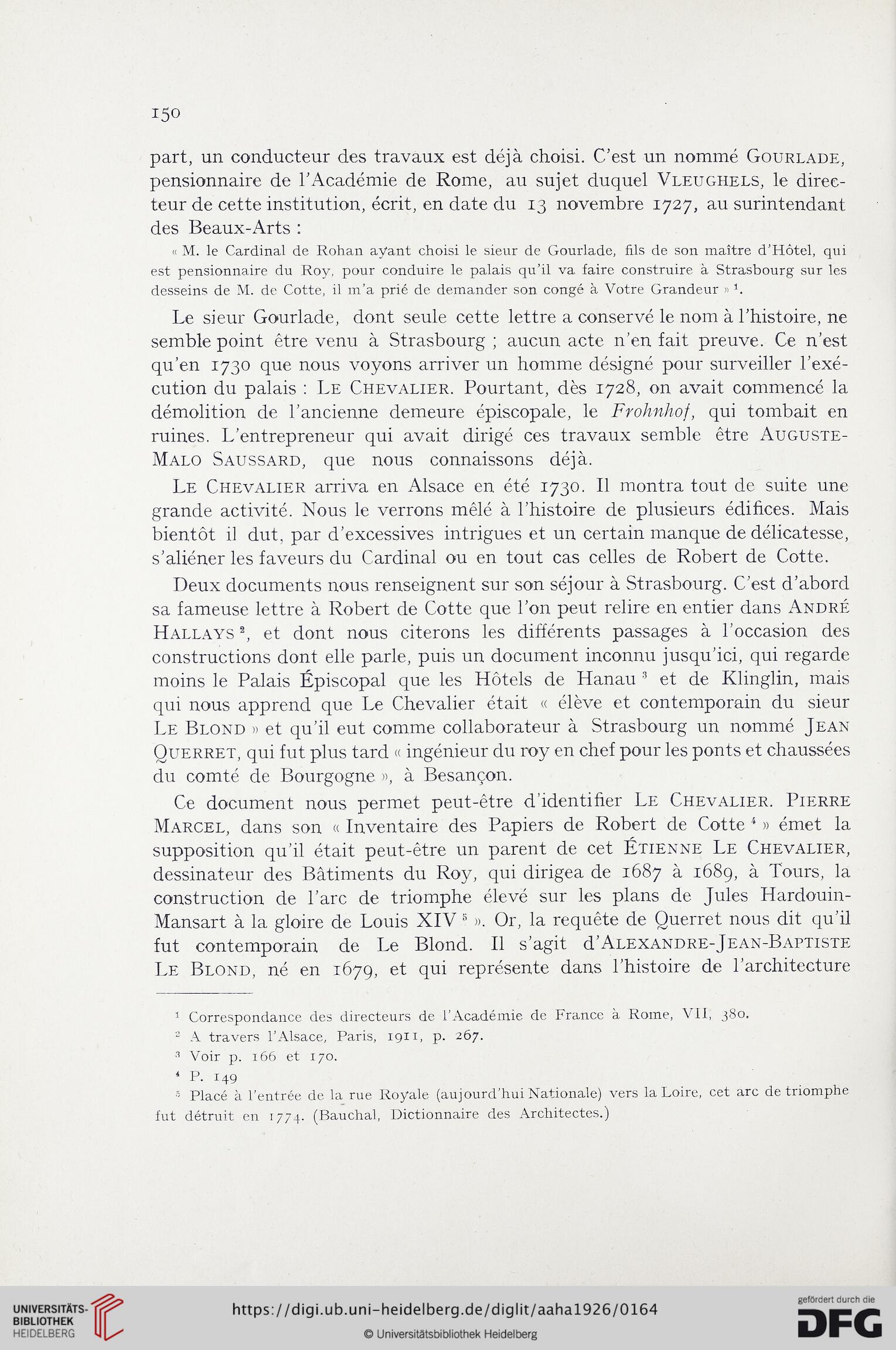i5o
part, un conducteur des travaux est déjà choisi. C'est un nommé Gourlade,
pensionnaire de F Académie de Rome, au sujet duquel Vleughels, le direc-
teur de cette institution, écrit, en date du 13 novembre 1727, au surintendant
des Beaux-Arts :
« M. le Cardinal de Rohan ayant choisi le sieur de Gourlade, fils de son maître d’Hôtel, qui
est pensionnaire du Roy, pour conduire le palais qu’il va faire construire à Strasbourg sur les
desseins de M. de Cotte, il m’a prié de demander son congé à Votre Grandeur »1.
Le sieur Gourlade, dont seule cette lettre a conservé le nom à l’histoire, ne
semble point être venu à Strasbourg ; aucun acte n’en fait preuve. Ce n’est
qu’en 1730 que nous voyons arriver un homme désigné pour surveiller l’exé-
cution du palais : Le Chevalier. Pourtant, dès 1728, on avait commencé la
démolition de l’ancienne demeure épiscopale, le Frohnhof, qui tombait en
ruines. L’entrepreneur qui avait dirigé ces travaux semble être Auguste-
Malo Saussard, que nous connaissons déjà.
Le Chevalier arriva en Alsace en été 1730. Il montra tout de suite une
grande activité. Nous le verrons mêlé à l’histoire de plusieurs édifices. Mais
bientôt il dut, par d’excessives intrigues et un certain manque de délicatesse,
s’aliéner les faveurs du Cardinal ou en tout cas celles de Robert de Cotte.
Deux documents nous renseignent sur son séjour à Strasbourg. C’est d’abord
sa fameuse lettre à Robert de Cotte que l’on peut relire en entier dans André
Hallays 2, et dont nous citerons les différents passages à l’occasion des
constructions dont elle parle, puis un document inconnu jusqu’ici, qui regarde
moins le Palais Épiscopal que les Hôtels de Hanau 3 et de Klinglin, mais
qui nous apprend que Le Chevalier était « élève et contemporain du sieur
Le Blond » et qu’il eut comme collaborateur à Strasbourg un nommé Jean
Querret, qui fut plus tard « ingénieur du roy en chef pour les ponts et chaussées
du comté de Bourgogne », à Besançon.
Ce document nous permet peut-être d’identifier Le Chevalier. Pierre
Marcel, dans son « Inventaire des Papiers de Robert de Cotte 4 » émet la
supposition qu’il était peut-être un parent de cet Étienne Le Chevalier,
dessinateur des Bâtiments du Roy, qui dirigea de 1687 à 1689, à Tours, la
construction de l’arc de triomphe élevé sur les plans de Jules Hardouin-
Mansart à la gloire de Louis XIV 5 ». Or, la requête de Querret nous dit qu’il
fut contemporain de Le Blond. Il s’agit d’Alexandre-Jean-Baptiste
Le Blond, né en 1679, et qui représente dans l’histoire de l’architecture
1 Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome, VII, 380.
2 A travers l’Alsace, Paris, 1911, p. 267.
3 Voir p. 166 et 170.
4 P- 149
5 Placé à l’entrée de la rue Royale (aujourd’hui Nationale) vers la Loire, cet arc de triomphe
fut détruit en 1774. (Bauchal, Dictionnaire des Architectes.)
part, un conducteur des travaux est déjà choisi. C'est un nommé Gourlade,
pensionnaire de F Académie de Rome, au sujet duquel Vleughels, le direc-
teur de cette institution, écrit, en date du 13 novembre 1727, au surintendant
des Beaux-Arts :
« M. le Cardinal de Rohan ayant choisi le sieur de Gourlade, fils de son maître d’Hôtel, qui
est pensionnaire du Roy, pour conduire le palais qu’il va faire construire à Strasbourg sur les
desseins de M. de Cotte, il m’a prié de demander son congé à Votre Grandeur »1.
Le sieur Gourlade, dont seule cette lettre a conservé le nom à l’histoire, ne
semble point être venu à Strasbourg ; aucun acte n’en fait preuve. Ce n’est
qu’en 1730 que nous voyons arriver un homme désigné pour surveiller l’exé-
cution du palais : Le Chevalier. Pourtant, dès 1728, on avait commencé la
démolition de l’ancienne demeure épiscopale, le Frohnhof, qui tombait en
ruines. L’entrepreneur qui avait dirigé ces travaux semble être Auguste-
Malo Saussard, que nous connaissons déjà.
Le Chevalier arriva en Alsace en été 1730. Il montra tout de suite une
grande activité. Nous le verrons mêlé à l’histoire de plusieurs édifices. Mais
bientôt il dut, par d’excessives intrigues et un certain manque de délicatesse,
s’aliéner les faveurs du Cardinal ou en tout cas celles de Robert de Cotte.
Deux documents nous renseignent sur son séjour à Strasbourg. C’est d’abord
sa fameuse lettre à Robert de Cotte que l’on peut relire en entier dans André
Hallays 2, et dont nous citerons les différents passages à l’occasion des
constructions dont elle parle, puis un document inconnu jusqu’ici, qui regarde
moins le Palais Épiscopal que les Hôtels de Hanau 3 et de Klinglin, mais
qui nous apprend que Le Chevalier était « élève et contemporain du sieur
Le Blond » et qu’il eut comme collaborateur à Strasbourg un nommé Jean
Querret, qui fut plus tard « ingénieur du roy en chef pour les ponts et chaussées
du comté de Bourgogne », à Besançon.
Ce document nous permet peut-être d’identifier Le Chevalier. Pierre
Marcel, dans son « Inventaire des Papiers de Robert de Cotte 4 » émet la
supposition qu’il était peut-être un parent de cet Étienne Le Chevalier,
dessinateur des Bâtiments du Roy, qui dirigea de 1687 à 1689, à Tours, la
construction de l’arc de triomphe élevé sur les plans de Jules Hardouin-
Mansart à la gloire de Louis XIV 5 ». Or, la requête de Querret nous dit qu’il
fut contemporain de Le Blond. Il s’agit d’Alexandre-Jean-Baptiste
Le Blond, né en 1679, et qui représente dans l’histoire de l’architecture
1 Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome, VII, 380.
2 A travers l’Alsace, Paris, 1911, p. 267.
3 Voir p. 166 et 170.
4 P- 149
5 Placé à l’entrée de la rue Royale (aujourd’hui Nationale) vers la Loire, cet arc de triomphe
fut détruit en 1774. (Bauchal, Dictionnaire des Architectes.)