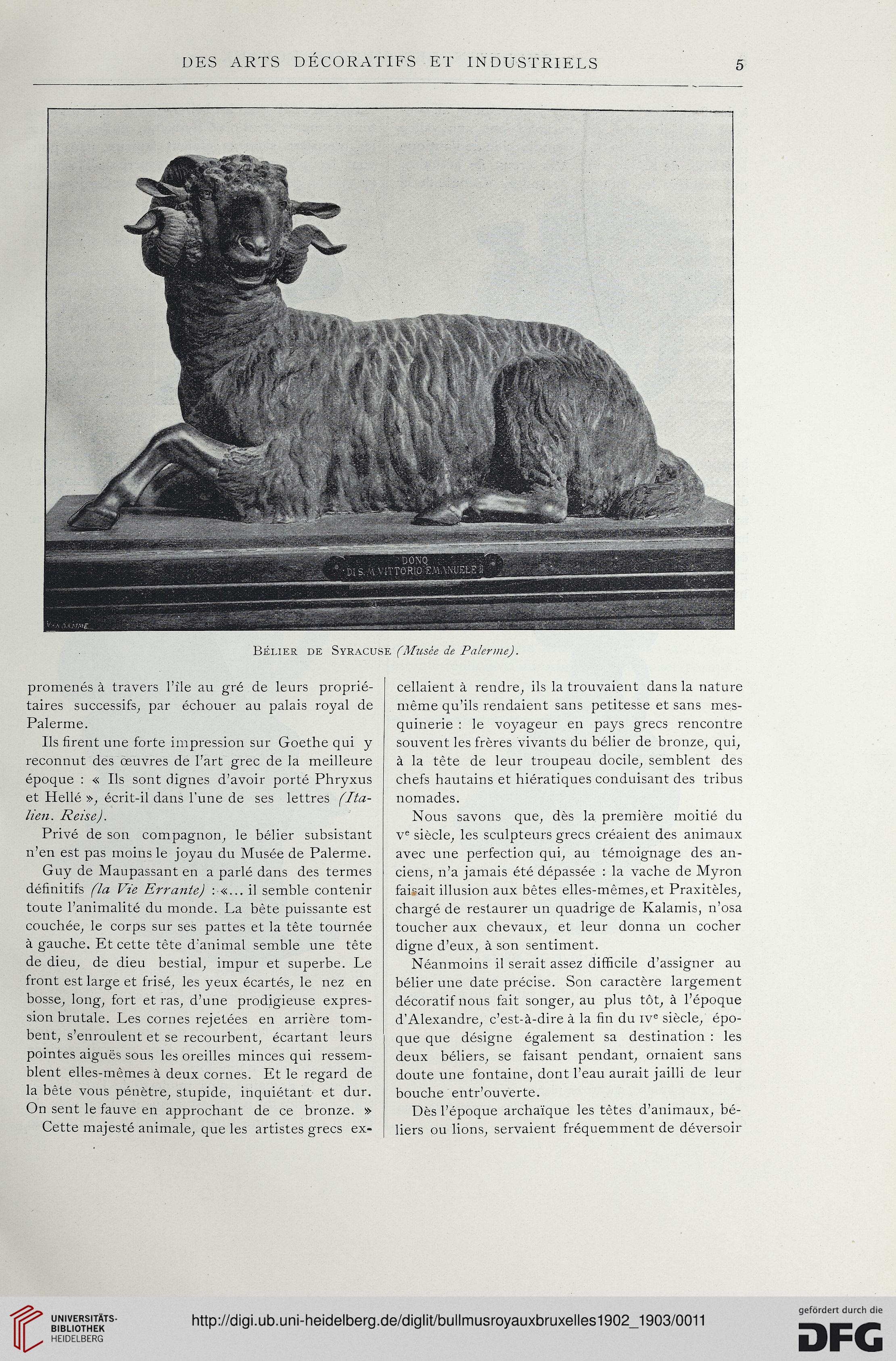DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS
5
Bélier de Syracuse (Musée de Païenne).
promenés à travers l’île au gré de leurs proprié-
taires successifs, par échouer au palais royal de
Palerme.
Us firent une forte impression sur Goethe qui y
reconnut des œuvres de l'art grec de la meilleure
époque : « Us sont dignes d’avoir porté Phryxus
et Hellé », écrit-il dans l’une de ses lettres (Ita-
lien. Reise).
Privé de son compagnon, le bélier subsistant
n’en est pas moins le joyau du Musée de Palerme.
Guy de Maupassant en a parlé dans des termes
définitifs (la Vie Errante) : «... il semble contenir
toute l’animalité du monde. La bête puissante est
couchée, le corps sur ses pattes et la tête tournée
à gauche. Et cette tête d’animal semble une tête
de dieu, de dieu bestial, impur et superbe. Le
front est large et frisé, les yeux écartés, le nez en
bosse, long, fort et ras, d’une prodigieuse expres-
sion brutale. Les cornes rejetées en arrière tom-
bent, s’enroulent et se recourbent, écartant leurs
pointes aiguës sous les oreilles minces qui ressem-
blent elles-mêmes à deux cornes. Et le regard de
la bête vous pénètre, stupide, inquiétant et dur.
On sent le fauve en approchant de ce bronze. »
Cette majesté animale, que les artistes grecs ex-
cellaient à rendre, ils la trouvaient dans la nature
même qu’ils rendaient sans petitesse et sans mes-
quinerie : le voyageur en pays grecs rencontre
souvent les frères vivants du bélier de bronze, qui,
à la tête de leur troupeau docile, semblent des
chefs hautains et hiératiques conduisant des tribus
nomades.
Nous savons que, dès la première moitié du
Ve siècle, les sculpteurs grecs créaient des animaux
avec une perfection qui, au témoignage des an-
ciens, n’a jamais été dépassée : la vache de Myron
faisait illusion aux bêtes elles-mêmes, et Praxitèles,
chargé de restaurer un quadrige de Kalamis, n’osa
toucher aux chevaux, et leur donna un cocher
digne d’eux, à son sentiment.
Néanmoins il serait assez difficile d’assigner au
bélier une date précise. Son caractère largement
décoratif nous fait songer, au plus tôt, à l’époque
d’Alexandre, c’est-à-dire à la fin du ive siècle, épo-
que que désigne également sa destination : les
deux béliers, se faisant pendant, ornaient sans
doute une fontaine, dont l’eau aurait jailli de leur
bouche entr’ouverte.
Dès l’époque archaïque les têtes d’animaux, bé-
liers ou lions, servaient fréquemment de déversoir
5
Bélier de Syracuse (Musée de Païenne).
promenés à travers l’île au gré de leurs proprié-
taires successifs, par échouer au palais royal de
Palerme.
Us firent une forte impression sur Goethe qui y
reconnut des œuvres de l'art grec de la meilleure
époque : « Us sont dignes d’avoir porté Phryxus
et Hellé », écrit-il dans l’une de ses lettres (Ita-
lien. Reise).
Privé de son compagnon, le bélier subsistant
n’en est pas moins le joyau du Musée de Palerme.
Guy de Maupassant en a parlé dans des termes
définitifs (la Vie Errante) : «... il semble contenir
toute l’animalité du monde. La bête puissante est
couchée, le corps sur ses pattes et la tête tournée
à gauche. Et cette tête d’animal semble une tête
de dieu, de dieu bestial, impur et superbe. Le
front est large et frisé, les yeux écartés, le nez en
bosse, long, fort et ras, d’une prodigieuse expres-
sion brutale. Les cornes rejetées en arrière tom-
bent, s’enroulent et se recourbent, écartant leurs
pointes aiguës sous les oreilles minces qui ressem-
blent elles-mêmes à deux cornes. Et le regard de
la bête vous pénètre, stupide, inquiétant et dur.
On sent le fauve en approchant de ce bronze. »
Cette majesté animale, que les artistes grecs ex-
cellaient à rendre, ils la trouvaient dans la nature
même qu’ils rendaient sans petitesse et sans mes-
quinerie : le voyageur en pays grecs rencontre
souvent les frères vivants du bélier de bronze, qui,
à la tête de leur troupeau docile, semblent des
chefs hautains et hiératiques conduisant des tribus
nomades.
Nous savons que, dès la première moitié du
Ve siècle, les sculpteurs grecs créaient des animaux
avec une perfection qui, au témoignage des an-
ciens, n’a jamais été dépassée : la vache de Myron
faisait illusion aux bêtes elles-mêmes, et Praxitèles,
chargé de restaurer un quadrige de Kalamis, n’osa
toucher aux chevaux, et leur donna un cocher
digne d’eux, à son sentiment.
Néanmoins il serait assez difficile d’assigner au
bélier une date précise. Son caractère largement
décoratif nous fait songer, au plus tôt, à l’époque
d’Alexandre, c’est-à-dire à la fin du ive siècle, épo-
que que désigne également sa destination : les
deux béliers, se faisant pendant, ornaient sans
doute une fontaine, dont l’eau aurait jailli de leur
bouche entr’ouverte.
Dès l’époque archaïque les têtes d’animaux, bé-
liers ou lions, servaient fréquemment de déversoir