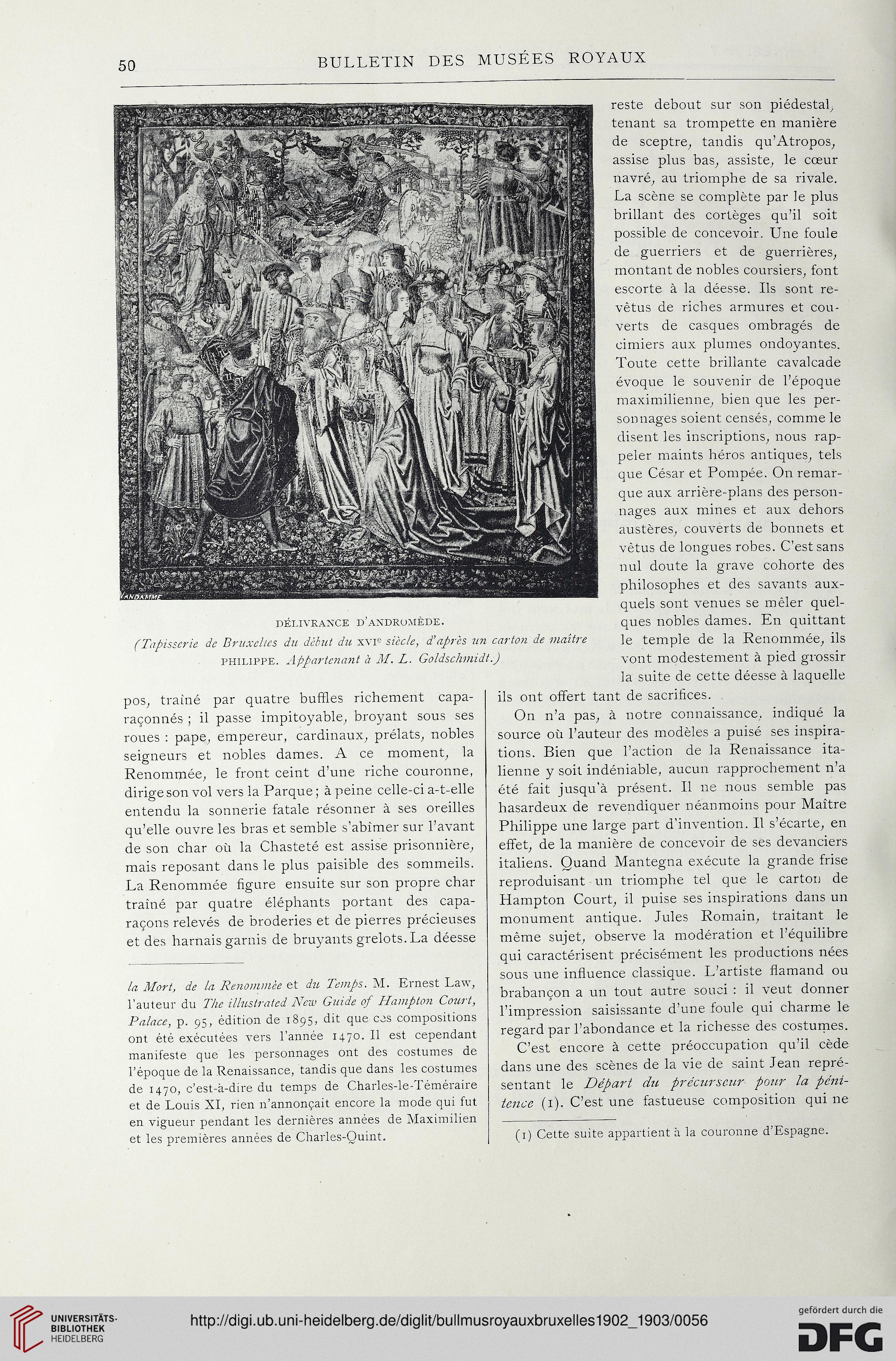50
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
DÉLIVRANCE D’ANDROMÈDE.
(Tapisserie de Bruxelles du début du xvie siècle, d'après un carton de maître
Philippe. Appartenant à M. L. Goldschmidt.)
pos, traîné par quatre buffles richement capa-
raçonnés ; il passe impitoyable, broyant sous ses
roues : pape, empereur, cardinaux, prélats, nobles
seigneurs et nobles dames. A ce moment, la
Renommée, le front ceint d’une riche couronne,
dirige son vol vers la Parque ; à peine celle-ci a-t-elle
entendu la sonnerie fatale résonner à ses oreilles
qu’elle ouvre les bras et semble s’abîmer sur l’avant
de son char où la Chasteté est assise prisonnière,
mais reposant dans le plus paisible des sommeils.
La Renommée figure ensuite sur son propre char
traîné par quatre éléphants portant des capa-
raçons relevés de broderies et de pierres précieuses
et des harnais garnis de bruyants grelots. La déesse
la Mort, de la Renommée et du Temps. M. Ernest Law,
l’auteur du The illustrâted New Guide of Hampton Court,
Palace, p. 95, édition de 1895, dit que ces compositions
ont été exécutées vers l’année 1470. Il est cependant
manifeste que les personnages ont des costumes de
l’époque de la Renaissance, tandis que dans les costumes
de 1470, c’est-à-dire du temps de Charles-le-Téméraire
et de Louis XI, rien 11’annonçait encore la mode qui fut
en vigueur pendant les dernières années de Maximilien
et les premières années de Charles-Ouint.
reste debout sur son piédestal,
tenant sa trompette en manière
de sceptre, tandis qu’Atropos,
assise plus bas, assiste, le cœur
navré, au triomphe de sa rivale.
La scène se complète par le plus
brillant des cortèges qu’il soit
possible de concevoir. Une foule
de guerriers et de guerrières,
montant de nobles coursiers, font
escorte à la déesse. Us sont re-
vêtus de riches armures et cou-
verts de casques ombragés de
cimiers aux plumes ondoyantes.
Toute cette brillante cavalcade
évoque le souvenir de l’époque
maximilienne, bien que les per-
sonnages soient censés, comme le
disent les inscriptions, nous rap-
peler maints héros antiques, tels
que César et Pompée. On remar-
que aux arrière-plans des person-
nages aux mines et aux dehors
austères, couverts de bonnets et
vêtus de longues robes. C’est sans
nul doute la grave cohorte des
philosophes et des savants aux-
quels sont venues se mêler quel-
ques nobles dames. En quittant
le temple de la Renommée, ils
vont modestement à pied grossir
la suite de cette déesse à laquelle
ils ont offert tant de sacrifices.
On n’a pas, à notre connaissance, indiqué la
source où l’auteur des modèles a puisé ses inspira-
tions. Bien que l’action de la Renaissance ita-
lienne y soit indéniable, aucun rapprochement n’a
été fait jusqu’à présent. Il ne nous semble pas
hasardeux de revendiquer néanmoins pour Maître
Philippe une large part d’invention. Il s’écarte, en
effet, de la manière de concevoir de ses devanciers
italiens. Quand Mantegna exécute la grande frise
reproduisant un triomphe tel que le carton de
Hampton Court, il puise ses inspirations dans un
monument antique. Jules Romain, traitant le
même sujet, observe la modération et l’équilibre
qui caractérisent précisément les productions nées
sous une influence classique. L’artiste flamand ou
brabançon a un tout autre souci : il veut donner
l’impression saisissante d’une foule qui charme le
regard par l’abondance et la richesse des costumes.
C’est encore à cette préoccupation qu’il cède
dans une des scènes de la vie de saint Jean repré-
sentant le Départ du précurseur pour la péni-
tence (1). C’est une fastueuse composition qui ne
(1) Cette suite appartient à la couronne d’Espagne.
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
DÉLIVRANCE D’ANDROMÈDE.
(Tapisserie de Bruxelles du début du xvie siècle, d'après un carton de maître
Philippe. Appartenant à M. L. Goldschmidt.)
pos, traîné par quatre buffles richement capa-
raçonnés ; il passe impitoyable, broyant sous ses
roues : pape, empereur, cardinaux, prélats, nobles
seigneurs et nobles dames. A ce moment, la
Renommée, le front ceint d’une riche couronne,
dirige son vol vers la Parque ; à peine celle-ci a-t-elle
entendu la sonnerie fatale résonner à ses oreilles
qu’elle ouvre les bras et semble s’abîmer sur l’avant
de son char où la Chasteté est assise prisonnière,
mais reposant dans le plus paisible des sommeils.
La Renommée figure ensuite sur son propre char
traîné par quatre éléphants portant des capa-
raçons relevés de broderies et de pierres précieuses
et des harnais garnis de bruyants grelots. La déesse
la Mort, de la Renommée et du Temps. M. Ernest Law,
l’auteur du The illustrâted New Guide of Hampton Court,
Palace, p. 95, édition de 1895, dit que ces compositions
ont été exécutées vers l’année 1470. Il est cependant
manifeste que les personnages ont des costumes de
l’époque de la Renaissance, tandis que dans les costumes
de 1470, c’est-à-dire du temps de Charles-le-Téméraire
et de Louis XI, rien 11’annonçait encore la mode qui fut
en vigueur pendant les dernières années de Maximilien
et les premières années de Charles-Ouint.
reste debout sur son piédestal,
tenant sa trompette en manière
de sceptre, tandis qu’Atropos,
assise plus bas, assiste, le cœur
navré, au triomphe de sa rivale.
La scène se complète par le plus
brillant des cortèges qu’il soit
possible de concevoir. Une foule
de guerriers et de guerrières,
montant de nobles coursiers, font
escorte à la déesse. Us sont re-
vêtus de riches armures et cou-
verts de casques ombragés de
cimiers aux plumes ondoyantes.
Toute cette brillante cavalcade
évoque le souvenir de l’époque
maximilienne, bien que les per-
sonnages soient censés, comme le
disent les inscriptions, nous rap-
peler maints héros antiques, tels
que César et Pompée. On remar-
que aux arrière-plans des person-
nages aux mines et aux dehors
austères, couverts de bonnets et
vêtus de longues robes. C’est sans
nul doute la grave cohorte des
philosophes et des savants aux-
quels sont venues se mêler quel-
ques nobles dames. En quittant
le temple de la Renommée, ils
vont modestement à pied grossir
la suite de cette déesse à laquelle
ils ont offert tant de sacrifices.
On n’a pas, à notre connaissance, indiqué la
source où l’auteur des modèles a puisé ses inspira-
tions. Bien que l’action de la Renaissance ita-
lienne y soit indéniable, aucun rapprochement n’a
été fait jusqu’à présent. Il ne nous semble pas
hasardeux de revendiquer néanmoins pour Maître
Philippe une large part d’invention. Il s’écarte, en
effet, de la manière de concevoir de ses devanciers
italiens. Quand Mantegna exécute la grande frise
reproduisant un triomphe tel que le carton de
Hampton Court, il puise ses inspirations dans un
monument antique. Jules Romain, traitant le
même sujet, observe la modération et l’équilibre
qui caractérisent précisément les productions nées
sous une influence classique. L’artiste flamand ou
brabançon a un tout autre souci : il veut donner
l’impression saisissante d’une foule qui charme le
regard par l’abondance et la richesse des costumes.
C’est encore à cette préoccupation qu’il cède
dans une des scènes de la vie de saint Jean repré-
sentant le Départ du précurseur pour la péni-
tence (1). C’est une fastueuse composition qui ne
(1) Cette suite appartient à la couronne d’Espagne.