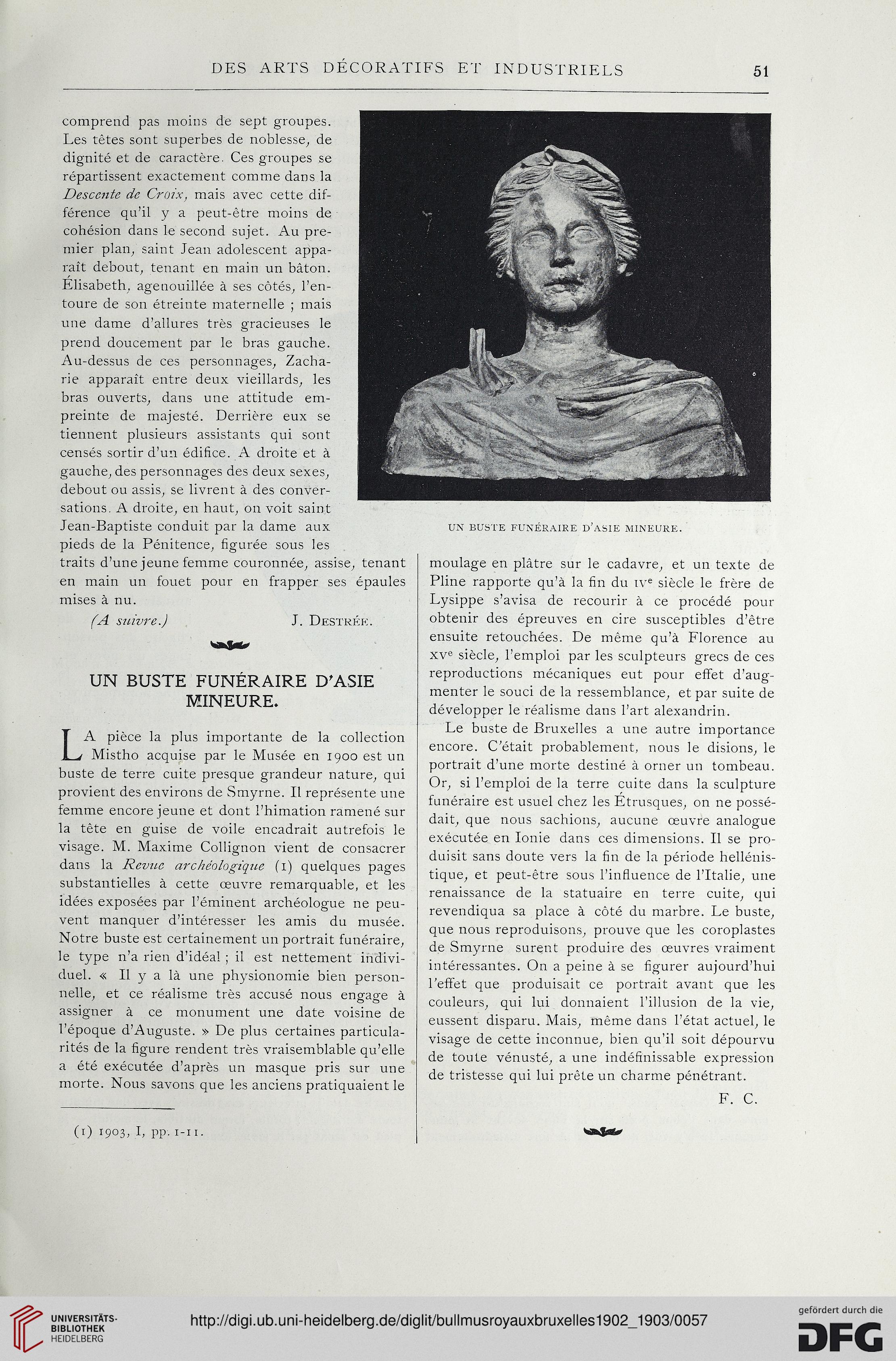DES ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS
51
UN BUSTE FUNÉRAIRE D’ASIE MINEURE.
comprend pas moins de sept groupes.
Les têtes sont superbes de noblesse, de
dignité et de caractère. Ces groupes se
répartissent exactement comme dans la
Descente de Croix, mais avec cette dif-
férence qu’il y a peut-être moins de
cohésion dans le second sujet. Au pre-
mier plan, saint Jean adolescent appa-
raît debout, tenant en main un bâton.
Elisabeth, agenouillée à ses côtés, l’en-
toure de son étreinte maternelle ; mais
une dame d’allures très gracieuses le
prend doucement par le bras gauche.
Au-dessus de ces personnages, Zacha-
rie apparaît entre deux vieillards, les
bras ouverts, dans une attitude em-
preinte de majesté. Derrière eux se
tiennent plusieurs assistants qui sont
censés sortir d’un édifice. A droite et à
gauche, des personnages des deux sexes,
debout ou assis, se livrent à des conver-
sations. A droite, en haut, on voit saint
Jean-Baptiste conduit par la dame aux
pieds de la Pénitence, figurée sous les
traits d’une jeune femme couronnée, assise, tenant
en main un fouet pour en frapper ses épaules
mises à nu.
(A suivre.) J. Destrée.
UN BUSTE FUNÉRAIRE D'ASIE
MINEURE.
LA pièce la plus importante de la collection
Mistho acquise par le Musée en 1900 est un
buste de terre cuite presque grandeur nature, qui
provient des environs de Smyrne. Il représente une
femme encore jeune et dont l’himation ramené sur
la tête en guise de voile encadrait autrefois le
visage. M. Maxime Collignon vient de consacrer
dans la Revue archéologique (1) quelques pages
substantielles à cette œuvre remarquable, et les
idées exposées par l’éminent archéologue ne peu-
vent manquer d’intéresser les amis du musée.
Notre buste est certainement un portrait funéraire,
le type n’a rien d’idéal ; il est nettement indivi-
duel. « Il y a là une physionomie bien person-
nelle, et ce réalisme très accusé nous engage à
assigner à ce monument une date voisine de
l’époque d’Auguste. » De plus certaines particula-
rités de la figure rendent très vraisemblable qu’elle
a été exécutée d’après un masque pris sur une
morte. Nous savons que les anciens pratiquaient le
moulage en plâtre sur le cadavre, et un texte de
Pline rapporte qu’à la fin du ive siècle le frère de
Lysippe s’avisa de recourir à ce procédé pour
obtenir des épreuves en cire susceptibles d’être
ensuite retouchées. De même qu’à Florence au
xve siècle, l’emploi par les sculpteurs grecs de ces
reproductions mécaniques eut pour effet d’aug-
menter le souci de la ressemblance, et par suite de
développer le réalisme dans l’art alexandrin.
Le buste de Bruxelles a une autre importance
encore. C’était probablement, nous le disions, le
portrait d’une morte destiné à orner un tombeau.
Or, si l’emploi de la terre cuite dans la sculpture
funéraire est usuel chez les Etrusques, on ne possé-
dait, que nous sachions, aucune œuvre analogue
exécutée en Ionie dans ces dimensions. Il se pro-
duisit sans doute vers la fin de la période hellénis-
tique, et peut-être sous l’influence de l’Italie, une
renaissance de la statuaire en terre cuite, qui
revendiqua sa place à côté du marbre. Le buste,
que nous reproduisons, prouve que les coroplastes
de Smyrne surent produire des œuvres vraiment
intéressantes. On a peine à se figurer aujourd’hui
l'effet que produisait ce portrait avant que les
couleurs, qui lui donnaient l’illusion de la vie,
eussent disparu. Mais, même dans l’état actuel, le
visage de cette inconnue, bien qu’il soit dépourvu
de toute vénusté, a une indéfinissable expression
de tristesse qui lui prête un charme pénétrant.
F. C.
(0 h PP- I-II •
51
UN BUSTE FUNÉRAIRE D’ASIE MINEURE.
comprend pas moins de sept groupes.
Les têtes sont superbes de noblesse, de
dignité et de caractère. Ces groupes se
répartissent exactement comme dans la
Descente de Croix, mais avec cette dif-
férence qu’il y a peut-être moins de
cohésion dans le second sujet. Au pre-
mier plan, saint Jean adolescent appa-
raît debout, tenant en main un bâton.
Elisabeth, agenouillée à ses côtés, l’en-
toure de son étreinte maternelle ; mais
une dame d’allures très gracieuses le
prend doucement par le bras gauche.
Au-dessus de ces personnages, Zacha-
rie apparaît entre deux vieillards, les
bras ouverts, dans une attitude em-
preinte de majesté. Derrière eux se
tiennent plusieurs assistants qui sont
censés sortir d’un édifice. A droite et à
gauche, des personnages des deux sexes,
debout ou assis, se livrent à des conver-
sations. A droite, en haut, on voit saint
Jean-Baptiste conduit par la dame aux
pieds de la Pénitence, figurée sous les
traits d’une jeune femme couronnée, assise, tenant
en main un fouet pour en frapper ses épaules
mises à nu.
(A suivre.) J. Destrée.
UN BUSTE FUNÉRAIRE D'ASIE
MINEURE.
LA pièce la plus importante de la collection
Mistho acquise par le Musée en 1900 est un
buste de terre cuite presque grandeur nature, qui
provient des environs de Smyrne. Il représente une
femme encore jeune et dont l’himation ramené sur
la tête en guise de voile encadrait autrefois le
visage. M. Maxime Collignon vient de consacrer
dans la Revue archéologique (1) quelques pages
substantielles à cette œuvre remarquable, et les
idées exposées par l’éminent archéologue ne peu-
vent manquer d’intéresser les amis du musée.
Notre buste est certainement un portrait funéraire,
le type n’a rien d’idéal ; il est nettement indivi-
duel. « Il y a là une physionomie bien person-
nelle, et ce réalisme très accusé nous engage à
assigner à ce monument une date voisine de
l’époque d’Auguste. » De plus certaines particula-
rités de la figure rendent très vraisemblable qu’elle
a été exécutée d’après un masque pris sur une
morte. Nous savons que les anciens pratiquaient le
moulage en plâtre sur le cadavre, et un texte de
Pline rapporte qu’à la fin du ive siècle le frère de
Lysippe s’avisa de recourir à ce procédé pour
obtenir des épreuves en cire susceptibles d’être
ensuite retouchées. De même qu’à Florence au
xve siècle, l’emploi par les sculpteurs grecs de ces
reproductions mécaniques eut pour effet d’aug-
menter le souci de la ressemblance, et par suite de
développer le réalisme dans l’art alexandrin.
Le buste de Bruxelles a une autre importance
encore. C’était probablement, nous le disions, le
portrait d’une morte destiné à orner un tombeau.
Or, si l’emploi de la terre cuite dans la sculpture
funéraire est usuel chez les Etrusques, on ne possé-
dait, que nous sachions, aucune œuvre analogue
exécutée en Ionie dans ces dimensions. Il se pro-
duisit sans doute vers la fin de la période hellénis-
tique, et peut-être sous l’influence de l’Italie, une
renaissance de la statuaire en terre cuite, qui
revendiqua sa place à côté du marbre. Le buste,
que nous reproduisons, prouve que les coroplastes
de Smyrne surent produire des œuvres vraiment
intéressantes. On a peine à se figurer aujourd’hui
l'effet que produisait ce portrait avant que les
couleurs, qui lui donnaient l’illusion de la vie,
eussent disparu. Mais, même dans l’état actuel, le
visage de cette inconnue, bien qu’il soit dépourvu
de toute vénusté, a une indéfinissable expression
de tristesse qui lui prête un charme pénétrant.
F. C.
(0 h PP- I-II •