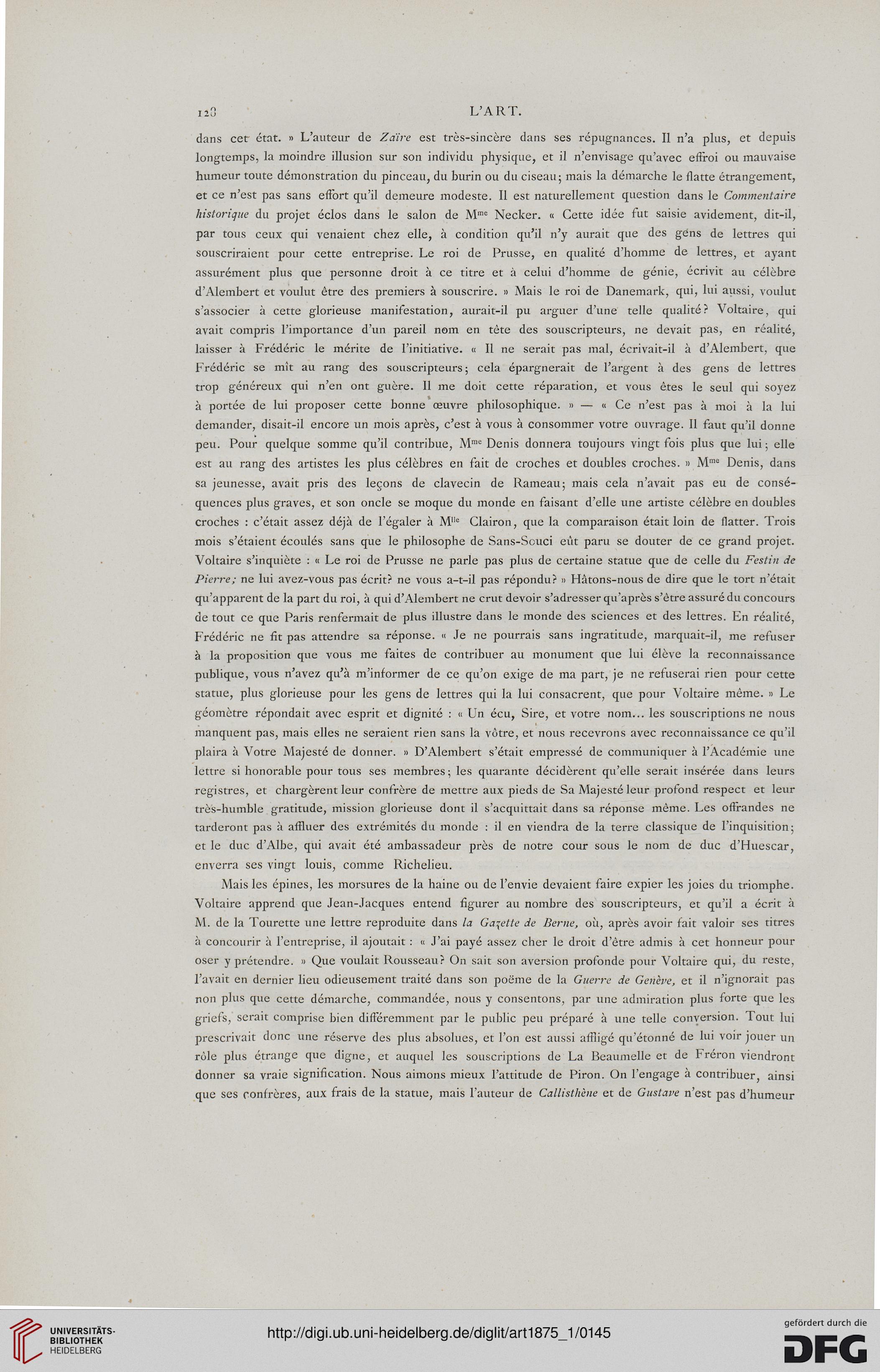dans cet état. » L'auteur de Zaïre est très-sincère dans ses répugnances. Il n'a plus, et depuis
longtemps, la moindre illusion sur son individu physique, et il n'envisage qu'avec effroi ou mauvaise
humeur toute démonstration du pinceau, du burin ou du ciseau; mais la démarche le flatte étrangement,
et ce n'est pas sans effort qu'il demeure modeste. Il est naturellement question dans le Commentaire
historique du projet éclos dans le salon de Mme Necker. « Cette idée fut saisie avidement, dit-il,
par tous ceux qui venaient chez elle, à condition qu'il n'y aurait que des gens de lettres qui
souscriraient pour cette entreprise. Le roi de Prusse, en qualité d'homme de lettres, et ayant
assurément plus que personne droit à ce titre et à celui d'homme de génie, écrivit au célèbre
d'Alembert et voulut être des premiers à souscrire. » Mais le roi de Danemark, qui, lui aussi, voulut
s'associer à cette glorieuse manifestation, aurait-il pu arguer d'une telle qualité? Voltaire, qui
avait compris l'importance d'un pareil nom en tête des souscripteurs, ne devait pas, en réalité,
laisser à Frédéric le mérite de l'initiative. « Il ne serait pas mal, écrivait-il à d'Alembert, que
Frédéric se mît au rang des souscripteurs ; cela épargnerait de l'argent à des gens de lettres
trop généreux qui n'en ont guère. Il me doit cette réparation, et vous êtes le seul qui soyez
à portée de lui proposer cette bonne œuvre philosophique. » — « Ce n'est pas à moi à la lui
demander, disait-il encore un mois après, c'est à vous à consommer votre ouvrage. Il faut qu'il donne
peu. Pour quelque somme qu'il contribue, Mme Denis donnera toujours vingt fois plus que lui ; elle
est au rang des artistes les plus célèbres en fait de croches et doubles croches. » Mme Denis, dans
sa jeunesse, avait pris des leçons de clavecin de Rameau; mais cela n'avait pas eu de consé-
quences plus graves, et son oncle se moque du monde en faisant d'elle une artiste célèbre en doubles
croches : c'était assez déjà de l'égaler à M"e Clairon, que la comparaison était loin de flatter. Trois
mois s'étaient écoulés sans que le philosophe de Sans-Scuci eût paru se douter de ce grand projet.
Voltaire s'inquiète : « Le roi de Prusse ne parle pas plus de certaine statue que de celle du Festin de
Pierre; ne lui avez-vous pas écrit? ne vous a-t-il pas répondu? » Hàtons-nous de dire que le tort n'était
qu'apparent de la part du roi, à qui d'Alembert ne crut devoir s'adresser qu'après s'être assuré du concours
de tout ce que Paris renfermait de plus illustre dans le monde des sciences et des lettres. En réalité,
Frédéric ne fit pas attendre sa réponse. « Je ne pourrais sans ingratitude, marquait-il, me refuser
à la proposition que vous me faites de contribuer au monument que lui élève la reconnaissance
publique, vous n'avez qu'à m'informer de ce qu'on exige de ma part, je ne refuserai rien pour cette
statue, plus glorieuse pour les gens de lettres qui la lui consacrent, que pour Voltaire même. » Le
géomètre répondait avec esprit et dignité : « Un écu, Sire, et votre nom... les souscriptions ne nous
manquent pas, mais elles ne seraient rien sans la vôtre, et nous recevrons avec reconnaissance ce qu'il
plaira à Votre Majesté de donner. » D'Alembert s'était empressé de communiquer à l'Académie une
lettre si honorable pour tous ses membres ; les quarante décidèrent qu'elle serait insérée dans leurs
registres, et chargèrent leur confrère de mettre aux pieds de Sa Majesté leur profond respect et leur
très-humble gratitude, mission glorieuse dont il s'acquittait dans sa réponse même. Les offrandes ne
tarderont pas à affluer des extrémités du monde : il en viendra de la terre classique de l'inquisition;
et le duc d'Albe, qui avait été ambassadeur près de notre cour sous le nom de duc d'Huescar,
enverra ses vingt louis, comme Richelieu.
Mais les épines, les morsures de la haine ou de l'envie devaient faire expier les joies du triomphe.
Voltaire apprend que Jean-Jacques entend figurer au nombre des souscripteurs, et qu'il a écrit à
M. de la Tourette une lettre reproduite dans la Galette de Berne, où, après avoir fait valoir ses titres
à concourir à l'entreprise, il ajoutait : « J'ai payé assez cher le droit d'être admis à cet honneur pour
oser y prétendre. » Que voulait Rousseau? On sait son aversion profonde pour Voltaire qui, du reste,
l'avait en dernier lieu odieusement traité dans son poëme de la Guerre de Genève, et il n'ignorait pas
non plus que cette démarche, commandée, nous y consentons, par une admiration plus forte que les
griefs, serait comprise bien différemment par le public peu préparé à une telle conversion. Tout lui
prescrivait donc une réserve des plus absolues, et l'on est aussi affligé qu'étonné de lui voir jouer un
rùle plus étrange que digne, et auquel les souscriptions de La Beaumelle et de Fréron viendront
donner sa vraie signification. Nous aimons mieux l'attitude de Piron. On l'engage à contribuer, ainsi
que ses confrères, aux frais de la statue, mais l'auteur de Callisthène et de Gustave n'est pas d'humeur
longtemps, la moindre illusion sur son individu physique, et il n'envisage qu'avec effroi ou mauvaise
humeur toute démonstration du pinceau, du burin ou du ciseau; mais la démarche le flatte étrangement,
et ce n'est pas sans effort qu'il demeure modeste. Il est naturellement question dans le Commentaire
historique du projet éclos dans le salon de Mme Necker. « Cette idée fut saisie avidement, dit-il,
par tous ceux qui venaient chez elle, à condition qu'il n'y aurait que des gens de lettres qui
souscriraient pour cette entreprise. Le roi de Prusse, en qualité d'homme de lettres, et ayant
assurément plus que personne droit à ce titre et à celui d'homme de génie, écrivit au célèbre
d'Alembert et voulut être des premiers à souscrire. » Mais le roi de Danemark, qui, lui aussi, voulut
s'associer à cette glorieuse manifestation, aurait-il pu arguer d'une telle qualité? Voltaire, qui
avait compris l'importance d'un pareil nom en tête des souscripteurs, ne devait pas, en réalité,
laisser à Frédéric le mérite de l'initiative. « Il ne serait pas mal, écrivait-il à d'Alembert, que
Frédéric se mît au rang des souscripteurs ; cela épargnerait de l'argent à des gens de lettres
trop généreux qui n'en ont guère. Il me doit cette réparation, et vous êtes le seul qui soyez
à portée de lui proposer cette bonne œuvre philosophique. » — « Ce n'est pas à moi à la lui
demander, disait-il encore un mois après, c'est à vous à consommer votre ouvrage. Il faut qu'il donne
peu. Pour quelque somme qu'il contribue, Mme Denis donnera toujours vingt fois plus que lui ; elle
est au rang des artistes les plus célèbres en fait de croches et doubles croches. » Mme Denis, dans
sa jeunesse, avait pris des leçons de clavecin de Rameau; mais cela n'avait pas eu de consé-
quences plus graves, et son oncle se moque du monde en faisant d'elle une artiste célèbre en doubles
croches : c'était assez déjà de l'égaler à M"e Clairon, que la comparaison était loin de flatter. Trois
mois s'étaient écoulés sans que le philosophe de Sans-Scuci eût paru se douter de ce grand projet.
Voltaire s'inquiète : « Le roi de Prusse ne parle pas plus de certaine statue que de celle du Festin de
Pierre; ne lui avez-vous pas écrit? ne vous a-t-il pas répondu? » Hàtons-nous de dire que le tort n'était
qu'apparent de la part du roi, à qui d'Alembert ne crut devoir s'adresser qu'après s'être assuré du concours
de tout ce que Paris renfermait de plus illustre dans le monde des sciences et des lettres. En réalité,
Frédéric ne fit pas attendre sa réponse. « Je ne pourrais sans ingratitude, marquait-il, me refuser
à la proposition que vous me faites de contribuer au monument que lui élève la reconnaissance
publique, vous n'avez qu'à m'informer de ce qu'on exige de ma part, je ne refuserai rien pour cette
statue, plus glorieuse pour les gens de lettres qui la lui consacrent, que pour Voltaire même. » Le
géomètre répondait avec esprit et dignité : « Un écu, Sire, et votre nom... les souscriptions ne nous
manquent pas, mais elles ne seraient rien sans la vôtre, et nous recevrons avec reconnaissance ce qu'il
plaira à Votre Majesté de donner. » D'Alembert s'était empressé de communiquer à l'Académie une
lettre si honorable pour tous ses membres ; les quarante décidèrent qu'elle serait insérée dans leurs
registres, et chargèrent leur confrère de mettre aux pieds de Sa Majesté leur profond respect et leur
très-humble gratitude, mission glorieuse dont il s'acquittait dans sa réponse même. Les offrandes ne
tarderont pas à affluer des extrémités du monde : il en viendra de la terre classique de l'inquisition;
et le duc d'Albe, qui avait été ambassadeur près de notre cour sous le nom de duc d'Huescar,
enverra ses vingt louis, comme Richelieu.
Mais les épines, les morsures de la haine ou de l'envie devaient faire expier les joies du triomphe.
Voltaire apprend que Jean-Jacques entend figurer au nombre des souscripteurs, et qu'il a écrit à
M. de la Tourette une lettre reproduite dans la Galette de Berne, où, après avoir fait valoir ses titres
à concourir à l'entreprise, il ajoutait : « J'ai payé assez cher le droit d'être admis à cet honneur pour
oser y prétendre. » Que voulait Rousseau? On sait son aversion profonde pour Voltaire qui, du reste,
l'avait en dernier lieu odieusement traité dans son poëme de la Guerre de Genève, et il n'ignorait pas
non plus que cette démarche, commandée, nous y consentons, par une admiration plus forte que les
griefs, serait comprise bien différemment par le public peu préparé à une telle conversion. Tout lui
prescrivait donc une réserve des plus absolues, et l'on est aussi affligé qu'étonné de lui voir jouer un
rùle plus étrange que digne, et auquel les souscriptions de La Beaumelle et de Fréron viendront
donner sa vraie signification. Nous aimons mieux l'attitude de Piron. On l'engage à contribuer, ainsi
que ses confrères, aux frais de la statue, mais l'auteur de Callisthène et de Gustave n'est pas d'humeur