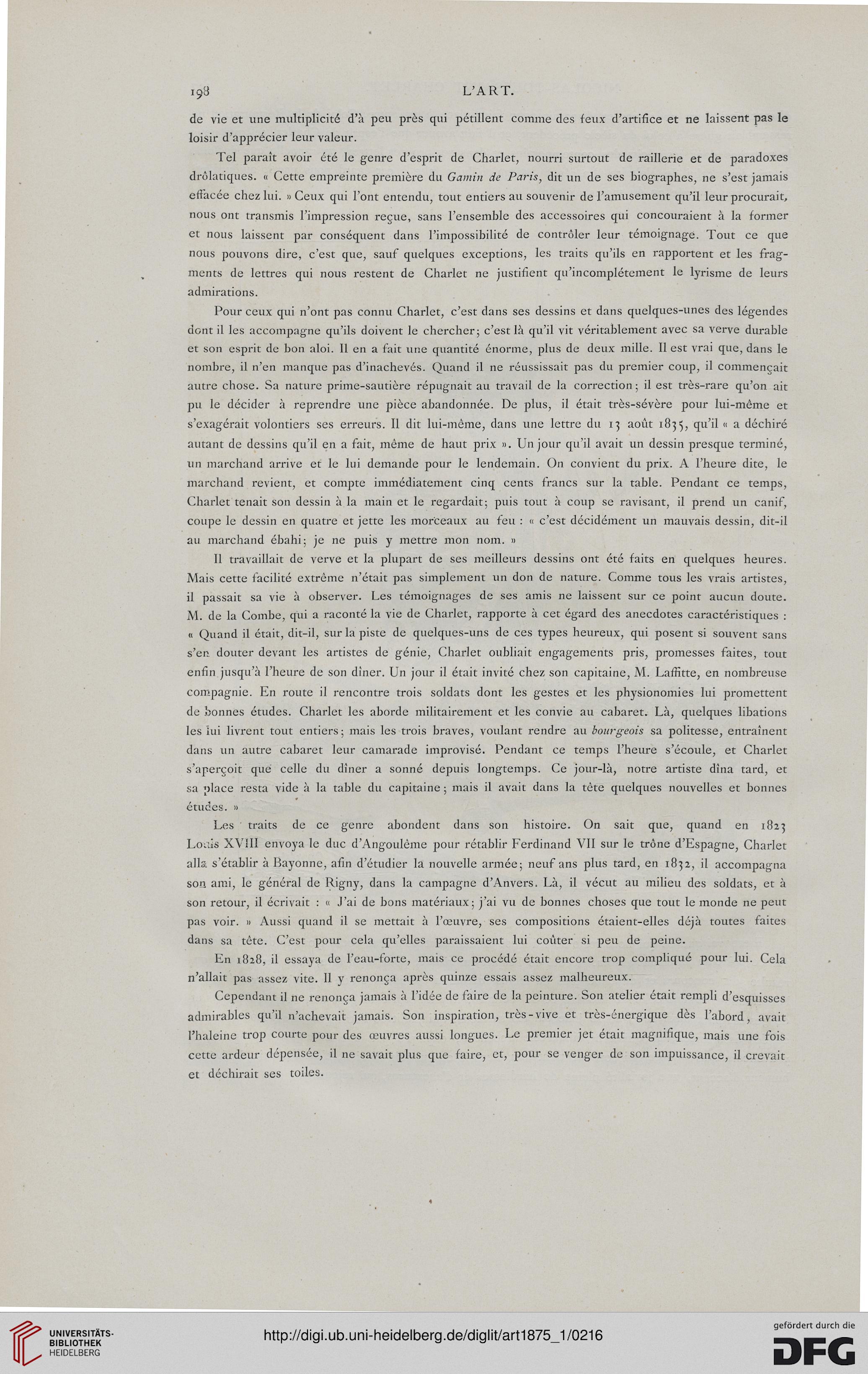de vie et une multiplicité d'à peu près qui pétillent comme des feux d'artifice et ne laissent pas le
loisir d'apprécier leur valeur.
Tel paraît avoir été le genre d'esprit de Charlet, nourri surtout de raillerie et de paradoxes
drolatiques. « Cette empreinte première du Gamin de Paris, dit un de ses biographes, ne s'est jamais
eiiacée chez lui. » Ceux qui l'ont entendu, tout entiers au souvenir de l'amusement qu'il leur procurait,
nous ont transmis l'impression reçue, sans l'ensemble des accessoires qui concouraient à la former
et nous laissent par conséquent dans l'impossibilité de contrôler leur témoignage. Tout ce que
nous pouvons dire, c'est que, sauf quelques exceptions, les traits qu'ils en rapportent et les frag-
ments de lettres qui nous restent de Charlet ne justifient qu'incomplètement le lyrisme de leurs
admirations.
Pour ceux qui n'ont pas connu Charlet, c'est dans ses dessins et dans quelques-unes des légendes
dont il les accompagne qu'ils doivent le chercher; c'est là qu'il vit véritablement avec sa verve durable
et son esprit de bon aloi. Il en a fait une quantité énorme, plus de deux mille. Il est vrai que, dans le
nombre, il n'en manque pas d'inachevés. Quand il ne réussissait pas du premier coup, il commençait
autre chose. Sa nature prime-sautière répugnait au travail de la correction ; il est très-rare qu'on ait
pu le décider à reprendre une pièce abandonnée. De plus, il était très-sévère pour lui-même et
s'exagérait volontiers ses erreurs. Il dit lui-môme, dans une lettre du 13 août 1835? qu'il « a déchiré
autant de dessins qu'il en a fait, même de haut prix ». Un jour qu'il avait un dessin presque terminé,
un marchand arrive et le lui demande pour le lendemain. On convient du prix. A l'heure dite, le
marchand revient, et compte immédiatement cinq cents francs sur la table. Pendant ce temps,
Charlet tenait son dessin à la main et le regardait; puis tout à coup se ravisant, il prend un canif,
coupe le dessin en quatre et jette les morceaux au feu : « c'est décidément un mauvais dessin, dit-il
au marchand ébahi; je ne puis y mettre mon nom. »
11 travaillait de verve et la plupart de ses meilleurs dessins ont été faits en quelques heures.
Mais cette facilité extrême n'était pas simplement un don de nature. Comme tous les vrais artistes,
il passait sa vie à observer. Les témoignages de ses amis ne laissent sur ce point aucun doute.
M. de la Combe, qui a raconté la vie de Charlet, rapporte à cet égard des anecdotes caractéristiques :
« Quand il était, dit-il, sur la piste de quelques-uns de ces types heureux, qui posent si souvent sans
s'en douter devant les artistes de génie, Charlet oubliait engagements pris, promesses faites, tout
enfin jusqu'à l'heure de son dîner. Un jour il était invité chez son capitaine, M. Laffitte, en nombreuse
compagnie. En route il rencontre trois soldats dont les gestes et les physionomies lui promettent
de bonnes études. Charlet les aborde militairement et les convie au cabaret. Là, quelques libations
les lui livrent tout entiers; mais les trois braves, voulant rendre au bourgeois sa politesse, entraînent
dans un autre cabaret leur camarade improvisé. Pendant ce temps l'heure s'écoule, et Charlet
s'aperçoit que celle du dîner a sonné depuis longtemps. Ce jour-là, notre artiste dîna tard, et
sa place resta vide à la table du capitaine ; mais il avait dans la tète quelques nouvelles et bonnes
études. »
Les traits de ce genre abondent dans son histoire. On sait que, quand en 1823
Louis XVIII envoya le duc d'Angoulème pour rétablir Ferdinand VII sur le trône d'Espagne, Charlet
alla s'établir à Bayonne, afin d'étudier la nouvelle armée; neuf ans plus tard, en 1832, il accompagna
son ami, le général de Rigny, dans la campagne d'Anvers. Là, il vécut au milieu des soldats, et à
son retour, il écrivait : « J'ai de bons matériaux; j'ai vu de bonnes choses que tout le monde ne peut
pas voir. » Aussi quand il se mettait à l'œuvre, ses compositions étaient-elles déjà toutes faites
dans sa tète. C'est pour cela qu'elles paraissaient lui coûter si peu de peine.
En 1828, il essaya de Feau-forte, mais ce procédé était encore trop compliqué pour lui. Cela
n'allait pas assez vite. Il y renonça après quinze essais assez malheureux.
Cependant il ne renonça jamais à l'idée de faire de la peinture. Son atelier était rempli d'esquisses
admirables qu'il n'achevait jamais. Son inspiration, très-vive et très-énergique dès l'abord, avait
l'haleine trop courte pour des œuvres aussi longues. Le premier jet était magnifique, mais une fois
cette ardeur dépensée, il ne savait plus que faire, et, pour se venger de son impuissance, il crevait
et déchirait ses todes.
loisir d'apprécier leur valeur.
Tel paraît avoir été le genre d'esprit de Charlet, nourri surtout de raillerie et de paradoxes
drolatiques. « Cette empreinte première du Gamin de Paris, dit un de ses biographes, ne s'est jamais
eiiacée chez lui. » Ceux qui l'ont entendu, tout entiers au souvenir de l'amusement qu'il leur procurait,
nous ont transmis l'impression reçue, sans l'ensemble des accessoires qui concouraient à la former
et nous laissent par conséquent dans l'impossibilité de contrôler leur témoignage. Tout ce que
nous pouvons dire, c'est que, sauf quelques exceptions, les traits qu'ils en rapportent et les frag-
ments de lettres qui nous restent de Charlet ne justifient qu'incomplètement le lyrisme de leurs
admirations.
Pour ceux qui n'ont pas connu Charlet, c'est dans ses dessins et dans quelques-unes des légendes
dont il les accompagne qu'ils doivent le chercher; c'est là qu'il vit véritablement avec sa verve durable
et son esprit de bon aloi. Il en a fait une quantité énorme, plus de deux mille. Il est vrai que, dans le
nombre, il n'en manque pas d'inachevés. Quand il ne réussissait pas du premier coup, il commençait
autre chose. Sa nature prime-sautière répugnait au travail de la correction ; il est très-rare qu'on ait
pu le décider à reprendre une pièce abandonnée. De plus, il était très-sévère pour lui-même et
s'exagérait volontiers ses erreurs. Il dit lui-môme, dans une lettre du 13 août 1835? qu'il « a déchiré
autant de dessins qu'il en a fait, même de haut prix ». Un jour qu'il avait un dessin presque terminé,
un marchand arrive et le lui demande pour le lendemain. On convient du prix. A l'heure dite, le
marchand revient, et compte immédiatement cinq cents francs sur la table. Pendant ce temps,
Charlet tenait son dessin à la main et le regardait; puis tout à coup se ravisant, il prend un canif,
coupe le dessin en quatre et jette les morceaux au feu : « c'est décidément un mauvais dessin, dit-il
au marchand ébahi; je ne puis y mettre mon nom. »
11 travaillait de verve et la plupart de ses meilleurs dessins ont été faits en quelques heures.
Mais cette facilité extrême n'était pas simplement un don de nature. Comme tous les vrais artistes,
il passait sa vie à observer. Les témoignages de ses amis ne laissent sur ce point aucun doute.
M. de la Combe, qui a raconté la vie de Charlet, rapporte à cet égard des anecdotes caractéristiques :
« Quand il était, dit-il, sur la piste de quelques-uns de ces types heureux, qui posent si souvent sans
s'en douter devant les artistes de génie, Charlet oubliait engagements pris, promesses faites, tout
enfin jusqu'à l'heure de son dîner. Un jour il était invité chez son capitaine, M. Laffitte, en nombreuse
compagnie. En route il rencontre trois soldats dont les gestes et les physionomies lui promettent
de bonnes études. Charlet les aborde militairement et les convie au cabaret. Là, quelques libations
les lui livrent tout entiers; mais les trois braves, voulant rendre au bourgeois sa politesse, entraînent
dans un autre cabaret leur camarade improvisé. Pendant ce temps l'heure s'écoule, et Charlet
s'aperçoit que celle du dîner a sonné depuis longtemps. Ce jour-là, notre artiste dîna tard, et
sa place resta vide à la table du capitaine ; mais il avait dans la tète quelques nouvelles et bonnes
études. »
Les traits de ce genre abondent dans son histoire. On sait que, quand en 1823
Louis XVIII envoya le duc d'Angoulème pour rétablir Ferdinand VII sur le trône d'Espagne, Charlet
alla s'établir à Bayonne, afin d'étudier la nouvelle armée; neuf ans plus tard, en 1832, il accompagna
son ami, le général de Rigny, dans la campagne d'Anvers. Là, il vécut au milieu des soldats, et à
son retour, il écrivait : « J'ai de bons matériaux; j'ai vu de bonnes choses que tout le monde ne peut
pas voir. » Aussi quand il se mettait à l'œuvre, ses compositions étaient-elles déjà toutes faites
dans sa tète. C'est pour cela qu'elles paraissaient lui coûter si peu de peine.
En 1828, il essaya de Feau-forte, mais ce procédé était encore trop compliqué pour lui. Cela
n'allait pas assez vite. Il y renonça après quinze essais assez malheureux.
Cependant il ne renonça jamais à l'idée de faire de la peinture. Son atelier était rempli d'esquisses
admirables qu'il n'achevait jamais. Son inspiration, très-vive et très-énergique dès l'abord, avait
l'haleine trop courte pour des œuvres aussi longues. Le premier jet était magnifique, mais une fois
cette ardeur dépensée, il ne savait plus que faire, et, pour se venger de son impuissance, il crevait
et déchirait ses todes.