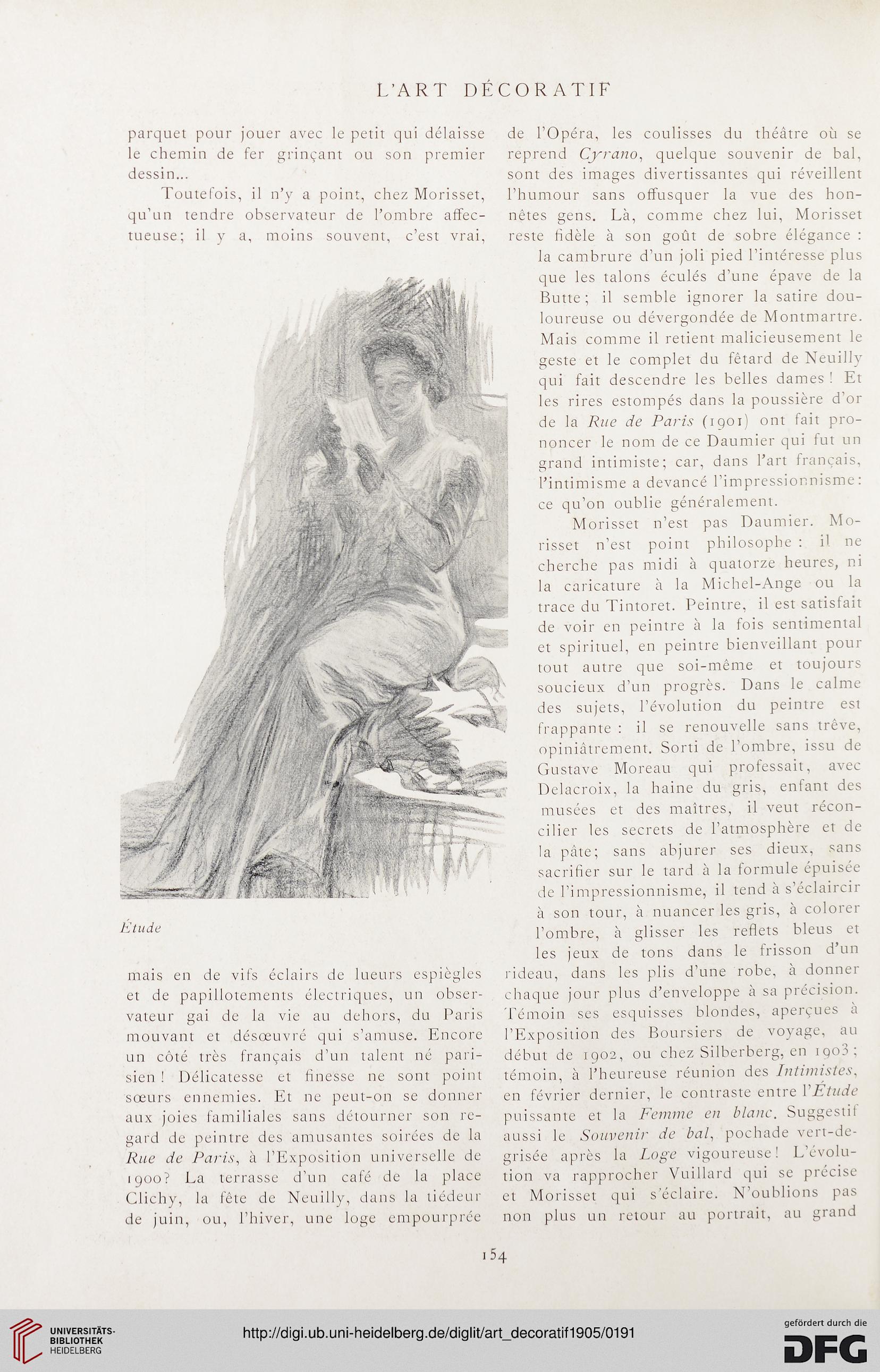L’ART DÉCORATIF
parquet pour jouer avec le petit qui délaisse
le chemin de fer grinçant ou son premier
dessin...
Toutelois, il n’y a point, chez Morisset,
qu’un tendre observateur de l’ombre affec-
tueuse; il y a, moins souvent, c’est vrai,
Etude
mais en de vils éclairs de lueurs espiègles
et de papillotements électriques, un obser-
vateur gai de la vie au dehors, du Paris
mouvant et désœuvré qui s’amuse. Encore
un côté très français d’un talent né pari-
sien ! Délicatesse et finesse ne sont point
sœurs ennemies. Et ne peut-on se donner
aux joies familiales sans détourner son re-
gard de peintre des amusantes soirées de la
Rue de Paris, à l’Exposition universelle de
1900? La terrasse d’un café de la place
Clichy, la fête de Neuilly, dans la tiédeur
de juin, ou, l’hiver, une loge empourprée
de l’Opéra, les coulisses du théâtre où se
reprend Cyrano, quelque souvenir de bal,
sont des images divertissantes qui réveillent
l’humour sans offusquer la vue des hon-
nêtes gens. Là, comme chez lui, Morisset
reste fidèle à son goût de sobre élégance :
la cambrure d’un joli pied l’intéresse plus
que les talons éculés d’une épave de la
Butte ; il semble ignorer la satire dou-
loureuse ou dévergondée de Montmartre.
Mais comme il retient malicieusement le
geste et le complet du fêtard de Neuilly
qui fait descendre les belles dames ! Et
les rires estompés dans la poussière d’or
de la Rue de Paris (1901) ont fait pro-
noncer le nom de ce Daumier qui fut un
grand intimiste; car, dans l’art français,
l’intimisme a devancé l’impressionnisme:
ce qu’on oublie généralement.
Morisset n’est pas Daumier. Mo-
risset n’est point philosophe : il ne
cherche pas midi à quatorze heures, ni
la caricature à la Michel-Ange ou la
trace du Tintoret. Peintre, il est satisfait
de voir en peintre à la fois sentimental
et spirituel, en peintre bienveillant pour
tout autre que soi-même et toujours
soucieux d’un progrès. Dans le calme
des sujets, l’évolution du peintre est
frappante : il se renouvelle sans trêve,
opiniâtrement. Sorti de l’ombre, issu de
Gustave Moreau qui professait, avec
Delacroix, la haine du gris, enfant des
musées et des maîtres, il veut récon-
cilier les secrets de l’atmosphère et de
la pâte; sans abjurer ses dieux, sans
sacrifier sur le tard à la formule épuisée
de l’impressionnisme, il tend à s’éclaircir
à son tour, à nuancer les gris, à colorer
l’ombre, à glisser les reflets bleus et
les jeux de tons dans le frisson d’un
rideau, dans les plis d’une robe, à donner
chaque jour plus d’enveloppe à sa précision.
Témoin ses esquisses blondes, aperçues à
l’Exposition des Boursiers de voyage, au
début de 1902, ou chez Silberberg, en 190?;
témoin, à l’heureuse réunion des Intimistes,
en février dernier, le contraste entre l’Etude
puissante et la Femme en blanc. Suggestif
aussi le Souvenir de bal, pochade vert-de-
grisée après la Loge vigoureuse! L’évolu-
tion va rapprocher Vuillard qui se précise
et Morisset qui s’éclaire. N’oublions pas
non plus un retour au portrait, au grand
parquet pour jouer avec le petit qui délaisse
le chemin de fer grinçant ou son premier
dessin...
Toutelois, il n’y a point, chez Morisset,
qu’un tendre observateur de l’ombre affec-
tueuse; il y a, moins souvent, c’est vrai,
Etude
mais en de vils éclairs de lueurs espiègles
et de papillotements électriques, un obser-
vateur gai de la vie au dehors, du Paris
mouvant et désœuvré qui s’amuse. Encore
un côté très français d’un talent né pari-
sien ! Délicatesse et finesse ne sont point
sœurs ennemies. Et ne peut-on se donner
aux joies familiales sans détourner son re-
gard de peintre des amusantes soirées de la
Rue de Paris, à l’Exposition universelle de
1900? La terrasse d’un café de la place
Clichy, la fête de Neuilly, dans la tiédeur
de juin, ou, l’hiver, une loge empourprée
de l’Opéra, les coulisses du théâtre où se
reprend Cyrano, quelque souvenir de bal,
sont des images divertissantes qui réveillent
l’humour sans offusquer la vue des hon-
nêtes gens. Là, comme chez lui, Morisset
reste fidèle à son goût de sobre élégance :
la cambrure d’un joli pied l’intéresse plus
que les talons éculés d’une épave de la
Butte ; il semble ignorer la satire dou-
loureuse ou dévergondée de Montmartre.
Mais comme il retient malicieusement le
geste et le complet du fêtard de Neuilly
qui fait descendre les belles dames ! Et
les rires estompés dans la poussière d’or
de la Rue de Paris (1901) ont fait pro-
noncer le nom de ce Daumier qui fut un
grand intimiste; car, dans l’art français,
l’intimisme a devancé l’impressionnisme:
ce qu’on oublie généralement.
Morisset n’est pas Daumier. Mo-
risset n’est point philosophe : il ne
cherche pas midi à quatorze heures, ni
la caricature à la Michel-Ange ou la
trace du Tintoret. Peintre, il est satisfait
de voir en peintre à la fois sentimental
et spirituel, en peintre bienveillant pour
tout autre que soi-même et toujours
soucieux d’un progrès. Dans le calme
des sujets, l’évolution du peintre est
frappante : il se renouvelle sans trêve,
opiniâtrement. Sorti de l’ombre, issu de
Gustave Moreau qui professait, avec
Delacroix, la haine du gris, enfant des
musées et des maîtres, il veut récon-
cilier les secrets de l’atmosphère et de
la pâte; sans abjurer ses dieux, sans
sacrifier sur le tard à la formule épuisée
de l’impressionnisme, il tend à s’éclaircir
à son tour, à nuancer les gris, à colorer
l’ombre, à glisser les reflets bleus et
les jeux de tons dans le frisson d’un
rideau, dans les plis d’une robe, à donner
chaque jour plus d’enveloppe à sa précision.
Témoin ses esquisses blondes, aperçues à
l’Exposition des Boursiers de voyage, au
début de 1902, ou chez Silberberg, en 190?;
témoin, à l’heureuse réunion des Intimistes,
en février dernier, le contraste entre l’Etude
puissante et la Femme en blanc. Suggestif
aussi le Souvenir de bal, pochade vert-de-
grisée après la Loge vigoureuse! L’évolu-
tion va rapprocher Vuillard qui se précise
et Morisset qui s’éclaire. N’oublions pas
non plus un retour au portrait, au grand