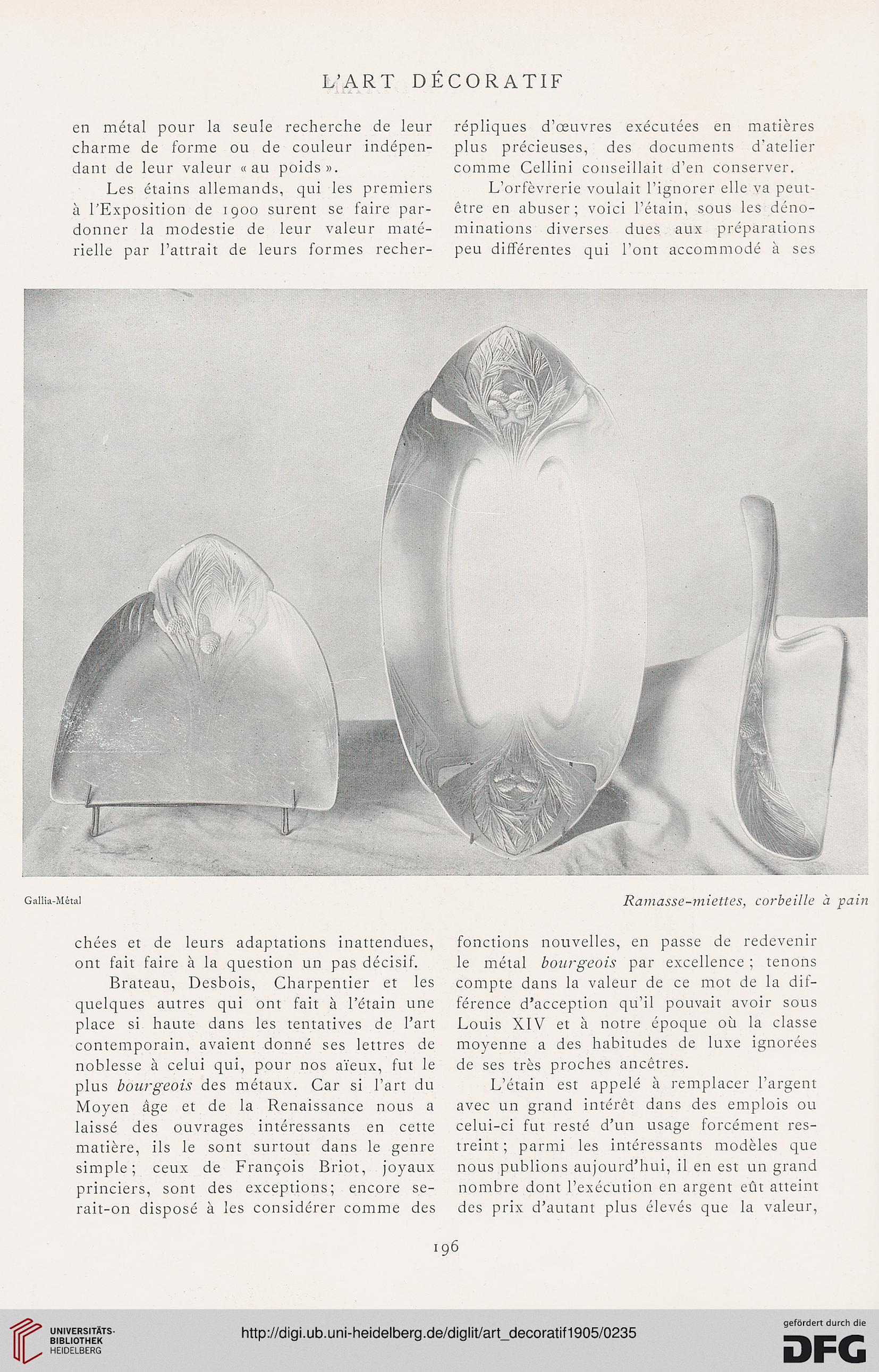L’ART DÉCORATIF
en métal pour la seule recherche de leur
charme de forme ou de couleur indépen-
dant de leur valeur «au poids».
Les étains allemands, qui les premiers
à l’Exposition de igoo surent se faire par-
donner la modestie de leur valeur maté-
rielle par l’attrait de leurs formes recher-
répliques d’œuvres exécutées en matières
plus précieuses, des documents d’atelier
comme Cellini conseillait d’en conserver.
L’orfèvrerie voulait l’ignorer elle va peut-
être en abuser; voici l’étain, sous les déno-
minations diverses dues aux préparations
peu différentes qui l’ont accommodé à ses
chées et de leurs adaptations inattendues,
ont fait faire à la question un pas décisif.
Brateau, Desbois, Charpentier et les
quelques autres qui ont fait à l’étain une
place si haute dans les tentatives de l’art
contemporain, avaient donné ses lettres de
noblesse à celui qui, pour nos aïeux, fut le
plus bourgeois des métaux. Car si l’art du
Moyen âge et de la Renaissance nous a
laissé des ouvrages intéressants en cette
matière, ils le sont surtout dans le genre
simple; ceux de François Briot, joyaux
princiers, sont des exceptions; encore se-
rait-on disposé à les considérer comme des
fonctions nouvelles, en passe de redevenir
le métal bourgeois par excellence ; tenons
compte dans la valeur de ce mot de la dif-
férence d’acception qu’il pouvait avoir sous
Louis XIV et à notre époque où la classe
moyenne a des habitudes de luxe ignorées
de ses très proches ancêtres.
L’étain est appelé à remplacer l’argent
avec un grand intérêt dans des emplois ou
celui-ci fut resté d’un usage forcément res-
treint ; parmi les intéressants modèles que
nous publions aujourd’hui, il en est un grand
nombre dont l’exécution en argent eût atteint
des prix d’autant plus élevés que la valeur,
i g6
en métal pour la seule recherche de leur
charme de forme ou de couleur indépen-
dant de leur valeur «au poids».
Les étains allemands, qui les premiers
à l’Exposition de igoo surent se faire par-
donner la modestie de leur valeur maté-
rielle par l’attrait de leurs formes recher-
répliques d’œuvres exécutées en matières
plus précieuses, des documents d’atelier
comme Cellini conseillait d’en conserver.
L’orfèvrerie voulait l’ignorer elle va peut-
être en abuser; voici l’étain, sous les déno-
minations diverses dues aux préparations
peu différentes qui l’ont accommodé à ses
chées et de leurs adaptations inattendues,
ont fait faire à la question un pas décisif.
Brateau, Desbois, Charpentier et les
quelques autres qui ont fait à l’étain une
place si haute dans les tentatives de l’art
contemporain, avaient donné ses lettres de
noblesse à celui qui, pour nos aïeux, fut le
plus bourgeois des métaux. Car si l’art du
Moyen âge et de la Renaissance nous a
laissé des ouvrages intéressants en cette
matière, ils le sont surtout dans le genre
simple; ceux de François Briot, joyaux
princiers, sont des exceptions; encore se-
rait-on disposé à les considérer comme des
fonctions nouvelles, en passe de redevenir
le métal bourgeois par excellence ; tenons
compte dans la valeur de ce mot de la dif-
férence d’acception qu’il pouvait avoir sous
Louis XIV et à notre époque où la classe
moyenne a des habitudes de luxe ignorées
de ses très proches ancêtres.
L’étain est appelé à remplacer l’argent
avec un grand intérêt dans des emplois ou
celui-ci fut resté d’un usage forcément res-
treint ; parmi les intéressants modèles que
nous publions aujourd’hui, il en est un grand
nombre dont l’exécution en argent eût atteint
des prix d’autant plus élevés que la valeur,
i g6