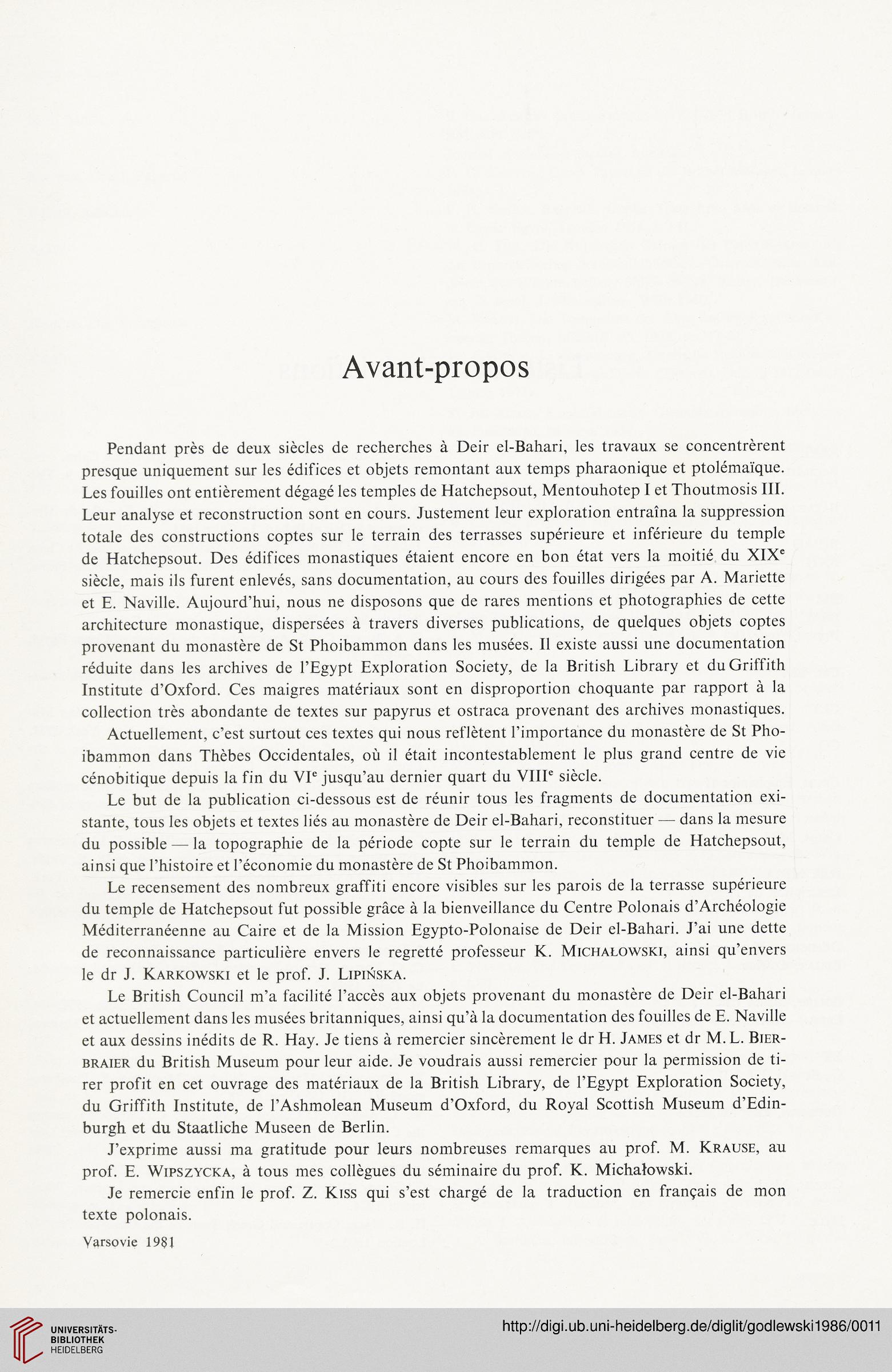Avant-propos
Pendant près de deux siècles de recherches à Deir el-Bahari, les travaux se concentrèrent
presque uniquement sur les édifices et objets remontant aux temps pharaonique et ptolémaïque.
Les fouilles ont entièrement dégagé les temples de Hatchepsout, Mentouhotep L et Thoutmosis III.
Leur analyse et reconstruction sont en cours. Justement leur exploration entraîna la suppression
totale des constructions coptes sur le terrain des terrasses supérieure et inférieure du temple
de Hatchepsout. Des édifices monastiques étaient encore en bon état vers la moitié du XIXe
siècle, mais ils furent enlevés, sans documentation, au cours des fouilles dirigées par A. Mariette
et E. Naville. Aujourd’hui, nous ne disposons que de rares mentions et photographies de cette
architecture monastique, dispersées à travers diverses publications, de quelques objets coptes
provenant du monastère de St Phoibammon dans les musées. II existe aussi une documentation
réduite dans les archives de l’Egypt Exploration Society, de la British Library et duGriffith
Institute d’Oxford. Ces maigres matériaux sont en disproportion choquante par rapport à la
collection très abondante de textes sur papyrus et ostraca provenant des archives monastiques.
Actuellement, c’est surtout ces textes qui nous reflètent l’importance du monastère de St Pho-
ibammon dans Thèbes Occidentales, où il était incontestablement le plus grand centre de vie
cénobitique depuis la fin du VIe jusqu’au dernier quart du VIIIe siècle.
Le but de la publication ci-dessous est de réunir tous les fragments de documentation exi-
stante, tous les objets et textes liés au monastère de Deir el-Bahari, reconstituer — dans la mesure
du possible — la topographie de la période copte sur le terrain du temple de Hatchepsout,
ainsi que l’histoire et l’économie du monastère de St Phoibammon.
Le recensement des nombreux graffiti encore visibles sur les parois de la terrasse supérieure
du temple de Hatchepsout fut possibie grâce à la bienveillance du Centre Polonais d’Archéologie
Méditerranéenne au Caire et de la Mission Egypto-Polonaise de Deir el-Bahari. J’ai une dette
de reconnaissance particulière envers le regretté professeur K. Michalowski, ainsi qu’envers
le dr J. Karkowski et le prof. J. Lipinska.
Le British Council m’a facilité l’accès aux objets provenant du monastère de Deir el-Bahari
et actuellement dans les musées britanniques, ainsi qu’à la documentation des fouilles de E. Naville
et aux dessins inédits de R. Hay. Je tiens à remercier sincèrement le dr H. James et dr M. L. Bier-
braier du British Museum pour leur aide. Je voudrais aussi remercier pour la permission de ti-
rer profit en cet ouvrage des matériaux de la British Library, de l’Egypt Exploration Society,
du Griffith Institute, de l’Ashmolean Museum d’Oxford, du Royal Scottish Museum d’Edin-
burgh et du Staatliche Museen de Berlin.
J’exprime aussi ma gratitude pour leurs nombreuses remarques au prof. M. Krause, au
prof. E. Wipszycka, à tous mes collègues du séminaire du prof. K. Michaîowski.
Je remercie enfin le prof. Z. Kiss qui s’est chargé de la traduction en français de mon
texte polonais.
Varsovie 19§J
Pendant près de deux siècles de recherches à Deir el-Bahari, les travaux se concentrèrent
presque uniquement sur les édifices et objets remontant aux temps pharaonique et ptolémaïque.
Les fouilles ont entièrement dégagé les temples de Hatchepsout, Mentouhotep L et Thoutmosis III.
Leur analyse et reconstruction sont en cours. Justement leur exploration entraîna la suppression
totale des constructions coptes sur le terrain des terrasses supérieure et inférieure du temple
de Hatchepsout. Des édifices monastiques étaient encore en bon état vers la moitié du XIXe
siècle, mais ils furent enlevés, sans documentation, au cours des fouilles dirigées par A. Mariette
et E. Naville. Aujourd’hui, nous ne disposons que de rares mentions et photographies de cette
architecture monastique, dispersées à travers diverses publications, de quelques objets coptes
provenant du monastère de St Phoibammon dans les musées. II existe aussi une documentation
réduite dans les archives de l’Egypt Exploration Society, de la British Library et duGriffith
Institute d’Oxford. Ces maigres matériaux sont en disproportion choquante par rapport à la
collection très abondante de textes sur papyrus et ostraca provenant des archives monastiques.
Actuellement, c’est surtout ces textes qui nous reflètent l’importance du monastère de St Pho-
ibammon dans Thèbes Occidentales, où il était incontestablement le plus grand centre de vie
cénobitique depuis la fin du VIe jusqu’au dernier quart du VIIIe siècle.
Le but de la publication ci-dessous est de réunir tous les fragments de documentation exi-
stante, tous les objets et textes liés au monastère de Deir el-Bahari, reconstituer — dans la mesure
du possible — la topographie de la période copte sur le terrain du temple de Hatchepsout,
ainsi que l’histoire et l’économie du monastère de St Phoibammon.
Le recensement des nombreux graffiti encore visibles sur les parois de la terrasse supérieure
du temple de Hatchepsout fut possibie grâce à la bienveillance du Centre Polonais d’Archéologie
Méditerranéenne au Caire et de la Mission Egypto-Polonaise de Deir el-Bahari. J’ai une dette
de reconnaissance particulière envers le regretté professeur K. Michalowski, ainsi qu’envers
le dr J. Karkowski et le prof. J. Lipinska.
Le British Council m’a facilité l’accès aux objets provenant du monastère de Deir el-Bahari
et actuellement dans les musées britanniques, ainsi qu’à la documentation des fouilles de E. Naville
et aux dessins inédits de R. Hay. Je tiens à remercier sincèrement le dr H. James et dr M. L. Bier-
braier du British Museum pour leur aide. Je voudrais aussi remercier pour la permission de ti-
rer profit en cet ouvrage des matériaux de la British Library, de l’Egypt Exploration Society,
du Griffith Institute, de l’Ashmolean Museum d’Oxford, du Royal Scottish Museum d’Edin-
burgh et du Staatliche Museen de Berlin.
J’exprime aussi ma gratitude pour leurs nombreuses remarques au prof. M. Krause, au
prof. E. Wipszycka, à tous mes collègues du séminaire du prof. K. Michaîowski.
Je remercie enfin le prof. Z. Kiss qui s’est chargé de la traduction en français de mon
texte polonais.
Varsovie 19§J