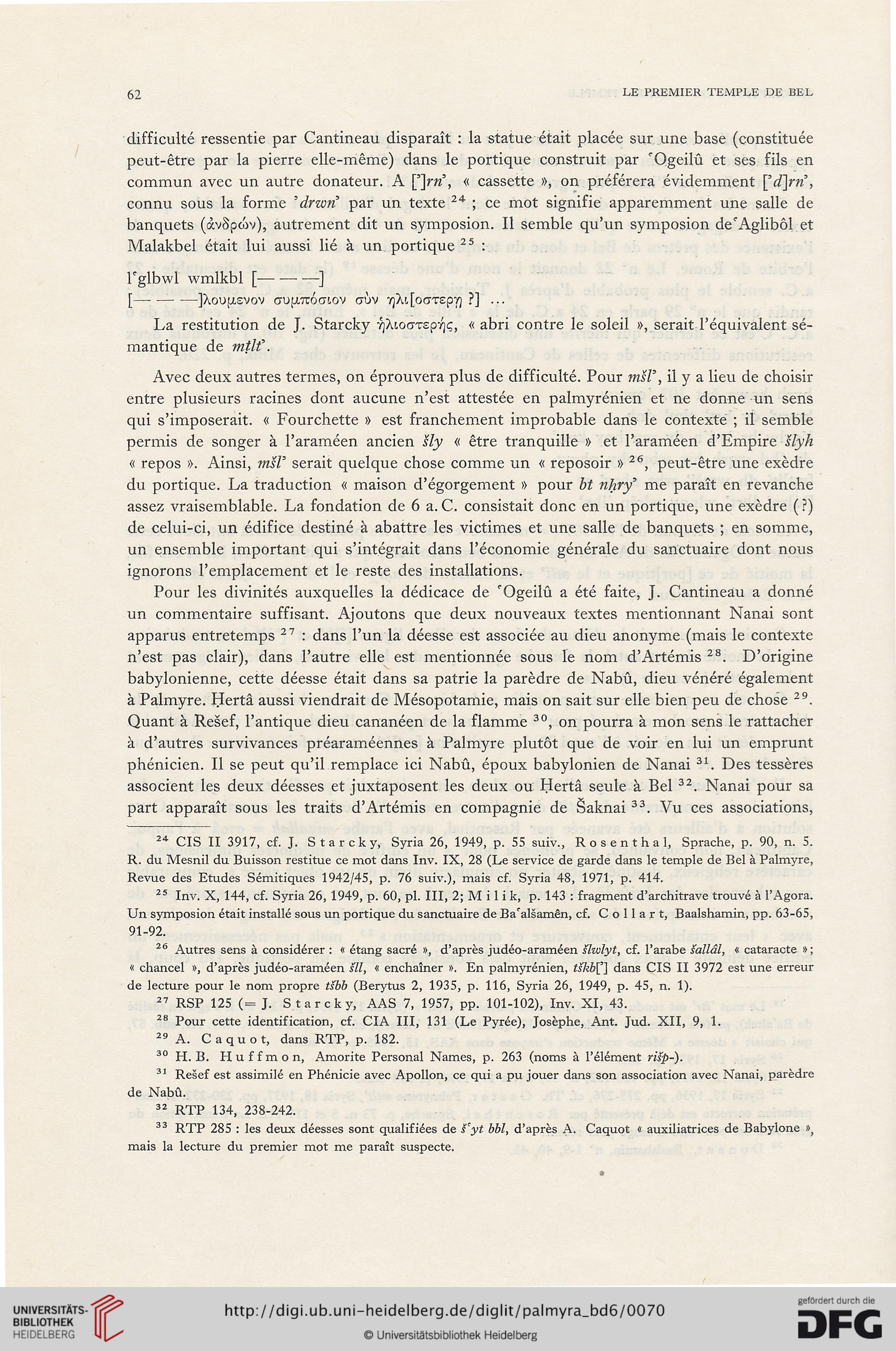62
LE PREMIER TEMPLE DE BEL
difficulté ressentie par Cantineau disparaît : la statue était placée sur une base (constituée
peut-être par la pierre elle-même) dans le portique construit par Ogeilû et ses fils en
commun avec un autre donateur. A [’]?·«’, « cassette », on préférera évidemment [’d]rn,
connu sous la forme ’drwn5 par un texte 24 ; ce mot signifie apparemment une salle de
banquets (άνδρών), autrement dit un symposion. Il semble qu’un symposion de'Aglibôl et
Malakbel était lui aussi lié à un. portique 25 :
l'glbwl wmlkbl [—-—]
[—; — — ]λουμενον συμπόσιον σύν τ)λι[οστερτ) ?] ...
La restitution de J. Starcky ήλιοστερής, «abri contre le soleil », serait l’équivalent sé-
mantique de mtlf.
Avec deux autres termes, on éprouvera plus de difficulté. Pour msF, il y a lieu de choisir
entre plusieurs racines dont aucune n’est attestée en palmyrénien et ne donne un sens
qui s’imposerait. « Fourchette » est franchement improbable dans le contexte ; il semble
permis de songer à l’araméen ancien sly « être tranquille » et Paraméen d’Empirc Ilyh
« repos ». Ainsi, mśF serait quelque chose comme un « reposoir » 26, peut-être une exèdre
du portique. La traduction « maison d’égorgement » pour bt nhry> me paraît en revanche
assez vraisemblable. La fondation de 6 a. C. consistait donc en un portique, une exèdre ( ?)
de celui-ci, un édifice destiné à abattre les victimes et une salle de banquets ; en somme,
un ensemble important qui s’intégrait dans l’économie générale du sanctuaire dont nous
ignorons l’emplacement et le reste des installations.
Pour les divinités auxquelles la dédicace de Ogeilû a été faite, J. Cantineau a donné
un commentaire suffisant. Ajoutons que deux nouveaux textes mentionnant Nanai sont
apparus entretemps 27 : dans l’un la déesse est associée au dieu anonyme (mais le contexte
n’est pas clair), dans l’autre elle est mentionnée sous le nom d’Artémis 2S. D’origine
babylonienne, cette déesse était dans sa patrie la parèdre de Nabû, dieu vénéré également
à Palmyre. Idertâ aussi viendrait de Mésopotamie, mais on sait sur elle bien peu de chose 29.
Quant à Reśef, l’antique dieu cananéen de la flamme 30, on pourra à mon sens le rattacher
à d’autres survivances préaraméennes à Palmyre plutôt que de voir en lui un emprunt
phénicien. Il se peut qu’il remplace ici Nabû, époux babylonien de Nanai 31. Des tessères
associent les deux déesses et juxtaposent les deux ou Hertâ seule à Bel 32. Nanai pour sa
part apparaît sous les traits d’Artémis en compagnie de Saknai 33. Vu ces associations,
24 CIS II 3917, cf. J. S t a r c k y, Syria 26, 1949, p. 55 suiv., Rosenthal, Sprache, p. 90, n. 5.
R. du Mesnil du Buisson restitue ce mot dans Inv. IX, 28 (Le service de garde dans le temple de Bel à Palmyre,
Revue des Etudes Sémitiques 1942/45, p. 76 suiv.), mais cf. Syria 48, 1971, p. 414.
25 Inv. X, 144, cf. Syria 26, 1949, p. 60, pl. III, 2; M i 1 i k, p. 143 : fragment d’architrave trouvé à l’Agora.
Un symposion était installé sous un portique du sanctuaire de Ba'alsamên, cf. C o 11 a r t, Baalshamin, pp. 63-65,
91-92.
26 Autres sens à considérer : « étang sacré », d’après judéo-araméen Slwlyt, cf. l’arabe fallâl, « cataracte » ;
« chancel », d’après judéo-araméen fil, « enchaîner ». En palmyrénien, tskb^~\ dans CIS II 3972 est une erreur
de lecture pour le nom propre tśbb (Berytus 2, 1935, p. 116, Syria 26, 1949, p. 45, n. 1).
27 RSP 125 (= J. Starcky, AAS 7, 1957, pp. 101-102), Inv. XI, 43.
28 Pour cette identification, cf. CIA III, 131 (Le Pyrée), Josephe, Ant. Jud. XII, 9, 1.
29 A. C a q u o t, dans RTP, p. 182.
30 PI. B. H u f f m o n, Amorite Personal Names, p. 263 (noms à l’élément risp-).
31 Reśef est assimilé en Phénicie avec Apollon, ce qui a pu jouer dans son association avec Nanai, parèdre
de Nabû.
32 RTP 134, 238-242.
33 RTP 285 : les deux déesses sont qualifiées de f’yt bbl, d’après A. Caquot « auxiliatrices de Babylone »,
mais la lecture du premier mot me paraît suspecte.
LE PREMIER TEMPLE DE BEL
difficulté ressentie par Cantineau disparaît : la statue était placée sur une base (constituée
peut-être par la pierre elle-même) dans le portique construit par Ogeilû et ses fils en
commun avec un autre donateur. A [’]?·«’, « cassette », on préférera évidemment [’d]rn,
connu sous la forme ’drwn5 par un texte 24 ; ce mot signifie apparemment une salle de
banquets (άνδρών), autrement dit un symposion. Il semble qu’un symposion de'Aglibôl et
Malakbel était lui aussi lié à un. portique 25 :
l'glbwl wmlkbl [—-—]
[—; — — ]λουμενον συμπόσιον σύν τ)λι[οστερτ) ?] ...
La restitution de J. Starcky ήλιοστερής, «abri contre le soleil », serait l’équivalent sé-
mantique de mtlf.
Avec deux autres termes, on éprouvera plus de difficulté. Pour msF, il y a lieu de choisir
entre plusieurs racines dont aucune n’est attestée en palmyrénien et ne donne un sens
qui s’imposerait. « Fourchette » est franchement improbable dans le contexte ; il semble
permis de songer à l’araméen ancien sly « être tranquille » et Paraméen d’Empirc Ilyh
« repos ». Ainsi, mśF serait quelque chose comme un « reposoir » 26, peut-être une exèdre
du portique. La traduction « maison d’égorgement » pour bt nhry> me paraît en revanche
assez vraisemblable. La fondation de 6 a. C. consistait donc en un portique, une exèdre ( ?)
de celui-ci, un édifice destiné à abattre les victimes et une salle de banquets ; en somme,
un ensemble important qui s’intégrait dans l’économie générale du sanctuaire dont nous
ignorons l’emplacement et le reste des installations.
Pour les divinités auxquelles la dédicace de Ogeilû a été faite, J. Cantineau a donné
un commentaire suffisant. Ajoutons que deux nouveaux textes mentionnant Nanai sont
apparus entretemps 27 : dans l’un la déesse est associée au dieu anonyme (mais le contexte
n’est pas clair), dans l’autre elle est mentionnée sous le nom d’Artémis 2S. D’origine
babylonienne, cette déesse était dans sa patrie la parèdre de Nabû, dieu vénéré également
à Palmyre. Idertâ aussi viendrait de Mésopotamie, mais on sait sur elle bien peu de chose 29.
Quant à Reśef, l’antique dieu cananéen de la flamme 30, on pourra à mon sens le rattacher
à d’autres survivances préaraméennes à Palmyre plutôt que de voir en lui un emprunt
phénicien. Il se peut qu’il remplace ici Nabû, époux babylonien de Nanai 31. Des tessères
associent les deux déesses et juxtaposent les deux ou Hertâ seule à Bel 32. Nanai pour sa
part apparaît sous les traits d’Artémis en compagnie de Saknai 33. Vu ces associations,
24 CIS II 3917, cf. J. S t a r c k y, Syria 26, 1949, p. 55 suiv., Rosenthal, Sprache, p. 90, n. 5.
R. du Mesnil du Buisson restitue ce mot dans Inv. IX, 28 (Le service de garde dans le temple de Bel à Palmyre,
Revue des Etudes Sémitiques 1942/45, p. 76 suiv.), mais cf. Syria 48, 1971, p. 414.
25 Inv. X, 144, cf. Syria 26, 1949, p. 60, pl. III, 2; M i 1 i k, p. 143 : fragment d’architrave trouvé à l’Agora.
Un symposion était installé sous un portique du sanctuaire de Ba'alsamên, cf. C o 11 a r t, Baalshamin, pp. 63-65,
91-92.
26 Autres sens à considérer : « étang sacré », d’après judéo-araméen Slwlyt, cf. l’arabe fallâl, « cataracte » ;
« chancel », d’après judéo-araméen fil, « enchaîner ». En palmyrénien, tskb^~\ dans CIS II 3972 est une erreur
de lecture pour le nom propre tśbb (Berytus 2, 1935, p. 116, Syria 26, 1949, p. 45, n. 1).
27 RSP 125 (= J. Starcky, AAS 7, 1957, pp. 101-102), Inv. XI, 43.
28 Pour cette identification, cf. CIA III, 131 (Le Pyrée), Josephe, Ant. Jud. XII, 9, 1.
29 A. C a q u o t, dans RTP, p. 182.
30 PI. B. H u f f m o n, Amorite Personal Names, p. 263 (noms à l’élément risp-).
31 Reśef est assimilé en Phénicie avec Apollon, ce qui a pu jouer dans son association avec Nanai, parèdre
de Nabû.
32 RTP 134, 238-242.
33 RTP 285 : les deux déesses sont qualifiées de f’yt bbl, d’après A. Caquot « auxiliatrices de Babylone »,
mais la lecture du premier mot me paraît suspecte.