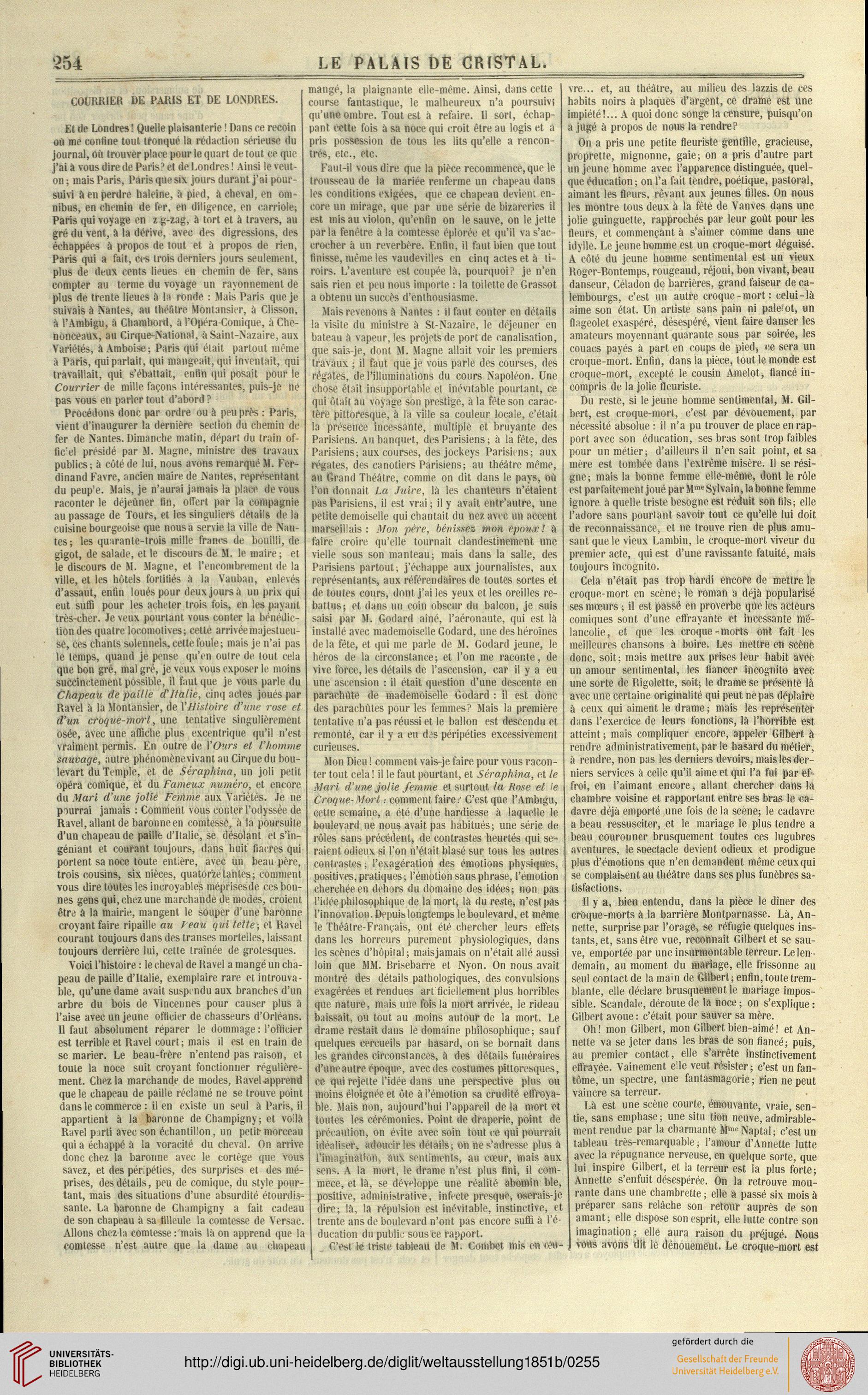254
LE PALAIS DE CRISTAL.
COURRIER DE PARIS ET DE LONDRES.
Et (le Londres! Quelle plaisanterie ! Dans ce recoin
ou me conline tout tronqué la rédaction sérieuse du
journal, où trouver place pour le quart de tout ce que
j'ai à vous dire de Paris ? et de Londres ! Ainsi le veut-
on; mais Paris, Paris que six jours durant j'ai pour-
suivi à en perdre haleine, à pied, achevai, en om-
nibus, en chemin de 1er, en diligence, en carriole;
Paris qui voyage en z g-zag, à tort el à travers, au
gré du vent, à la dérive, avec des digressions, des
échappées à propos de tout et à propos de rien,
Paris qui a fait, ces trois derniers jours seulement,
plus de deux cents lieues en chemin de fer, sans
compter au terme du voyage un rayonnement de
plus de trente lieues à la ronde : Mais Paris que je
suivais à Nantes, au théâtre Montansier, à Clisson,
à l'Ambigu, à Chambord, à l'Opéra-Coniique, à Che-
nonceaux, au Cirque-National, à Saint-Nazaire, aux
Variétés, à Amboise; Paris qui élait partout même
à Paris, qui parlait, qui mangeait, qui inventait, qui
travaillait, qui s'ébattait, enlin qui posait pour le
Courrier de mille façons intéressantes, puis-je ne
pas vous en parler tout d'abord ?
Procédons donc par ordre ou à peu prés : Paris,
vient d'inaugurer la dernière section du chemin de
fer de Nantes. Dimanche matin, départ du train of-
fic'el présidé par M. Magne, ministre des travaux
publics; à côté de lui, nous avons remarqué M. Fer-
dinand Favre, ancien maire de Nantes, représentant
du peup'e. Mais, je n'aurai jamais la place de vous
raconter le déjeûner fin, offert par la compagnie
au passage de Tours, et les singuliers détails de la
cuisine bourgeoise que nous a servie la ville de Nan-
tes; les quarante-trois mille francs de bouilli, de
gigot, de salade, et le discours de M. le maire ; et
le discours de M. .Magne, et l'encombrement de la
ville, et les hôtels fortiliés a la Vauban, enlevés
d'assaut, enfin loués pour deux jours à un prix qui
eut suffi pour les acheter trois fois, en les payant
très-cher. Je veux pourtant vous conter la bénédic-
tion des quatre locomotives; cette arrivée majestueu-
se, ces chants solennels, cette foule; mais je n'ai pas
le temps, quand je pense qu'en outre de tout cela
que bon gré, mal gré, je veux vous exposer le moins
succinctement possible, il faut que je vous parle du
Chapeau de paille d'Italie, cinq actes joués par
Ravel a la Montansier, de VHistoire d'une rose et
d'un croque-mort, une tentative singulièrement
osée, avec une affiche plus excentrique qu'il n'est
vraiment permis. En outre de l'Ours et l'homme
sauvage, autre phénomènevivant au Cirque du bou-
levart du Temple, et de Séraphina, un joli petit
opéra comique, et du Fameux numéro, et encore
du Mari d'une jolie Femme aux Variétés. Je ne
pourrai jamais : Comment vous conter l'odyssée de
Ravel, allant de baronne en comtesse, à la poursuite
d'un chapeau de paille d'Italie, se désolant els'in-
géniant et courant toujours, dans huit fiacres qui
portent sa noce toute entière, avec un beau père,
trois cousins, six nièces, quatorzelantes; comment
vous dire toutes les incroyables méprisesde ces bon-
nes gens qui, chez une marchande de modes, croient
être à la mairie, mangent le souper d'une baronne
croyant faire ripaille au l'eau qui tette-, et Ravel
courant toujours dans des transes mortelles, laissant
toujours derrière lui, cette [rainée de grotesques.
Voici l'histoire : le cheval de Ravel a mangé un cha-
peau de paille d'Italie, exemplaire rare et introuva-
ble, qu'une dame avait suspendu aux branches d'un
arbre du bois de Vincennes pour causer plus à
l'aise avec un jeune officier de chasseurs d'Orléans.
Il faut absolument réparer le dommage : l'officier
est terrible et Ravel court; mais d est en train de
se marier. Le beau-frère n'entend pas raison, et
toute la noce suit croyant fonctionner régulière-
ment. Chez la marchande de modes, Ravel-apprend
que le chapeau de paille réclamé ne se trouve point
dans le commerce : il en existe un seul à Paris, il
appartient à la baronne de Champigny; et voilà
Ravel p:irti avec son échantillon, un petit- morceau
qui a échappé à la voracité du cheval. On arrive
donc chez la baronne avec le cortège que vous
savez, et des péripéties, des surprises et des mé-
prises, des détails, peu de comique, du style pour-
tant, mais des situations d'une absurdité étourdis-
sante. La baronne de Champigny a fait cadeau
de son chapeau à sa filleule la comtesse de Versac.
Allons chez la comtesse : mais là on apprend que la
comtesse n'est autre que la dame au chapeau
mangé, la plaignante elle-même. Ainsi, dans cette
course fantastique, le malheureux n'a poursuivi
qu'une ombre. Tout est à refaire. Il sort, échap-
pant cette fois à sa noce qui croit être au logis et a
pris possession de tous les lits qu'elle a rencon-
trés, etc., etc.
Faut-il vous dire que la pièce recommence, que le
trousseau de la mariée renferme un chapeau dans
les conditions exigées, que ce chapeau devient en-
core un mirage, que par une série de bizareries il
est mis au violon, qu'enfin on le sauve, on le jette
par la fenêtre a la comtesse éplorée et qu'il va s'ac-
crocher à un réverbère. Enfin, il faut bien que tout
finisse, même les vaudevilles en cinq actes et à ti-
roirs. L'aventure est coupée là, pourquoi? je n'en
sais rien et peu nous importe : la toilette de Grassot
a obtenu un succès d'enthousiasme.
Mais revenons à Nantes : il faut conter en détails
la visite du ministre à St-Nazaire, le déjeuner en
bateau à vapeur, les projets de port de canalisation,
que sais-je, dont M. Magne allait voir les premiers
travaux ; il faut que je vous parle des courses, des
régates, del'illuminations du cours Napoléon. Une
chose était insupportable et inévitable pourtant, ce
qui ôlait au voyage son prestige, à la fête son carac-
tère pittoresque, à la ville sa couleur locale, c'était
la présence incessante, multiple et bruyante des
Parisiens. Au banquet, des Parisiens ; à la fête, des
Parisiens; aux courses, des jockeys Parisiens; aux
régates, des canotiers Parisiens; au théâtre même,
au Grand Théâtre, comme on dit dans le pays, où
l'on donnait La Mire, là les chanteurs n'étaient
pas Parisiens, il est vrai ; il y avait entr'autre, une
petite demoiselle qui chantait du nez avec un accent
marseillais: Mon père, bénissez- mon époux: à
faire croire qu'elle tournait clandestinement une
vielle sous son manteau; mais dans la salle, des
Parisiens partout; j'échappe aux journalistes, aux
représentants, aux référendaires de toutes sortes et
de toutes cours, dont j'ai les yeux et les oreilles re-
battus; et dans un coin obscur du balcon, je suis
saisi par M. Godard aine, l'aéronàute, qui est là
installé avec mademoiselle Godard, une des héroïnes
de la fête, et qui me parle de M. Godard jeune, le
héros de la circonstance; et l'on me raconte, de
vive force, les détails de l'ascension, car il y a eu
une ascension : il était question d'une descente en
parachute de mademoiselle Godard : il est donc
des parachutes pour les femmes? Mais la première
tentative n'a pas réussi et le ballon est descendu et
remonté, car il y a eu dis péripéties excessivement
curieuses.
Mon Dieu ! comment vais-je faire pour vous racon-
ter tout cela ! il le faut pourtant, et Séraphina, et le
Mari d'une jolie femme et surtout la Rose et le
Croque-Mort.- comment faire? C'est que l'Ambigu,
cette semaine, a été d'une hardiesse à laquelle le
boulevard ne nous avait pas habitués; une série de
rôles sans précédent, de contrastes heurtés qui se-
raient odieux si l'on n'était blasé sur tous les autres
contrastes ; l'exagération des émotions physiques,
positives, pratiques ; l'émotion sans phrase, l'émotion
cherchée en dehors du domaine des idées; non pas
l'idée philosophique de la mort, là du reste, n'est pas
l'innovation. Depuis longtemps le boulevard, et même
le Théâtre-Français, ont été chercher leurs effets
dans les horreurs purement physiologiques, dans
les scènes d'hôpital ; maisjamais on n'était allé aussi
loin que MM. Brisebarre et Nyon. On nous avait
montré des détails pathologiques, des convulsions
exagérées et rendues art ficiellement plus horribles
que nature, mais une fois la mort arrivée, le rideau
baissait, ou tout au moins autour de la mort. Le
drame restait dans le domaine philosophique; sauf
quelques cercueils par hasard, on se bornait dans
les grandes circonstances, à des détails funéraires
d'une autre époque, avec des costumes pittoresques,
ce qui rejelte l'idée dans une perspective plus ou
moins éloignée et ôte à l'émotion sa crudité effroya-
ble. Mais non, aujourd'hui l'appareil de la mort et
toutes les cérémonies. Point de draperie, point de
précaution, on évite avec soin tout ce qui pourrait
idéaliser, adoucir les détails; on ne s'adresse plus à
l'imagination, aux sentiments, au cœur, mais aux
sens. A la mort, le drame n'est plus fini, il com-
mece, et là, se développe une réalité ahomin ble,
positive, administrative, infecte presque, oserais-je
dire; là, la répulsion est inévitable, instinctive, et
trente ans de boulevard n'ont pas encore suffi à l'é-
ducation du publie sous Ce rapport.
C'est le triste tableau de M. Comnet mis en 'Ou-
vre... et, au théâtre, au milieu des lazzis de ces
habits noirs à plaques d'argent, ce drame est une
impiété!... A quoi donc songe la censure, puisqu'on
a jugé à propos de nous la rendre?
On a pris une petite fleuriste gentille, gracieuse,
proprette, mignonne, gaie; on a pris d'autre part
un jeune homme avec l'apparence distinguée, quel-
que éducation ; on l'a fait tendre, poétique, pastoral,
aimant les fleurs, rêvant aux jeunes tilles. On nous
les montre tous deux à la fête de Vanves dans une
jolie guinguette, rapprochés par leur goût pour les
fleurs, et commençant à s'aimer comme dans une
idylle. Le jeune homme est un croque-mort déguisé.
A côté du jeune homme sentimental est un vieux
Roger-Bontemps, rougeaud, réjoui, bon vivant, beau
danseur, Céladon de barrières, grand faiseur de ca-
lembourgs, c'est un autre croque-mort: celui-là
aime son état. Un artiste sans pain ni pale'ot, un
flageolet exaspéré, désespéré, vient faire danser les
amateurs moyennant quarante sous par soirée, les
couacs payés à part en coups de pied, ce sera un
croque-mort. Enfin, dans la pièce, tout le monde est
croque-mort, excepté le cousin Amelot, fiancé in-
compris de la jolie fleuriste.
Du reste, si le jeune homme sentimental, M. Gil-
bert, est croque-mort, c'est par dévouement, par
nécessité absolue : il n'a pu trouver de place en rap-
port avec son éducation, ses bras sont trop faibles
pour un métier; d'ailleurs il n'en sait point, et sa
mère est tombée dans l'extrême misère. Il se rési-
gne; mais la bonne femme elle-même, dont le rôle
est parfaitement joué parMmeSylvain, la bonne femme
ignore à quelle triste besogne est réduit son fils ; elle
l'adore sans pourtant savoir tout ce qu'elle lui doit
de reconnaissance, et ne trouve rien de plus amu-
sant que le vieux Lambin, le croque-mort viveur du
premier acte, qui est d'une ravissante fatuité, mais
toujours incognito.
Cela n'était pas trop hardi encore de mettre le
croque-mort en scène; le roman a déjà popularisé
ses moeurs ; il est passé en proverbe que les acteurs
comiques sont d'une effrayante et incessante mé-
lancolie, et que les croque-morts ont fait les
meilleures chansons à boire. Les mettre en scène
donc, soit; mais mettre aux prises leur habit avec
un amour sentimental, les fiancer incognito avec
une sorte de Rigolette, soit; le drame se présente là
avec une certaine originalité qui peut ne pas déplaire
à ceux qui aiment le drame ; mais les représenta-
dans l'exercice de leurs fonctions, là l'horrible est
atteint ; mais compliquer encore, appeler Gilbert à
rendre administrativement, par le hasard du métier,
à rendre, non pas les derniers devoirs, mais les der-
niers services à celle qu'il aime et qui l'a fui par ef-
froi, en l'aimant encore, allant chercher dans la
chambre voisine et rapportant entre ses bras le ca-
davre déjà emporté une fois de la scène; le cadavre
a beau ressusciter, et le mariage le plus tendre a
beau couronner brusquement toutes ces lugubres
aventures, le soectacle devient odieux et prodigue
plus d'émotions que n'en demandent même ceux qui
se complaisent au théâtre dans ses plus funèbres sa-
tisfactions.
Il y a, bien entendu, dans la pièce le dîner des
croque-morts à la barrière Montparnasse. Là, An-
nette, surprise par l'orage, se réfugie quelques ins-
tants, et, sans être vue, reconnaît Gilbert et se sau-
ve, emportée par une insurmontable terreur. Le len-
demain, au moment du mariage, elle frissonne au
seul contact de la main de Gilbert; enfin, toute trem-
blante, elle déclare brusquement le mariage impos-
sible. Scandale, déroute de là noce ; on s'explique :
Gilbert avoue : c'était pour sauver sa mère.
Oh! mon Gilbert, mon Gilbert bien-aimé! et An-
nette va se jeter dans les bras de son fiancé; puis,
au premier contact, elle s'arrête instinctivement
effrayée. Vainement elle veut résister; c'est un fan-
tôme, un spectre, une fantasmagorie; rien ne peut
vaincre sa terreur.
Là est une scène courte, émouvante, vraie, sen-
tie, sans emphase ; une situ tion neuve, admirable-
ment rendue par la charmante M^Naptal; c'est un
tableau très-remarquable; l'amour d'Annette lutte
avec la répugnance nerveuse, en quelque sorte, que
lui inspire Gilbert, et la terreur est la plus forte;
Annetle s'enfuit désespérée. On la retrouve mou-
rante dans une chambrette ; elle a passé six mois à
préparer sans relâche son retour auprès de son
amant; elle dispose son esprit, elle lutte contre son
imagination ; elle aura raison du préjugé. Nous
vous avons dit le dénouement. Le croque-mort est
LE PALAIS DE CRISTAL.
COURRIER DE PARIS ET DE LONDRES.
Et (le Londres! Quelle plaisanterie ! Dans ce recoin
ou me conline tout tronqué la rédaction sérieuse du
journal, où trouver place pour le quart de tout ce que
j'ai à vous dire de Paris ? et de Londres ! Ainsi le veut-
on; mais Paris, Paris que six jours durant j'ai pour-
suivi à en perdre haleine, à pied, achevai, en om-
nibus, en chemin de 1er, en diligence, en carriole;
Paris qui voyage en z g-zag, à tort el à travers, au
gré du vent, à la dérive, avec des digressions, des
échappées à propos de tout et à propos de rien,
Paris qui a fait, ces trois derniers jours seulement,
plus de deux cents lieues en chemin de fer, sans
compter au terme du voyage un rayonnement de
plus de trente lieues à la ronde : Mais Paris que je
suivais à Nantes, au théâtre Montansier, à Clisson,
à l'Ambigu, à Chambord, à l'Opéra-Coniique, à Che-
nonceaux, au Cirque-National, à Saint-Nazaire, aux
Variétés, à Amboise; Paris qui élait partout même
à Paris, qui parlait, qui mangeait, qui inventait, qui
travaillait, qui s'ébattait, enlin qui posait pour le
Courrier de mille façons intéressantes, puis-je ne
pas vous en parler tout d'abord ?
Procédons donc par ordre ou à peu prés : Paris,
vient d'inaugurer la dernière section du chemin de
fer de Nantes. Dimanche matin, départ du train of-
fic'el présidé par M. Magne, ministre des travaux
publics; à côté de lui, nous avons remarqué M. Fer-
dinand Favre, ancien maire de Nantes, représentant
du peup'e. Mais, je n'aurai jamais la place de vous
raconter le déjeûner fin, offert par la compagnie
au passage de Tours, et les singuliers détails de la
cuisine bourgeoise que nous a servie la ville de Nan-
tes; les quarante-trois mille francs de bouilli, de
gigot, de salade, et le discours de M. le maire ; et
le discours de M. .Magne, et l'encombrement de la
ville, et les hôtels fortiliés a la Vauban, enlevés
d'assaut, enfin loués pour deux jours à un prix qui
eut suffi pour les acheter trois fois, en les payant
très-cher. Je veux pourtant vous conter la bénédic-
tion des quatre locomotives; cette arrivée majestueu-
se, ces chants solennels, cette foule; mais je n'ai pas
le temps, quand je pense qu'en outre de tout cela
que bon gré, mal gré, je veux vous exposer le moins
succinctement possible, il faut que je vous parle du
Chapeau de paille d'Italie, cinq actes joués par
Ravel a la Montansier, de VHistoire d'une rose et
d'un croque-mort, une tentative singulièrement
osée, avec une affiche plus excentrique qu'il n'est
vraiment permis. En outre de l'Ours et l'homme
sauvage, autre phénomènevivant au Cirque du bou-
levart du Temple, et de Séraphina, un joli petit
opéra comique, et du Fameux numéro, et encore
du Mari d'une jolie Femme aux Variétés. Je ne
pourrai jamais : Comment vous conter l'odyssée de
Ravel, allant de baronne en comtesse, à la poursuite
d'un chapeau de paille d'Italie, se désolant els'in-
géniant et courant toujours, dans huit fiacres qui
portent sa noce toute entière, avec un beau père,
trois cousins, six nièces, quatorzelantes; comment
vous dire toutes les incroyables méprisesde ces bon-
nes gens qui, chez une marchande de modes, croient
être à la mairie, mangent le souper d'une baronne
croyant faire ripaille au l'eau qui tette-, et Ravel
courant toujours dans des transes mortelles, laissant
toujours derrière lui, cette [rainée de grotesques.
Voici l'histoire : le cheval de Ravel a mangé un cha-
peau de paille d'Italie, exemplaire rare et introuva-
ble, qu'une dame avait suspendu aux branches d'un
arbre du bois de Vincennes pour causer plus à
l'aise avec un jeune officier de chasseurs d'Orléans.
Il faut absolument réparer le dommage : l'officier
est terrible et Ravel court; mais d est en train de
se marier. Le beau-frère n'entend pas raison, et
toute la noce suit croyant fonctionner régulière-
ment. Chez la marchande de modes, Ravel-apprend
que le chapeau de paille réclamé ne se trouve point
dans le commerce : il en existe un seul à Paris, il
appartient à la baronne de Champigny; et voilà
Ravel p:irti avec son échantillon, un petit- morceau
qui a échappé à la voracité du cheval. On arrive
donc chez la baronne avec le cortège que vous
savez, et des péripéties, des surprises et des mé-
prises, des détails, peu de comique, du style pour-
tant, mais des situations d'une absurdité étourdis-
sante. La baronne de Champigny a fait cadeau
de son chapeau à sa filleule la comtesse de Versac.
Allons chez la comtesse : mais là on apprend que la
comtesse n'est autre que la dame au chapeau
mangé, la plaignante elle-même. Ainsi, dans cette
course fantastique, le malheureux n'a poursuivi
qu'une ombre. Tout est à refaire. Il sort, échap-
pant cette fois à sa noce qui croit être au logis et a
pris possession de tous les lits qu'elle a rencon-
trés, etc., etc.
Faut-il vous dire que la pièce recommence, que le
trousseau de la mariée renferme un chapeau dans
les conditions exigées, que ce chapeau devient en-
core un mirage, que par une série de bizareries il
est mis au violon, qu'enfin on le sauve, on le jette
par la fenêtre a la comtesse éplorée et qu'il va s'ac-
crocher à un réverbère. Enfin, il faut bien que tout
finisse, même les vaudevilles en cinq actes et à ti-
roirs. L'aventure est coupée là, pourquoi? je n'en
sais rien et peu nous importe : la toilette de Grassot
a obtenu un succès d'enthousiasme.
Mais revenons à Nantes : il faut conter en détails
la visite du ministre à St-Nazaire, le déjeuner en
bateau à vapeur, les projets de port de canalisation,
que sais-je, dont M. Magne allait voir les premiers
travaux ; il faut que je vous parle des courses, des
régates, del'illuminations du cours Napoléon. Une
chose était insupportable et inévitable pourtant, ce
qui ôlait au voyage son prestige, à la fête son carac-
tère pittoresque, à la ville sa couleur locale, c'était
la présence incessante, multiple et bruyante des
Parisiens. Au banquet, des Parisiens ; à la fête, des
Parisiens; aux courses, des jockeys Parisiens; aux
régates, des canotiers Parisiens; au théâtre même,
au Grand Théâtre, comme on dit dans le pays, où
l'on donnait La Mire, là les chanteurs n'étaient
pas Parisiens, il est vrai ; il y avait entr'autre, une
petite demoiselle qui chantait du nez avec un accent
marseillais: Mon père, bénissez- mon époux: à
faire croire qu'elle tournait clandestinement une
vielle sous son manteau; mais dans la salle, des
Parisiens partout; j'échappe aux journalistes, aux
représentants, aux référendaires de toutes sortes et
de toutes cours, dont j'ai les yeux et les oreilles re-
battus; et dans un coin obscur du balcon, je suis
saisi par M. Godard aine, l'aéronàute, qui est là
installé avec mademoiselle Godard, une des héroïnes
de la fête, et qui me parle de M. Godard jeune, le
héros de la circonstance; et l'on me raconte, de
vive force, les détails de l'ascension, car il y a eu
une ascension : il était question d'une descente en
parachute de mademoiselle Godard : il est donc
des parachutes pour les femmes? Mais la première
tentative n'a pas réussi et le ballon est descendu et
remonté, car il y a eu dis péripéties excessivement
curieuses.
Mon Dieu ! comment vais-je faire pour vous racon-
ter tout cela ! il le faut pourtant, et Séraphina, et le
Mari d'une jolie femme et surtout la Rose et le
Croque-Mort.- comment faire? C'est que l'Ambigu,
cette semaine, a été d'une hardiesse à laquelle le
boulevard ne nous avait pas habitués; une série de
rôles sans précédent, de contrastes heurtés qui se-
raient odieux si l'on n'était blasé sur tous les autres
contrastes ; l'exagération des émotions physiques,
positives, pratiques ; l'émotion sans phrase, l'émotion
cherchée en dehors du domaine des idées; non pas
l'idée philosophique de la mort, là du reste, n'est pas
l'innovation. Depuis longtemps le boulevard, et même
le Théâtre-Français, ont été chercher leurs effets
dans les horreurs purement physiologiques, dans
les scènes d'hôpital ; maisjamais on n'était allé aussi
loin que MM. Brisebarre et Nyon. On nous avait
montré des détails pathologiques, des convulsions
exagérées et rendues art ficiellement plus horribles
que nature, mais une fois la mort arrivée, le rideau
baissait, ou tout au moins autour de la mort. Le
drame restait dans le domaine philosophique; sauf
quelques cercueils par hasard, on se bornait dans
les grandes circonstances, à des détails funéraires
d'une autre époque, avec des costumes pittoresques,
ce qui rejelte l'idée dans une perspective plus ou
moins éloignée et ôte à l'émotion sa crudité effroya-
ble. Mais non, aujourd'hui l'appareil de la mort et
toutes les cérémonies. Point de draperie, point de
précaution, on évite avec soin tout ce qui pourrait
idéaliser, adoucir les détails; on ne s'adresse plus à
l'imagination, aux sentiments, au cœur, mais aux
sens. A la mort, le drame n'est plus fini, il com-
mece, et là, se développe une réalité ahomin ble,
positive, administrative, infecte presque, oserais-je
dire; là, la répulsion est inévitable, instinctive, et
trente ans de boulevard n'ont pas encore suffi à l'é-
ducation du publie sous Ce rapport.
C'est le triste tableau de M. Comnet mis en 'Ou-
vre... et, au théâtre, au milieu des lazzis de ces
habits noirs à plaques d'argent, ce drame est une
impiété!... A quoi donc songe la censure, puisqu'on
a jugé à propos de nous la rendre?
On a pris une petite fleuriste gentille, gracieuse,
proprette, mignonne, gaie; on a pris d'autre part
un jeune homme avec l'apparence distinguée, quel-
que éducation ; on l'a fait tendre, poétique, pastoral,
aimant les fleurs, rêvant aux jeunes tilles. On nous
les montre tous deux à la fête de Vanves dans une
jolie guinguette, rapprochés par leur goût pour les
fleurs, et commençant à s'aimer comme dans une
idylle. Le jeune homme est un croque-mort déguisé.
A côté du jeune homme sentimental est un vieux
Roger-Bontemps, rougeaud, réjoui, bon vivant, beau
danseur, Céladon de barrières, grand faiseur de ca-
lembourgs, c'est un autre croque-mort: celui-là
aime son état. Un artiste sans pain ni pale'ot, un
flageolet exaspéré, désespéré, vient faire danser les
amateurs moyennant quarante sous par soirée, les
couacs payés à part en coups de pied, ce sera un
croque-mort. Enfin, dans la pièce, tout le monde est
croque-mort, excepté le cousin Amelot, fiancé in-
compris de la jolie fleuriste.
Du reste, si le jeune homme sentimental, M. Gil-
bert, est croque-mort, c'est par dévouement, par
nécessité absolue : il n'a pu trouver de place en rap-
port avec son éducation, ses bras sont trop faibles
pour un métier; d'ailleurs il n'en sait point, et sa
mère est tombée dans l'extrême misère. Il se rési-
gne; mais la bonne femme elle-même, dont le rôle
est parfaitement joué parMmeSylvain, la bonne femme
ignore à quelle triste besogne est réduit son fils ; elle
l'adore sans pourtant savoir tout ce qu'elle lui doit
de reconnaissance, et ne trouve rien de plus amu-
sant que le vieux Lambin, le croque-mort viveur du
premier acte, qui est d'une ravissante fatuité, mais
toujours incognito.
Cela n'était pas trop hardi encore de mettre le
croque-mort en scène; le roman a déjà popularisé
ses moeurs ; il est passé en proverbe que les acteurs
comiques sont d'une effrayante et incessante mé-
lancolie, et que les croque-morts ont fait les
meilleures chansons à boire. Les mettre en scène
donc, soit; mais mettre aux prises leur habit avec
un amour sentimental, les fiancer incognito avec
une sorte de Rigolette, soit; le drame se présente là
avec une certaine originalité qui peut ne pas déplaire
à ceux qui aiment le drame ; mais les représenta-
dans l'exercice de leurs fonctions, là l'horrible est
atteint ; mais compliquer encore, appeler Gilbert à
rendre administrativement, par le hasard du métier,
à rendre, non pas les derniers devoirs, mais les der-
niers services à celle qu'il aime et qui l'a fui par ef-
froi, en l'aimant encore, allant chercher dans la
chambre voisine et rapportant entre ses bras le ca-
davre déjà emporté une fois de la scène; le cadavre
a beau ressusciter, et le mariage le plus tendre a
beau couronner brusquement toutes ces lugubres
aventures, le soectacle devient odieux et prodigue
plus d'émotions que n'en demandent même ceux qui
se complaisent au théâtre dans ses plus funèbres sa-
tisfactions.
Il y a, bien entendu, dans la pièce le dîner des
croque-morts à la barrière Montparnasse. Là, An-
nette, surprise par l'orage, se réfugie quelques ins-
tants, et, sans être vue, reconnaît Gilbert et se sau-
ve, emportée par une insurmontable terreur. Le len-
demain, au moment du mariage, elle frissonne au
seul contact de la main de Gilbert; enfin, toute trem-
blante, elle déclare brusquement le mariage impos-
sible. Scandale, déroute de là noce ; on s'explique :
Gilbert avoue : c'était pour sauver sa mère.
Oh! mon Gilbert, mon Gilbert bien-aimé! et An-
nette va se jeter dans les bras de son fiancé; puis,
au premier contact, elle s'arrête instinctivement
effrayée. Vainement elle veut résister; c'est un fan-
tôme, un spectre, une fantasmagorie; rien ne peut
vaincre sa terreur.
Là est une scène courte, émouvante, vraie, sen-
tie, sans emphase ; une situ tion neuve, admirable-
ment rendue par la charmante M^Naptal; c'est un
tableau très-remarquable; l'amour d'Annette lutte
avec la répugnance nerveuse, en quelque sorte, que
lui inspire Gilbert, et la terreur est la plus forte;
Annetle s'enfuit désespérée. On la retrouve mou-
rante dans une chambrette ; elle a passé six mois à
préparer sans relâche son retour auprès de son
amant; elle dispose son esprit, elle lutte contre son
imagination ; elle aura raison du préjugé. Nous
vous avons dit le dénouement. Le croque-mort est