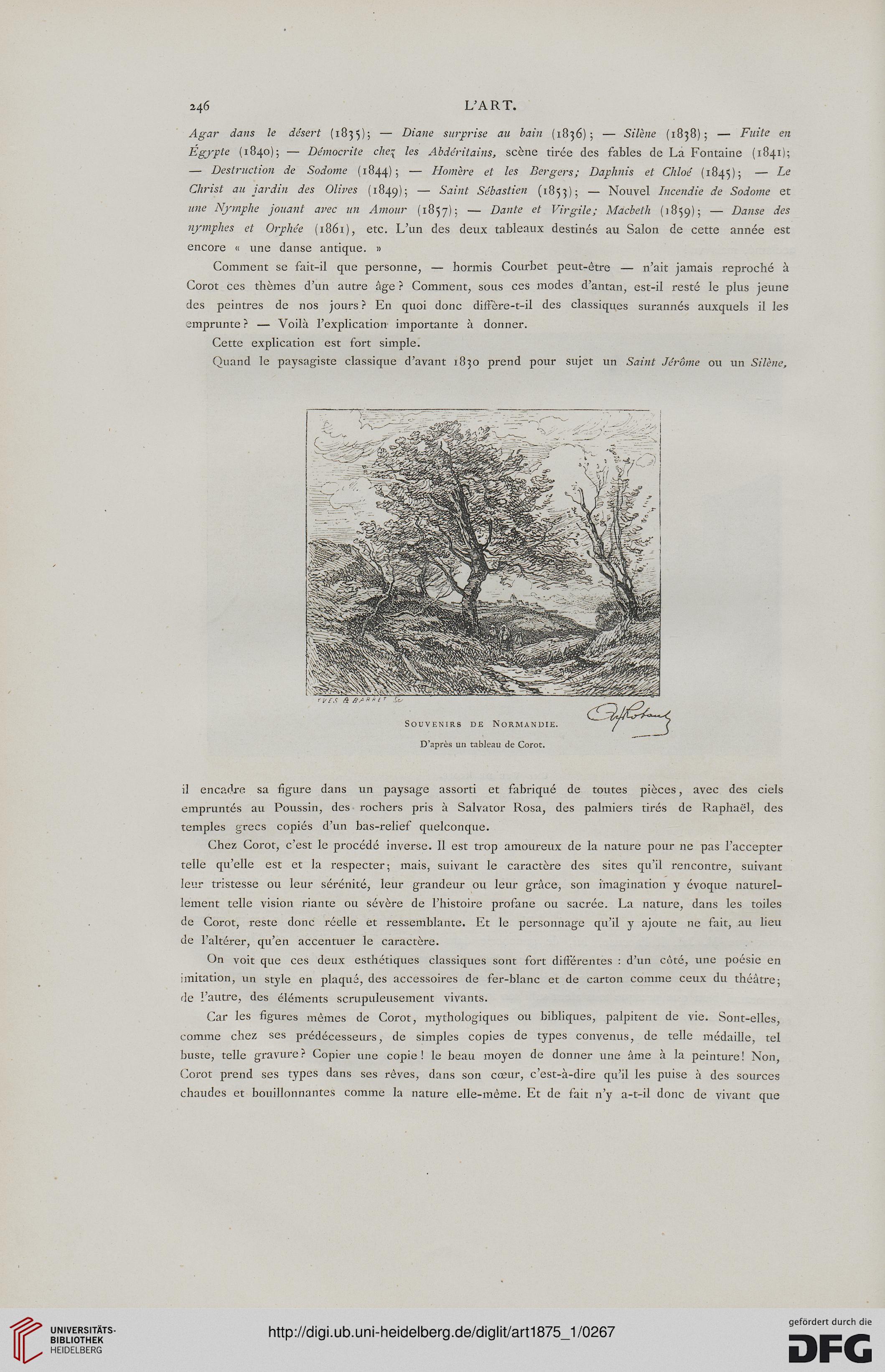246 L'ART.
Agar dans le désert (1835); — Diane surprise au bain (1836); — Silène (1838); — Fuite en
Egypte (1840); — Démocrite che% les Abdéritains, scène tirée des fables de La Fontaine (1841);
— Destruction de Sodome (1844); — Homère et les Bergers; Daphnis et Chloé (1845); — Le
Christ au jardin des Olives (1849); — Saint Sébastien (1853); — Nouvel Incendie de Sodome et
une Nymphe jouant avec un Amour (1857); — Dante et Virgile; Macbeth (1859); — Danse des
nymphes et Orphée (1861), etc. L'un des deux tableaux destinés au Salon de cette année est
encore « une danse antique. »
Comment se fait-il que personne, — hormis Courbet peut-être — n'ait jamais reproché à
Corot ces thèmes d'un autre âge ? Comment, sous ces modes d'antan, est-il resté le plus jeune
des peintres de nos jours ? En quoi donc diffère-t-il des classiques surannés auxquels il les
emprunte ? — Voilà l'explication importante à donner.
Cette explication est fort simple.
Quand le paysagiste classique d'avant 1830 prend pour sujet un Saint Jérôme ou un Silène,
D'après un tableau de Corot.
il encadre sa figure dans un paysage assorti et fabriqué de toutes pièces, avec des ciels
empruntés au Poussin, des rochers pris à Salvator Rosa, des palmiers tirés de Raphaël, des
temples grecs copiés d'un bas-relief quelconque.
Chez Corot, c'est le procédé inverse. Il est trop amoureux de la nature pour ne pas l'accepter
telle qu'elle est et la respecter; mais, suivant le caractère des sites qu'il rencontre, suivant
leur tristesse ou leur sérénité, leur grandeur ou leur grâce, son imagination y évoque naturel-
lement telle vision riante ou sévère de l'histoire profane ou sacrée. La nature, dans les toiles
de Corot, reste donc réelle et ressemblante. Et le personnage qu'il y ajoute ne fait, au lieu
de l'altérer, qu'en accentuer le caractère.
On voit que ces deux esthétiques classiques sont fort différentes : d'un coté, une poésie en
imitation, un style en plaqué, des accessoires de fer-blanc et de carton comme ceux du théâtre;
de l'autre, des éléments scrupuleusement vivants.
Car les figures mêmes de Corot, mythologiques ou bibliques, palpitent de vie. Sont-elles,
comme chez ses prédécesseurs, de simples copies de types convenus, de telle médaille, tel
buste, telle gravure? Copier une copie! le beau moyen de donner une âme à la peinture! Non,
Corot prend ses types dans ses rêves, dans son cœur, c'est-à-dire qu'il les puise à des sources
chaudes et bouillonnantes comme la nature elle-même. Et de fait n'y a-t-il donc de vivant que
Agar dans le désert (1835); — Diane surprise au bain (1836); — Silène (1838); — Fuite en
Egypte (1840); — Démocrite che% les Abdéritains, scène tirée des fables de La Fontaine (1841);
— Destruction de Sodome (1844); — Homère et les Bergers; Daphnis et Chloé (1845); — Le
Christ au jardin des Olives (1849); — Saint Sébastien (1853); — Nouvel Incendie de Sodome et
une Nymphe jouant avec un Amour (1857); — Dante et Virgile; Macbeth (1859); — Danse des
nymphes et Orphée (1861), etc. L'un des deux tableaux destinés au Salon de cette année est
encore « une danse antique. »
Comment se fait-il que personne, — hormis Courbet peut-être — n'ait jamais reproché à
Corot ces thèmes d'un autre âge ? Comment, sous ces modes d'antan, est-il resté le plus jeune
des peintres de nos jours ? En quoi donc diffère-t-il des classiques surannés auxquels il les
emprunte ? — Voilà l'explication importante à donner.
Cette explication est fort simple.
Quand le paysagiste classique d'avant 1830 prend pour sujet un Saint Jérôme ou un Silène,
D'après un tableau de Corot.
il encadre sa figure dans un paysage assorti et fabriqué de toutes pièces, avec des ciels
empruntés au Poussin, des rochers pris à Salvator Rosa, des palmiers tirés de Raphaël, des
temples grecs copiés d'un bas-relief quelconque.
Chez Corot, c'est le procédé inverse. Il est trop amoureux de la nature pour ne pas l'accepter
telle qu'elle est et la respecter; mais, suivant le caractère des sites qu'il rencontre, suivant
leur tristesse ou leur sérénité, leur grandeur ou leur grâce, son imagination y évoque naturel-
lement telle vision riante ou sévère de l'histoire profane ou sacrée. La nature, dans les toiles
de Corot, reste donc réelle et ressemblante. Et le personnage qu'il y ajoute ne fait, au lieu
de l'altérer, qu'en accentuer le caractère.
On voit que ces deux esthétiques classiques sont fort différentes : d'un coté, une poésie en
imitation, un style en plaqué, des accessoires de fer-blanc et de carton comme ceux du théâtre;
de l'autre, des éléments scrupuleusement vivants.
Car les figures mêmes de Corot, mythologiques ou bibliques, palpitent de vie. Sont-elles,
comme chez ses prédécesseurs, de simples copies de types convenus, de telle médaille, tel
buste, telle gravure? Copier une copie! le beau moyen de donner une âme à la peinture! Non,
Corot prend ses types dans ses rêves, dans son cœur, c'est-à-dire qu'il les puise à des sources
chaudes et bouillonnantes comme la nature elle-même. Et de fait n'y a-t-il donc de vivant que