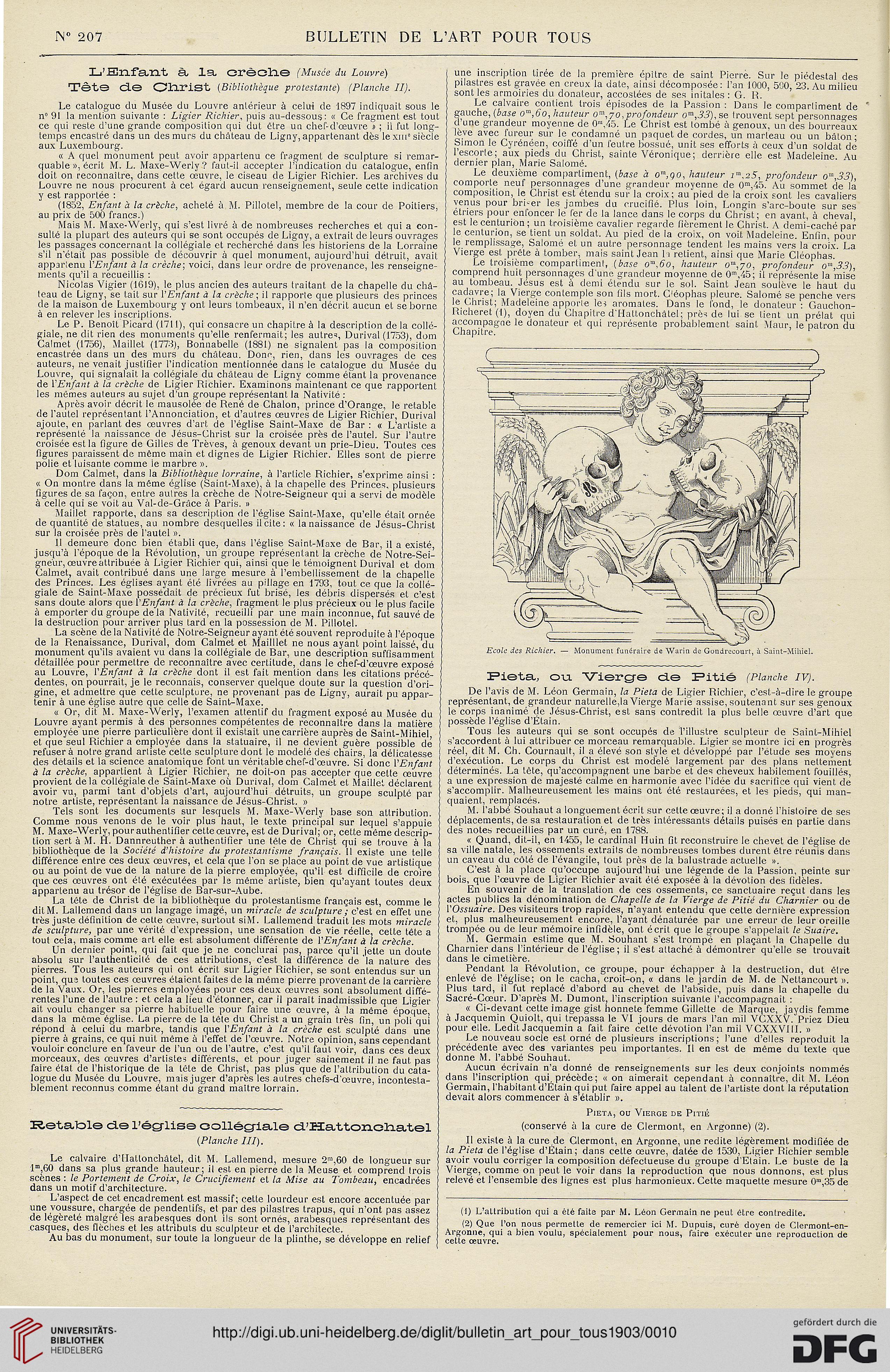IN0 207
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
L'Enfant à la crèche (Musée du Louvre)
Têt9 de OiiriSt, (Bibliothèque protestante) (Planche II).
Le catalogue du Musée du Louvre antérieur à celui de 1897 indiquait sous le
n° 91 la mention suivante : Ligicr Richier, puis au-dessous: « Ce fragment est tout
ce qui reste d'une grande composition qui dut être un chef-d'œuvre s> ; il fut long-
temps encastré dans un des murs du château de Ligny, appartenant dès le xme siècle
aux Luxembourg.
« A quel monument peut avoir appartenu ce fragment de sculpture si remar-
quable », écrit M. L. Maxe-Werly ? faut-il accepter l'indication du catalogue, enfin
doit on reconnaître, dans cette œuvre, le ciseau de Ligier Richier. Les archives du
Louvre ne nous procurent à cet égard aucun renseignement, seule cette indication
y est rapportée :
(1852, Enfant à la crèche, acheté à M. Pillotel, membre de la cour de Poitiers,
au prix de 500 francs.)
Mais M. Maxe-Werly, qui s'est livré à de nombreuses recherches el qui a con-
sulté la plupart des auteurs qui se sont occupés de Ligny, a extrait de leurs ouvrages
les passages concernant la collégiale et recherché dans les historiens de la Lorraine
s'il n'était pas possible de découvrir à quel monument, aujourd'hui détruit, avait
apparienu VEnfant à la crèche; voici, dans leur ordre de provenance, les renseigne-
ments qu'il a recueillis :
Nicolas Vigier (1GI9), le plus ancien des auteurs traitant de la chapelle du châ-
teau de Ligny, se tait sur l'Enfant à la crèche; il rapporte que plusieurs des princes
de la maison de Luxembourg y ont leurs tombeaux, il n'en décriL aucun el se borne
à en relever les inscriptions.
Le P. Benoît Picard (1711), qui consacre un chapitre à la description de la collé-
giale, ne dit rien des monuments qu'elle renfermait; les aulre=, Durival (1753), dom
Calmet (1756), Maillet (1773), Bonnabelle (1881) ne signalent pas la composition
encastrée dans un des murs du château. Donc, rien, dans les ouvrages de ces
auteurs, ne venait justifier l'indication mentionnée dans le catalogue du Musée du
Louvre, qui signalait la collégiale du château de Ligny comme étant la provenance
de l'Enfant à la crèche de Ligier Richier. Examinons maintenant ce que rapportent
les mêmes auteurs au sujet d'un groupe représentant la Nativité :
Après avoir décrit le mausolée de René de Chalon, prince d'Orange, le retable
de l'autel représentant l'Annonciation, et d'autres œuvres de Ligier Richier, Durival
ajoute, en parlant des œuvres d'art de l'église Saint-Maxe de Bar : « L'artiste a
représenté la naissance de Jésus-Christ sur la croisée près de l'autel. Sur l'autre
croisée est la figure de Gilles de Trêves, à genoux devant un prie-Dieu. Toutes ces
figures paraissent de même main et dignes de Ligier Richier. Elles sont de pierre
polie et luisante comme ie marbre ».
Dom Calmet, dans la Bibliothèque lorraine, à l'article Richier, s'exprime ainsi :
« On montre dans la même église (Saint-Maxe), à la chapelle des Princes, plusieurs
figures de sa façon, entre autres la crèche de Noire-Seigneur qui a servi de modèle
à celle qui se voit au Val-de-Grâce à Paris. »
Maillet rapporte, dans sa description de l'église Saint-Maxe, qu'elle était ornée
de quantité de stalues, au nombre desquelles il cite: « la naissance de Jésus-Christ
sur la croisée près de l'autel ».
11 demeure donc bien établi que, dans l'église Saint-Maxe de Bar, il a existé,
jusqu'à l'époque de la Révolution, un groupe représentant la crèche de Notre-Sei-
gnéur, œuvre attribuée à Ligier Richier qui, ainsi que le témoignent Durival et dom
Calmet, avait contribué dans une large mesure à l'embellissement de la chapelle
des Princes. Les églises ayant été livrées au pillage en 1793, tout ce que la collé-
giale de Saint-Maxe possédait de précieux fut brisé, les débris dispersés et c'est
sans doute alors que l'Enfant à la crèche, fragment le plus précieux ou le plus facile
à emporter du groupe delà Nativité, recueilli par une main inconnue, fut sauvé de
la destruction pour arriver plus tard en la possession de M. Pillotel.
La scène de la Nativité de Notre-Seigneur ayant été souvent reproduite à l'époque
de la Renaissance, Durival, dom Calmet et Mailllet ne nous ayant point laissé, du
monument qu'ils avaient vu dans la collégiale de Bar, une description suffisamment
détaillée pour permettre de reconnaître avec certitude, dans le chef-d'œuvre exposé
au Louvre, l'Enfant à la crèche dont il est fait mention dans les citations précé-
dentes, on pourrait, je le reconnais, conserver quelque doute sur la question d'ori-
gine, et admettre que cette sculpture, ne provenant pas de Ligny, aurait pu appar-
tenir à une église autre que celle de Saint-Maxe.
« Or, dit M. Maxe-Werly, l'examen attentif du fragment exposé au Musée du
Louvre ayant permis à des personnes compétentes de reconnaître dans la matière
employée une pierre particulière dont il existait unecarrière auprès de Saint-Mihiel,
et que seul Richier a employée dans la statuaire, il ne devient guère possible de
refuser à notre grand artiste cette sculpture dont le modelé des chairs, la délicatesse
des détails et la science analomique font un véritable chef-d'œuvre. Si donc l'Enfant
à la crèche, appartient à Ligier Richier, ne doit-on pas accepter que cette œuvre
provient delà collégiale de Saint-Maxe où Durival, dom Calmet et Maillet déclarent
avoir vu, parmi tant d'objets d'art, aujourd'hui détruits, un groupe sculpté par
notre artiste, représentant la naissance de Jésus-Christ. »
Tels sont les documents sur lesquels M. Maxe-Werly base son attribution.
Comme nous venons de le voir plus haut, le texte principal sur lequel s'appuie !
M. Maxe-Werly, pour authentifier cette œuvre, est de Durival; or, cette même descrip-
tion sert à M. H. Dannreuther à authentifier une tête de Christ qui se trouve à la
bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme français. 11 existe une telle
différence entre ces deux œuvres, et cela que l'on se place au point de vue artistique
ou au point de vue de la nature de la pierre employée, qu'il est difficile de croire
que ces œuvres ont été exécutées par le même artiste, bien qu'ayant toutes deux
apparienu au trésor de l'église de Bar-sur-Aube.
La têle de Christ de la bibliothèque du protestantisme français est, comme le
dit M. Lallemend dans un langage imagé, un miracle de sculpture ; c'est en effet une
très juste définition de cette œuvre, surtout siM. Lallemend traduit les mots miracle
de sculpture, par une vérité d'expression, une sensation de vie réelle, celte tête a
tout cela, mais comme art elle est absolument différente de l'Enfant à la crèche.
Un dernier point, qui fait que je ne conclurai pas, parce qu'il jette un doute
absolu sur l'authenticilé de ces attributions, c'est la différence de la nalure des
pierres. Tous les auteurs qui ont écrit sur Ligier Richier, se sont entendus sur un
point, quî toutes ces œuvres étaient faites de la même pierre provenant de la carrière
de la Vaux. Or, les pierres employées pour ces deux œuvres sont absolument diffé-
rentes l'une de l'autre : el cela a lieu d'étonner, car il paraît inadmissible que Ligier
ait voulu changer sa pierre habituelle pour faire une œuvre, à la même époque,
dans la même église. La pierre de la tête du Christ a un grain très fin, un poli qui
répond à celui du marbre, tandis que l'Enfant à la crèche est sculpté dans une
pierre à grains, ce qui nuit même à l'effet de l'œuvre. Notre opinion, sans cependant
vouloir conclure en faveur de l'un ou de l'autre, c'est qu'il faut voir, dans ces deux
morceaux, des œuvres d'artistes différents, el pour juger sainement il ne faut pas
faire état de l'historique de la têle de Christ, pas plus que de l'attribution du cata-
logue du Musée du Louvre, mais juger d'après les autres chefs-d'œuvre, incontesta-
blement reconnus comme étant du grand maître lorrain.
R.etaole cle l'église collégiale d'Hattonolia/tel
(Planche III).
Le calvaire d'IIattonchâtel, dit M. Lallemend, mesure 2m,60 de longueur sur
lm,60 dans sa plus grande hauteur; il est en pierre de la Meuse et comprend trois
scènes : le Portement de Croix, le Crucifiement el la Mise au Tombeau, encadrées
dans un motif d'architecture.
L'aspect de cel encadrement est massif; cette lourdeur est encore accentuée par
une voussure, chargée de pendentifs, et par des pilastres trapus, qui n'ont pas assez
de légèreté malgré les arabesques dont ils sont ornés, arabesques représentant des
casques, des flèches et les attributs du sculpteur et de l'architecte.
Au bas du monument, sur toute la longueur de la plinthe, se développe en relief
une inscription tirée de la première épître de saint Pierre. Sur le piédestal des
pilastres est gravée en creux la date, ainsi décomposée: l'an 1000, 500, 23. Au milieu
sont les armoiries du donateur, accostées de ses initales : G. R.
Le calvaire contient trois épisodes de la Passion : Dans le comparliment de
gauche, (base om,6o, hauteur om,jo,profondeur om,33), se trouvent sept personnages
d'une grandeur moyenne de 0ra,45. Le Christ est tombé à genoux, un des bourreaux
lève avec fureur sur le condamné un paquet de cordes, un marteau ou un bâton;
Simon le Cyrénéen, coiffé d'un feutre bossué, unit ses efforts à ceux d'un soldat de
l'escorle; aux pieds du Christ, sainte Véronique; derrière elle est Madeleine. Au
dernier plan, Marie Salomé.
Le deuxième compartiment, (base à om,oo, hauteur i"\25, profondeur om,33),
comporte neuf personnages d'une grandeur moyenne cle 0m,45. Au sommet de la
composition, le Christ est étendu sur la croix; au pied de la croix sont les cavaliers
venus pour bri-er les jambes du crucifié. Plus loin, Longin s'arc-boute sur ses
étiiers pour enfoncer le 1er de la lance dans le corps du Christ; en avant, à cheval,
est le centurion ; un troisième cavalier regarde fièrement le Christ. A demi-caché par
le centurion, se tient un soldat. Au pied "de la croix, on voit Madeleine. Enfin, pour
le remplissage, Salomé et un autre personnage tendent les mains vers la croix. La
Vierge est prête à tomber, mais saint Jean la relient, ainsi que Marie Cléophas.
Le troisième compartiment, (base om,6o, hauteur o"\jo, profondeur om,33),
comprend huit personnages d'une grandeur moyenne de 0m,45; il représente la mise
au tombeau. Jésus est à demi étendu sur le sol. Saint Jean soulève le haut du
cadavre; la Vierge contemple son fils mort. C'éophas pleure. Salomé se penche vers
le Christ; Madeleine apporte les aromates. Dans le fond, le donateur : Gauchon-
Richeret (I), doyen du Chapitre d'Hattonehâtel; près de lui se lient un prélat qui
accompagne le donateur et qui représente probablement saint Maur, le patron du
Chapitre.
Ecole des Richier. — Monument funéraire de Warin de Gondrecourt, à Saint-Mihiel.
Pieta, ou "Vierge cie Fitié (Planche IV).
De l'avis de M. Léon Germain, la Pieta de Ligier Richier, c'est-à-dire le groupe
représentant, de grandeur naturelle,la Vierge Marie assise, soutenant sur ses genoux
le corps inanimé de Jésus-Christ, est sans contredit la plus belle œuvre d'art que
possède l'église d'Étain.
Tous lès auteurs qui se sont occupés de l'illustre sculpteur de Saint-Mihiel
s'accordent à lui attribuer ce morceau remarquable. Ligier se montre ici en progrès
réel, dit M. Ch. Cournault, il a élevé son style et développé par l'étude ses moyens
d'exécution. Le corps du Christ est modelé largement par des plans nettement
déterminés. La tète, qu'accompagnent une barbe et des cheveux habilement fouillés,
a une expression de majesté calme en harmonie avec l'idée du sacrifice qui vient de
s'accomplir. Malheureusement les mains ont été restaurées, et les pieds, qui man-
quaient, remplacés.
M. l'abbé Souhaut a longuement écrit sur cette œuvre ; il a donné l'histoire de ses
déplacements, de sa restauration et de très intéressants détails puisés en partie dans
des notes recueillies par un curé, en 1788.
« Quand, dit-il, en 1455, le cardinal Huin fit reconstruire le chevet de l'église de
sa ville natale, les ossements extraits de nombreuses lombes durent être réunis dans
un caveau du côté de l'évangile, tout près de la balustrade actuelle ».
C'est à la place qu'occupe aujourd'hui une légende de la Passion, peinte sur
bois, que l'œuvre de Ligier Richier avait été exposée à la dévotion des fidèles.
En souvenir de la translation cle ces ossements, ce sanctuaire reçut dans les
actes publics la dénomination de Chapelle de la Vierge de Pitié du Charnier ou de
l'Ossuaire. Des visiteurs trop rapides, n'ayant entendu que cette dernière expression
et, plus malheureusement encore, l'ayant dénaturée par une erreur de leur oreille
trompée ou de leur mémoire infidèle, ont écrit que le groupe s'appelait le Suaire.
M. Germain eslime que M. Souhant s'est trompé en plaçant la Chapelle du
Charnier dans l'intérieur de l'église; il s'est attaché à démontrer qu'elle se trouvait
dans le cimetière.
Pendant la Révolution, ce groupe, pour échapper à la destruction, dut êlre
enlevé de l'église; on le cacha, croit-on, « dans le jardin de M. de Nettancourt ».
Plus tard, il fut replacé d'abord au chevet de l'abside, puis dans la chapelle du
Sacré-Cœur. D'après M. Dumont, l'inscription suivante l'accompagnait :
« Ci-devant cette image gisl honnête femme Gillette de Marque, jaydis femme
à Jacquemin Quiolt, qui trépassa le VI jours de mars l'an mil VCXXV. Priez Dieu
pour elle. Ledit Jacquemin a fait faire cette dévotion l'an mil VCXXV1II. »
Le nouveau socle est orné de plusieurs inscriptions; l'une d'elles reproduit la
précédente avec des variantes peu importantes. Il en est de même du texte que
donne M. l'abbé Souhaut.
Aucun écrivain n'a donné de renseignements sur les deux conjoints nommés
dans l'inscription qui, précède; « on aimerait cependant à connaître, dit M. Léon
Germain, l'habitant d'Etain qui put faire appel au talent de l'artiste dont la réputation
devait alors commencer à s établir ».
Pieta, ou Vierge de Pitié
(conservé à la cure de Clermont, en Argonne) (2).
Il existe à la cure de Clermont, en Argonne, une redite légèrement modifiée de
la Pieta de l'église d'Etain; dans celte œuvre, datée de 1530, Ligier Richier semble
avoir voulu corriger la composition défectueuse du groupe d'Etain. Le buste de la
Vierge, comme on peut le voir dans la reproduction que nous donnons, est plus
relevé et l'ensemble des lignes est plus harmonieux. Cette maquette mesure 0ra,35 de
(1) L'attribution qui a été faite par M. Léon Germain ne peut être contredite.
(2) Que l'on nous permette de remercier ici M. Dupuis, curé doyen de Olermont-en-
Argonne, qui a bien voulu, spécialement pour nous, faire exécuter une reproduction de
cette œuvre.
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
L'Enfant à la crèche (Musée du Louvre)
Têt9 de OiiriSt, (Bibliothèque protestante) (Planche II).
Le catalogue du Musée du Louvre antérieur à celui de 1897 indiquait sous le
n° 91 la mention suivante : Ligicr Richier, puis au-dessous: « Ce fragment est tout
ce qui reste d'une grande composition qui dut être un chef-d'œuvre s> ; il fut long-
temps encastré dans un des murs du château de Ligny, appartenant dès le xme siècle
aux Luxembourg.
« A quel monument peut avoir appartenu ce fragment de sculpture si remar-
quable », écrit M. L. Maxe-Werly ? faut-il accepter l'indication du catalogue, enfin
doit on reconnaître, dans cette œuvre, le ciseau de Ligier Richier. Les archives du
Louvre ne nous procurent à cet égard aucun renseignement, seule cette indication
y est rapportée :
(1852, Enfant à la crèche, acheté à M. Pillotel, membre de la cour de Poitiers,
au prix de 500 francs.)
Mais M. Maxe-Werly, qui s'est livré à de nombreuses recherches el qui a con-
sulté la plupart des auteurs qui se sont occupés de Ligny, a extrait de leurs ouvrages
les passages concernant la collégiale et recherché dans les historiens de la Lorraine
s'il n'était pas possible de découvrir à quel monument, aujourd'hui détruit, avait
apparienu VEnfant à la crèche; voici, dans leur ordre de provenance, les renseigne-
ments qu'il a recueillis :
Nicolas Vigier (1GI9), le plus ancien des auteurs traitant de la chapelle du châ-
teau de Ligny, se tait sur l'Enfant à la crèche; il rapporte que plusieurs des princes
de la maison de Luxembourg y ont leurs tombeaux, il n'en décriL aucun el se borne
à en relever les inscriptions.
Le P. Benoît Picard (1711), qui consacre un chapitre à la description de la collé-
giale, ne dit rien des monuments qu'elle renfermait; les aulre=, Durival (1753), dom
Calmet (1756), Maillet (1773), Bonnabelle (1881) ne signalent pas la composition
encastrée dans un des murs du château. Donc, rien, dans les ouvrages de ces
auteurs, ne venait justifier l'indication mentionnée dans le catalogue du Musée du
Louvre, qui signalait la collégiale du château de Ligny comme étant la provenance
de l'Enfant à la crèche de Ligier Richier. Examinons maintenant ce que rapportent
les mêmes auteurs au sujet d'un groupe représentant la Nativité :
Après avoir décrit le mausolée de René de Chalon, prince d'Orange, le retable
de l'autel représentant l'Annonciation, et d'autres œuvres de Ligier Richier, Durival
ajoute, en parlant des œuvres d'art de l'église Saint-Maxe de Bar : « L'artiste a
représenté la naissance de Jésus-Christ sur la croisée près de l'autel. Sur l'autre
croisée est la figure de Gilles de Trêves, à genoux devant un prie-Dieu. Toutes ces
figures paraissent de même main et dignes de Ligier Richier. Elles sont de pierre
polie et luisante comme ie marbre ».
Dom Calmet, dans la Bibliothèque lorraine, à l'article Richier, s'exprime ainsi :
« On montre dans la même église (Saint-Maxe), à la chapelle des Princes, plusieurs
figures de sa façon, entre autres la crèche de Noire-Seigneur qui a servi de modèle
à celle qui se voit au Val-de-Grâce à Paris. »
Maillet rapporte, dans sa description de l'église Saint-Maxe, qu'elle était ornée
de quantité de stalues, au nombre desquelles il cite: « la naissance de Jésus-Christ
sur la croisée près de l'autel ».
11 demeure donc bien établi que, dans l'église Saint-Maxe de Bar, il a existé,
jusqu'à l'époque de la Révolution, un groupe représentant la crèche de Notre-Sei-
gnéur, œuvre attribuée à Ligier Richier qui, ainsi que le témoignent Durival et dom
Calmet, avait contribué dans une large mesure à l'embellissement de la chapelle
des Princes. Les églises ayant été livrées au pillage en 1793, tout ce que la collé-
giale de Saint-Maxe possédait de précieux fut brisé, les débris dispersés et c'est
sans doute alors que l'Enfant à la crèche, fragment le plus précieux ou le plus facile
à emporter du groupe delà Nativité, recueilli par une main inconnue, fut sauvé de
la destruction pour arriver plus tard en la possession de M. Pillotel.
La scène de la Nativité de Notre-Seigneur ayant été souvent reproduite à l'époque
de la Renaissance, Durival, dom Calmet et Mailllet ne nous ayant point laissé, du
monument qu'ils avaient vu dans la collégiale de Bar, une description suffisamment
détaillée pour permettre de reconnaître avec certitude, dans le chef-d'œuvre exposé
au Louvre, l'Enfant à la crèche dont il est fait mention dans les citations précé-
dentes, on pourrait, je le reconnais, conserver quelque doute sur la question d'ori-
gine, et admettre que cette sculpture, ne provenant pas de Ligny, aurait pu appar-
tenir à une église autre que celle de Saint-Maxe.
« Or, dit M. Maxe-Werly, l'examen attentif du fragment exposé au Musée du
Louvre ayant permis à des personnes compétentes de reconnaître dans la matière
employée une pierre particulière dont il existait unecarrière auprès de Saint-Mihiel,
et que seul Richier a employée dans la statuaire, il ne devient guère possible de
refuser à notre grand artiste cette sculpture dont le modelé des chairs, la délicatesse
des détails et la science analomique font un véritable chef-d'œuvre. Si donc l'Enfant
à la crèche, appartient à Ligier Richier, ne doit-on pas accepter que cette œuvre
provient delà collégiale de Saint-Maxe où Durival, dom Calmet et Maillet déclarent
avoir vu, parmi tant d'objets d'art, aujourd'hui détruits, un groupe sculpté par
notre artiste, représentant la naissance de Jésus-Christ. »
Tels sont les documents sur lesquels M. Maxe-Werly base son attribution.
Comme nous venons de le voir plus haut, le texte principal sur lequel s'appuie !
M. Maxe-Werly, pour authentifier cette œuvre, est de Durival; or, cette même descrip-
tion sert à M. H. Dannreuther à authentifier une tête de Christ qui se trouve à la
bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme français. 11 existe une telle
différence entre ces deux œuvres, et cela que l'on se place au point de vue artistique
ou au point de vue de la nature de la pierre employée, qu'il est difficile de croire
que ces œuvres ont été exécutées par le même artiste, bien qu'ayant toutes deux
apparienu au trésor de l'église de Bar-sur-Aube.
La têle de Christ de la bibliothèque du protestantisme français est, comme le
dit M. Lallemend dans un langage imagé, un miracle de sculpture ; c'est en effet une
très juste définition de cette œuvre, surtout siM. Lallemend traduit les mots miracle
de sculpture, par une vérité d'expression, une sensation de vie réelle, celte tête a
tout cela, mais comme art elle est absolument différente de l'Enfant à la crèche.
Un dernier point, qui fait que je ne conclurai pas, parce qu'il jette un doute
absolu sur l'authenticilé de ces attributions, c'est la différence de la nalure des
pierres. Tous les auteurs qui ont écrit sur Ligier Richier, se sont entendus sur un
point, quî toutes ces œuvres étaient faites de la même pierre provenant de la carrière
de la Vaux. Or, les pierres employées pour ces deux œuvres sont absolument diffé-
rentes l'une de l'autre : el cela a lieu d'étonner, car il paraît inadmissible que Ligier
ait voulu changer sa pierre habituelle pour faire une œuvre, à la même époque,
dans la même église. La pierre de la tête du Christ a un grain très fin, un poli qui
répond à celui du marbre, tandis que l'Enfant à la crèche est sculpté dans une
pierre à grains, ce qui nuit même à l'effet de l'œuvre. Notre opinion, sans cependant
vouloir conclure en faveur de l'un ou de l'autre, c'est qu'il faut voir, dans ces deux
morceaux, des œuvres d'artistes différents, el pour juger sainement il ne faut pas
faire état de l'historique de la têle de Christ, pas plus que de l'attribution du cata-
logue du Musée du Louvre, mais juger d'après les autres chefs-d'œuvre, incontesta-
blement reconnus comme étant du grand maître lorrain.
R.etaole cle l'église collégiale d'Hattonolia/tel
(Planche III).
Le calvaire d'IIattonchâtel, dit M. Lallemend, mesure 2m,60 de longueur sur
lm,60 dans sa plus grande hauteur; il est en pierre de la Meuse et comprend trois
scènes : le Portement de Croix, le Crucifiement el la Mise au Tombeau, encadrées
dans un motif d'architecture.
L'aspect de cel encadrement est massif; cette lourdeur est encore accentuée par
une voussure, chargée de pendentifs, et par des pilastres trapus, qui n'ont pas assez
de légèreté malgré les arabesques dont ils sont ornés, arabesques représentant des
casques, des flèches et les attributs du sculpteur et de l'architecte.
Au bas du monument, sur toute la longueur de la plinthe, se développe en relief
une inscription tirée de la première épître de saint Pierre. Sur le piédestal des
pilastres est gravée en creux la date, ainsi décomposée: l'an 1000, 500, 23. Au milieu
sont les armoiries du donateur, accostées de ses initales : G. R.
Le calvaire contient trois épisodes de la Passion : Dans le comparliment de
gauche, (base om,6o, hauteur om,jo,profondeur om,33), se trouvent sept personnages
d'une grandeur moyenne de 0ra,45. Le Christ est tombé à genoux, un des bourreaux
lève avec fureur sur le condamné un paquet de cordes, un marteau ou un bâton;
Simon le Cyrénéen, coiffé d'un feutre bossué, unit ses efforts à ceux d'un soldat de
l'escorle; aux pieds du Christ, sainte Véronique; derrière elle est Madeleine. Au
dernier plan, Marie Salomé.
Le deuxième compartiment, (base à om,oo, hauteur i"\25, profondeur om,33),
comporte neuf personnages d'une grandeur moyenne cle 0m,45. Au sommet de la
composition, le Christ est étendu sur la croix; au pied de la croix sont les cavaliers
venus pour bri-er les jambes du crucifié. Plus loin, Longin s'arc-boute sur ses
étiiers pour enfoncer le 1er de la lance dans le corps du Christ; en avant, à cheval,
est le centurion ; un troisième cavalier regarde fièrement le Christ. A demi-caché par
le centurion, se tient un soldat. Au pied "de la croix, on voit Madeleine. Enfin, pour
le remplissage, Salomé et un autre personnage tendent les mains vers la croix. La
Vierge est prête à tomber, mais saint Jean la relient, ainsi que Marie Cléophas.
Le troisième compartiment, (base om,6o, hauteur o"\jo, profondeur om,33),
comprend huit personnages d'une grandeur moyenne de 0m,45; il représente la mise
au tombeau. Jésus est à demi étendu sur le sol. Saint Jean soulève le haut du
cadavre; la Vierge contemple son fils mort. C'éophas pleure. Salomé se penche vers
le Christ; Madeleine apporte les aromates. Dans le fond, le donateur : Gauchon-
Richeret (I), doyen du Chapitre d'Hattonehâtel; près de lui se lient un prélat qui
accompagne le donateur et qui représente probablement saint Maur, le patron du
Chapitre.
Ecole des Richier. — Monument funéraire de Warin de Gondrecourt, à Saint-Mihiel.
Pieta, ou "Vierge cie Fitié (Planche IV).
De l'avis de M. Léon Germain, la Pieta de Ligier Richier, c'est-à-dire le groupe
représentant, de grandeur naturelle,la Vierge Marie assise, soutenant sur ses genoux
le corps inanimé de Jésus-Christ, est sans contredit la plus belle œuvre d'art que
possède l'église d'Étain.
Tous lès auteurs qui se sont occupés de l'illustre sculpteur de Saint-Mihiel
s'accordent à lui attribuer ce morceau remarquable. Ligier se montre ici en progrès
réel, dit M. Ch. Cournault, il a élevé son style et développé par l'étude ses moyens
d'exécution. Le corps du Christ est modelé largement par des plans nettement
déterminés. La tète, qu'accompagnent une barbe et des cheveux habilement fouillés,
a une expression de majesté calme en harmonie avec l'idée du sacrifice qui vient de
s'accomplir. Malheureusement les mains ont été restaurées, et les pieds, qui man-
quaient, remplacés.
M. l'abbé Souhaut a longuement écrit sur cette œuvre ; il a donné l'histoire de ses
déplacements, de sa restauration et de très intéressants détails puisés en partie dans
des notes recueillies par un curé, en 1788.
« Quand, dit-il, en 1455, le cardinal Huin fit reconstruire le chevet de l'église de
sa ville natale, les ossements extraits de nombreuses lombes durent être réunis dans
un caveau du côté de l'évangile, tout près de la balustrade actuelle ».
C'est à la place qu'occupe aujourd'hui une légende de la Passion, peinte sur
bois, que l'œuvre de Ligier Richier avait été exposée à la dévotion des fidèles.
En souvenir de la translation cle ces ossements, ce sanctuaire reçut dans les
actes publics la dénomination de Chapelle de la Vierge de Pitié du Charnier ou de
l'Ossuaire. Des visiteurs trop rapides, n'ayant entendu que cette dernière expression
et, plus malheureusement encore, l'ayant dénaturée par une erreur de leur oreille
trompée ou de leur mémoire infidèle, ont écrit que le groupe s'appelait le Suaire.
M. Germain eslime que M. Souhant s'est trompé en plaçant la Chapelle du
Charnier dans l'intérieur de l'église; il s'est attaché à démontrer qu'elle se trouvait
dans le cimetière.
Pendant la Révolution, ce groupe, pour échapper à la destruction, dut êlre
enlevé de l'église; on le cacha, croit-on, « dans le jardin de M. de Nettancourt ».
Plus tard, il fut replacé d'abord au chevet de l'abside, puis dans la chapelle du
Sacré-Cœur. D'après M. Dumont, l'inscription suivante l'accompagnait :
« Ci-devant cette image gisl honnête femme Gillette de Marque, jaydis femme
à Jacquemin Quiolt, qui trépassa le VI jours de mars l'an mil VCXXV. Priez Dieu
pour elle. Ledit Jacquemin a fait faire cette dévotion l'an mil VCXXV1II. »
Le nouveau socle est orné de plusieurs inscriptions; l'une d'elles reproduit la
précédente avec des variantes peu importantes. Il en est de même du texte que
donne M. l'abbé Souhaut.
Aucun écrivain n'a donné de renseignements sur les deux conjoints nommés
dans l'inscription qui, précède; « on aimerait cependant à connaître, dit M. Léon
Germain, l'habitant d'Etain qui put faire appel au talent de l'artiste dont la réputation
devait alors commencer à s établir ».
Pieta, ou Vierge de Pitié
(conservé à la cure de Clermont, en Argonne) (2).
Il existe à la cure de Clermont, en Argonne, une redite légèrement modifiée de
la Pieta de l'église d'Etain; dans celte œuvre, datée de 1530, Ligier Richier semble
avoir voulu corriger la composition défectueuse du groupe d'Etain. Le buste de la
Vierge, comme on peut le voir dans la reproduction que nous donnons, est plus
relevé et l'ensemble des lignes est plus harmonieux. Cette maquette mesure 0ra,35 de
(1) L'attribution qui a été faite par M. Léon Germain ne peut être contredite.
(2) Que l'on nous permette de remercier ici M. Dupuis, curé doyen de Olermont-en-
Argonne, qui a bien voulu, spécialement pour nous, faire exécuter une reproduction de
cette œuvre.