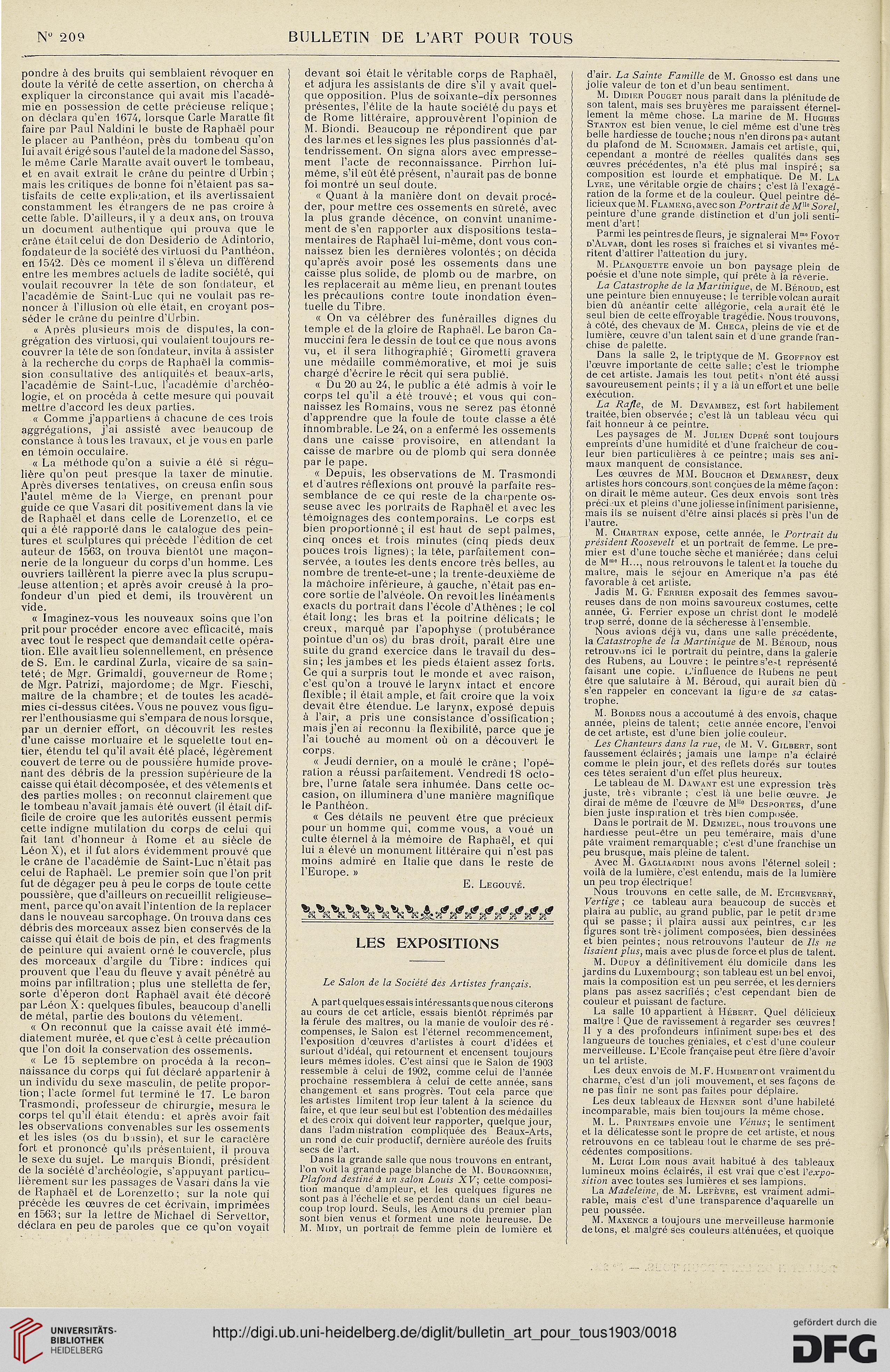N° 209
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
pondre à des bruits qui semblaient révoquer en J
doute la vérité de cette assertion, on chercha à
expliquer la circonstance qui avait mis l'acadé-
mie en possession de cette précieuse relique;
on déclara qu'en 1674, lorsque Carie Maratte fit
faire par Paul Naldini le buste de Raphaël pour
le placer au Panthéon, près du tombeau qu'on
lui avait érigé sous l'autel delà madone del Sasso,
le même Carie Maratte avait ouvert le tombeau,
et en avait extrait le crâne du peintre d'Urbin ;
mais les critiques de bonne foi n'étaient pas sa-
tisfaits de celte explication, et ils avertissaient
constamment les étrangers de ne pas croire à
cette fable. D'ailleurs, il y a deux ans, on trouva
un document authentique qui prouva que le
crâne était celui de don Desiderio de Adintorio,
fondateur de la société des virtuosi du Panthéon,
en 1542. Dès ce moment il s'éleva un différend
entre les membres actuels de ladite société, qui
voulait recouvrer la tête de son fondateur, et
l'académie de Saint-Luc qui ne voulait pas re-
noncer à l'illusion où elle était, en croyant pos-
séder le crâne du peintre d'Urbin.
« Après plusieurs mois de disputes, la con-
grégation des virtuosi, qui voulaient toujours re-
couvrer la tôle de son fondateur, invita à assister
à la recherche du corps de Raphaël la commis-
sion consultative des antiquités et beaux-arts,
l'académie de Saint-Luc, l'académie d'archéo-
logie, et on procéda à cette mesure qui pouvait
mettre d'accord les deux parties.
« Comme j'appartiens à chacune de ces trois
aggrégations, j'ai assisté avec beaucoup de
constance à tousles travaux, et je vous en parle
en témoin occulaire.
« La méthode qu'on a suivie a élé si régu-
lière qu'on peut presque la taxer de minutie.
Après diverses tentatives, on creusa enfin sous
l'autel môme de la Vierge, en prenant pour
guide ce que Vasari dit positivement dans la vie ;
de Raphaël et dans celle de Lorenzetlo, et ce '
qui a élé rapporté dans le catalogue des pein- ;
turcs et sculptures qui précède l'édition de cet ;
auteur de 1563, on trouva bientôt une maçon-
nerie de la longueur du corps d'un homme. Les
ouvriers taillèrent la pierre avec la plus scrupu-
leuse atfenlion; et après avoir creusé à la pro-
fondeur d'un pied et demi, ils trouvèrent un
vide.
« Imaginez-vous les nouveaux soins que l'on
prit pour procéder encore avec efficacité, mais
avec tout le respect que demandait celle opéra-
tion. Elle avait lieu solennellement, en présence
de S. Era. le cardinal Zurla, vicaire de sa sain- ;
teté; de Mgr. Grimaldi, gouverneur de Rome;
de Mgr. Patrizi, majordome; de Mgr. Fieschi,
maître delà chambre; et de toutes les acadé-
mies ci-dessus citées. Vous ne pouvez vous figu-
rer l'enthousiasme qui s'empara de nous lorsque,
par un dernier effort, on découvrit les restes
d'une caisse mortuaire et le squelette tout en- I
tier, étendu tel qu'il avait élé placé, légèrement
couvert de terre ou de poussière humide prove- [
riant des débris de la pression supérieure de la
caisse qui était décomposée, et des vêtements et
des parties molles ; on reconnut clairement que
le tombeau n'avait jamais été ouvert (il était dif-
ficile de croire que les autorités eussent permis
cette indigne mutilation du corps de celui qui
fait tant d'honneur à Rome et au siècle de
Léon X), et il fut alors évidemment prouvé que
le crâne de l'académie de Saint-Luc n'était pas
celui de Raphaël. Le premier soin que l'on prit
fut de dégager peu à peu le corps de toute cette
poussière, que d'ailleurs on recueillit religieuse-
ment, pai'ce qu'on avait l'intenlion de la replacer
dans le nouveau sarcophage. On trouva dans ces
débris des morceaux assez bien conservés de la
caisse qui élait de bois de pin, et des fragments
de peinture qui avaient orné le couvercle, plus
des morceaux d'argile du Tibre: indices qui
prouvent que l'eau du fleuve y avait pénétré au
moins par infiltration; plus une stellelta de fer,
sorte d'éperon dont Raphaël avait été décoré
par Léon X: quelques fibules, beaucoup d'anelli
de métal, partie des boulons du vêtement.
« On reconnut que la caisse avait été immé-
diatement, murée, et que c'est à celte précaution
que l'on doit la conservation des ossements.
« Le 15 septembre on procéda à la recon-
naissance du corps qui fut déclaré appartenir à
un individu du sexe masculin, de petite propor-
tion; l'acte formel fut terminé le 17. Le baron
Trasmondi, professeur de chirurgie, mesura le
corps tel qu'il était étendu: et après avoir fait
les observations convenables sur les ossements
et les isles (os du b issin), et sur le caractère
fort et prononcé qu'ils présentaient, il prouva
le sexe du sujel. Le marquis Biondi, président
de la société d'archéologie, s'appuyant, particu-
lièrement sur les passages de Vasari dans la vie
de Raphaël et de LorenzeUo ; sur la noie qui
précède les œuvres de cet écrivain, imprimées
en 1563; sur la lettre de Michael cli Servettor,
déclara en peu de paroles que ce qu'on voyait |
devant soi était le véritable corps de Raphaël,
et adjura les assistants de dire s'il y avait quel-
que opposition. Plus de soixante-dix personnes
présentes, l'élite de la haute société du pays et
de Rome littéraire, approuvèrent l'opinion de
M. Biondi. Beaucoup ne répondirent que par
des larmes et les signes les plus passionnés d'at-
tendrissement. On signa alors avec empresse-
ment l'acte de reconnaissance. Pirrhon lui-
même, s'il eût été présent, n'aurait pas de bonne
foi montré un seul doute.
« Quant à la manière dont on devait procé-
der, pour mettre ces ossements en sûreté, avec
la plus grande décence, on convint unanime-
ment de s'en rapporter aux dispositions testa-
mentaires de Raphaël lui-même, dont vous con-
naissez bien les dernières volontés; on décida
qu'après avoir posé les ossements dans une
caisse plus solide, de plomb ou de marbre, on
les replacerait au même lieu, en prenant loutes
les précautions contre toute inondation éven-
tuelle du Tibre.
« On va célébrer des funérailles dignes du
lemple et de la gloire de Raphaël. Le baron Ca-
muccini fera le dessin de fout ce que nous avons
vu, et il sera lithographié ; Girometti gravera
une médaille commémorative, et moi je suis
chargé d'écrire le récit qui sera publié.
« Du 20 au 24, le public a été admis à voir le
corps tel qu'il a été trouvé; et vous qui con-
naissez les Romains, vous ne serez pas étonné
d'apprendre que la foule de toute classe a été
innombrable. Le 24, on a enfermé les ossements
dans une caisse provisoire, en attendant la
caisse de marbre ou de plomb qui sera donnée
par le pape.
« Depuis, les observations de M. Trasmondi
et d'autres réflexions ont prouvé la parfaile res-
semblance de ce qui reste de la charpente os-
seuse avec les portraits de Raphaël et avec les
témoignages des contemporains. Le corps est
bien proportionné ; il est haut de sept palmes,
cinq onces et trois minutes (cinq pieds deux
pouces trois lignes) ; la tête, parfaitement con-
servée, a loutes les dents encore très belles, au
nombre de trente-et-une ; la trente-deuxième de
la mâchoire inférieure, à gauche, n'était pas en-
core sortie de l'alvéole. On revoitles linéaments
exacts du portrait dans l'école d'Athènes ; le col
était long; les bras et la poitrine délicats; le
creux, marqué par l'apophyse (protubérance
pointue d'un os) du bras droit, paraît être une
suite du grand exercice clans le travail du des-
sin; les jambes et les pieds étaient assez forts.
Ce qui a surpris tout le monde et avec raison,
c'est qu'on a trouvé le larynx intact et encore
flexible; il était ample, et fait croire que la voix
devait être étendue. Le larynx, exposé depuis
à l'air, a pris une consistance d'ossification;
mais j'en ai reconnu la flexibilité, parce que je
l'ai touché au moment où on a découvert le
corps.
« Jeudi dernier, on a moulé le crâne; l'opé-
ration a réussi parfaitement. Vendredi 18 octo-
bre, l'urne fatale sera inhumée. Dans cette oc-
casion, on illuminera d'une manière magnifique
le Panthéon.
« Ces détails ne peuvent être que précieux
pour un homme qui, comme vous, a voué un
culte éternel à la mémoire de Raphaël, et qui
lui a élevé un monument littéraire qui n'est pas
moins admiré en Italie que dans le reste de
l'Europe. »
E. Legouvé.
LES EXPOSITIONS
Le Salon de la Société des Artistes français.
A part quelques essais intéressants que nous citerons
au cours de cet article, essais bientôt réprimés par
la férule des maîtres, ou la manie de vouloir des ré-
compenses, le Salon est l'éternel recommencement,
l'exposition d'eeuvres d'artistes à court d'idées et
surtout d'idéal, qui retournent et encensent toujours
leurs mêmes idoles. C'est ainsi que le Salon de 1903
ressemble à celui de 1902, comme celui de l'année
prochaine ressemblera à celui de cette année, sans
changement et sans progrès. Tout cela parce que
les artistes limitent trop leur talent à la science du
faire, et que leur seul but est l'obtenlion des médailles
et des croix qui doivent leur rapporter, quelque jour,
dans l'administration compliquée des Beaux-Arts,
un rond de cuir productif, dernière auréole des fruits
secs de l'art.
Dans la grande salle que nous trouvons en entrant,
l'on voit la grande page blanche de M. Bourgonnier,
Plafond destiné à un salon Louis XV; cette composi-
tion manque d'ampleur, et les quelques figures ne
sont pas à l'échelle et se perdent dans un ciel beau-
coup trop lourd. Seuls, les Amours du premier plan
sont bien venus et forment une note heureuse. De
M. Midy, un portrait de femme plein de lumière et
d'air. La Sainte Famille de M. Grosso est dans une
jolie valeur de ton et d'un beau sentiment.
M. Didier Pouget nous paraît dans la plénitude de
son talent, mais ses bruyères me paraissent éternel-
lement la même chose. La marine de M. Hughes
Stanton est bien venue, le ciel même est d'une très
belle hardiesse de touche; nous n'en dirons pa-i autant
du plafond de M. Sciiommer. Jamais cet artisie, qui,
cependant a montré de réelles qualités dans ses
œuvres précédentes, n'a été plus mal inspiré; sa
composition est lourde et emphatique. De M. La
Lyre, une véritable orgie de chairs; c'est là l'exagé-
ration de la forme et de la couleur. Quel peintre dé-
licieux que M. Flameng, avec son Portrait de M]u Sorel,
peinture d'une grande distinction et d'un joli senti-
ment d'art!
Parmi les peintres de fleurs, je signalerai Mmo Foyot
d'Alvar, dont les roses si fraîches et si vivantes mé-
ritent d'attirer l'attention du jury,
j M. Planquette envoie un bon paysage plein de
poésie el d'une note simple, qui prête à la rêverie.
La Catastrophe de la Martinique, de M. Béroud, est
une peinture bien ennuyeuse ; le terrible volcan aurait
bien dû anéantir celle allégorie, cela aurait été le
seul bien de celte effroyable tragédie. Nous trouvons,
à côté, des chevaux de M. Checa, pleins de vie et de
lumière, œuvre d'un talent sain et d'une grande fran-
chise de palette.
Dans la salle 2, le triptyque de M. Geoffroy est
l'œuvre importante de celte salle; c'est le triomphe
de cet artisie. Jamais les (oui petits n'ont été aussi
savoureusement peints; il y a là un effort et une belle
\ exécution.
La Rafle, de M. Devambez, est fort habilement
traitée, bien observée ; c'est là un lableau vécu qui
l'ail honneur à ce peintre.
Les paysages de M. Julien Dupré sont toujours
empreints d'une humidité et d'une fraîcheur de cou-
leur bien particulières à ce peinlre; mais ses ani-
maux manquent de consistance.
Les œuvres de MM. Bouchor et Demarest, deux
artistes hors concours,sont conçues de la même façon:
on dirait le même auteur. Ces deux envois sont\rès
précieux et pleins d'une joliesse infiniment parisienne,
mais ils se nuisent d'être ainsi placés si près l'un de
l'autre.
M. Chartran expose, cetle année, le Portrait du
président Roosevelt et un portrait de femme. Le pre-
mier est d'une touche sèche et maniérée; dans celui
de MmB H..., nous retrouvons le talent el la touche du
maître, mais le séjour en Amérique n'a pas été
! favorable à cet artiste.
\ Jadis M. G. Ferrier exposait des femmes savou-
reuses dans de non moins savoureux coslumes, cette
année, G. Ferrier expose un christ dont le modelé
trop serré, donne de la sécheresse à l'ensemble.
Nous avions déjà vu, dans une salle précédente,
la Catastrophe de la Martinique de M. Béroud, nous
retrouvons ici le portrait du peintre, dans la galerie
des Rubens, au Louvre; le peintres'e-t représenté
faisant une copie. l'influence de Rubens ne peut
être que salutaire à M. Béroud, qui aurait bien dû
s'en rappeler en concevant la liguée de sa catas-
trophe.
M. Bordes nous a accoutumé à des envois, chaque
année, pleins de talent; cette année encore, l'envoi
de cet artiste, est d'une bien jolie couleur.
Les Chanteurs dans la rue, de M. V. Gilbert, sont
faussement éclairés ; jamais une lampe n'a éclairé
comme le plein jour, et des reflets dorés sur loutes
ces tètes seraient d'un effet plus heureux.
Le lableau de M. Dayvant est une expression très
juste, trèi vibrante ; c'est là une belle œuvre. Je
dirai de même de l'œuvre de M"0 Desportes, d'une
bien juste inspiration et très bien composée.
Dans le portrait de M. Demizel, nous trouvons une
hardiesse peul-être un peu téméraire, mais d'une
pâte vraiment remarquable; c'est d'une franchise un
peu brusque, mais pleine de talent.
Avec M. Gagliardini nous avons l'éternel soleil :
voilà de la lumière, c'est entendu, mais de la lumière
un peu trop électrique !
Nous trouvons en cette salle, de M. Etcheverry,
Vertige ; ce tableau aura beaucoup de succès et
plaira au public, au grand public, par le petit drime
qui se passe; il plaira aussi aux peintres, cir les
ligures sont trè-i jolimenl composées, bien dessinées
et bien peintes ; nous retrouvons l'auteur de Ils ne
lisaient plus, mais avec plus de force et plus de talent.
M. Dupuy a définitivement élu domicile dans les
jardins du Luxembourg; son tableau est un bel envoi,
mais la composition est un peu serrée, et les derniers
plans pas assez sacrifiés ; c'est cependant bien de
couleur et puissant de facture.
La salle 10 appartient à Hébert. Quel délicieux
maître ! Que de ravissement à regarder ses œuvres!
11 y a des profondeurs infiniment supeibes et des
langueurs de touches géniales, et c'est d'une couleur
merveilleuse. L'Ecole française peut être fière d'avoir
un tel artiste.
Les deux envois de M. F. HuiiBERTont vraimentdu
charme, c'est d'un joli mouvement, et ses façons de
ne pas finir ne sont pas faites pour déplaire.
Les deux tableaux de Henner sont d'une habileté
incomparable, mais bien toujours la même chose.
M. L. Printemps envoie une Vénus; le sentiment
et la délicatesse sont le propre de cet artiste, et nous
retrouvons en ce lableau tout le charme de ses pré-
cédentes compositions.
M. Luigi Loir nous avait habitué à des tableaux
lumineux moins éclairés, il est vrai que c'est l'expo-
sition avec toutes ses lumières et ses lampions.
La Madeleine, de M. Lefèvre, est vraiment admi-
rable, mais c'est d'une transparence d'aquarelle un
peu poussée.
M, Maxence a toujours une merveilleuse harmonie
de tons, et malgré ses couleurs atténuées, et quoique
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
pondre à des bruits qui semblaient révoquer en J
doute la vérité de cette assertion, on chercha à
expliquer la circonstance qui avait mis l'acadé-
mie en possession de cette précieuse relique;
on déclara qu'en 1674, lorsque Carie Maratte fit
faire par Paul Naldini le buste de Raphaël pour
le placer au Panthéon, près du tombeau qu'on
lui avait érigé sous l'autel delà madone del Sasso,
le même Carie Maratte avait ouvert le tombeau,
et en avait extrait le crâne du peintre d'Urbin ;
mais les critiques de bonne foi n'étaient pas sa-
tisfaits de celte explication, et ils avertissaient
constamment les étrangers de ne pas croire à
cette fable. D'ailleurs, il y a deux ans, on trouva
un document authentique qui prouva que le
crâne était celui de don Desiderio de Adintorio,
fondateur de la société des virtuosi du Panthéon,
en 1542. Dès ce moment il s'éleva un différend
entre les membres actuels de ladite société, qui
voulait recouvrer la tête de son fondateur, et
l'académie de Saint-Luc qui ne voulait pas re-
noncer à l'illusion où elle était, en croyant pos-
séder le crâne du peintre d'Urbin.
« Après plusieurs mois de disputes, la con-
grégation des virtuosi, qui voulaient toujours re-
couvrer la tôle de son fondateur, invita à assister
à la recherche du corps de Raphaël la commis-
sion consultative des antiquités et beaux-arts,
l'académie de Saint-Luc, l'académie d'archéo-
logie, et on procéda à cette mesure qui pouvait
mettre d'accord les deux parties.
« Comme j'appartiens à chacune de ces trois
aggrégations, j'ai assisté avec beaucoup de
constance à tousles travaux, et je vous en parle
en témoin occulaire.
« La méthode qu'on a suivie a élé si régu-
lière qu'on peut presque la taxer de minutie.
Après diverses tentatives, on creusa enfin sous
l'autel môme de la Vierge, en prenant pour
guide ce que Vasari dit positivement dans la vie ;
de Raphaël et dans celle de Lorenzetlo, et ce '
qui a élé rapporté dans le catalogue des pein- ;
turcs et sculptures qui précède l'édition de cet ;
auteur de 1563, on trouva bientôt une maçon-
nerie de la longueur du corps d'un homme. Les
ouvriers taillèrent la pierre avec la plus scrupu-
leuse atfenlion; et après avoir creusé à la pro-
fondeur d'un pied et demi, ils trouvèrent un
vide.
« Imaginez-vous les nouveaux soins que l'on
prit pour procéder encore avec efficacité, mais
avec tout le respect que demandait celle opéra-
tion. Elle avait lieu solennellement, en présence
de S. Era. le cardinal Zurla, vicaire de sa sain- ;
teté; de Mgr. Grimaldi, gouverneur de Rome;
de Mgr. Patrizi, majordome; de Mgr. Fieschi,
maître delà chambre; et de toutes les acadé-
mies ci-dessus citées. Vous ne pouvez vous figu-
rer l'enthousiasme qui s'empara de nous lorsque,
par un dernier effort, on découvrit les restes
d'une caisse mortuaire et le squelette tout en- I
tier, étendu tel qu'il avait élé placé, légèrement
couvert de terre ou de poussière humide prove- [
riant des débris de la pression supérieure de la
caisse qui était décomposée, et des vêtements et
des parties molles ; on reconnut clairement que
le tombeau n'avait jamais été ouvert (il était dif-
ficile de croire que les autorités eussent permis
cette indigne mutilation du corps de celui qui
fait tant d'honneur à Rome et au siècle de
Léon X), et il fut alors évidemment prouvé que
le crâne de l'académie de Saint-Luc n'était pas
celui de Raphaël. Le premier soin que l'on prit
fut de dégager peu à peu le corps de toute cette
poussière, que d'ailleurs on recueillit religieuse-
ment, pai'ce qu'on avait l'intenlion de la replacer
dans le nouveau sarcophage. On trouva dans ces
débris des morceaux assez bien conservés de la
caisse qui élait de bois de pin, et des fragments
de peinture qui avaient orné le couvercle, plus
des morceaux d'argile du Tibre: indices qui
prouvent que l'eau du fleuve y avait pénétré au
moins par infiltration; plus une stellelta de fer,
sorte d'éperon dont Raphaël avait été décoré
par Léon X: quelques fibules, beaucoup d'anelli
de métal, partie des boulons du vêtement.
« On reconnut que la caisse avait été immé-
diatement, murée, et que c'est à celte précaution
que l'on doit la conservation des ossements.
« Le 15 septembre on procéda à la recon-
naissance du corps qui fut déclaré appartenir à
un individu du sexe masculin, de petite propor-
tion; l'acte formel fut terminé le 17. Le baron
Trasmondi, professeur de chirurgie, mesura le
corps tel qu'il était étendu: et après avoir fait
les observations convenables sur les ossements
et les isles (os du b issin), et sur le caractère
fort et prononcé qu'ils présentaient, il prouva
le sexe du sujel. Le marquis Biondi, président
de la société d'archéologie, s'appuyant, particu-
lièrement sur les passages de Vasari dans la vie
de Raphaël et de LorenzeUo ; sur la noie qui
précède les œuvres de cet écrivain, imprimées
en 1563; sur la lettre de Michael cli Servettor,
déclara en peu de paroles que ce qu'on voyait |
devant soi était le véritable corps de Raphaël,
et adjura les assistants de dire s'il y avait quel-
que opposition. Plus de soixante-dix personnes
présentes, l'élite de la haute société du pays et
de Rome littéraire, approuvèrent l'opinion de
M. Biondi. Beaucoup ne répondirent que par
des larmes et les signes les plus passionnés d'at-
tendrissement. On signa alors avec empresse-
ment l'acte de reconnaissance. Pirrhon lui-
même, s'il eût été présent, n'aurait pas de bonne
foi montré un seul doute.
« Quant à la manière dont on devait procé-
der, pour mettre ces ossements en sûreté, avec
la plus grande décence, on convint unanime-
ment de s'en rapporter aux dispositions testa-
mentaires de Raphaël lui-même, dont vous con-
naissez bien les dernières volontés; on décida
qu'après avoir posé les ossements dans une
caisse plus solide, de plomb ou de marbre, on
les replacerait au même lieu, en prenant loutes
les précautions contre toute inondation éven-
tuelle du Tibre.
« On va célébrer des funérailles dignes du
lemple et de la gloire de Raphaël. Le baron Ca-
muccini fera le dessin de fout ce que nous avons
vu, et il sera lithographié ; Girometti gravera
une médaille commémorative, et moi je suis
chargé d'écrire le récit qui sera publié.
« Du 20 au 24, le public a été admis à voir le
corps tel qu'il a été trouvé; et vous qui con-
naissez les Romains, vous ne serez pas étonné
d'apprendre que la foule de toute classe a été
innombrable. Le 24, on a enfermé les ossements
dans une caisse provisoire, en attendant la
caisse de marbre ou de plomb qui sera donnée
par le pape.
« Depuis, les observations de M. Trasmondi
et d'autres réflexions ont prouvé la parfaile res-
semblance de ce qui reste de la charpente os-
seuse avec les portraits de Raphaël et avec les
témoignages des contemporains. Le corps est
bien proportionné ; il est haut de sept palmes,
cinq onces et trois minutes (cinq pieds deux
pouces trois lignes) ; la tête, parfaitement con-
servée, a loutes les dents encore très belles, au
nombre de trente-et-une ; la trente-deuxième de
la mâchoire inférieure, à gauche, n'était pas en-
core sortie de l'alvéole. On revoitles linéaments
exacts du portrait dans l'école d'Athènes ; le col
était long; les bras et la poitrine délicats; le
creux, marqué par l'apophyse (protubérance
pointue d'un os) du bras droit, paraît être une
suite du grand exercice clans le travail du des-
sin; les jambes et les pieds étaient assez forts.
Ce qui a surpris tout le monde et avec raison,
c'est qu'on a trouvé le larynx intact et encore
flexible; il était ample, et fait croire que la voix
devait être étendue. Le larynx, exposé depuis
à l'air, a pris une consistance d'ossification;
mais j'en ai reconnu la flexibilité, parce que je
l'ai touché au moment où on a découvert le
corps.
« Jeudi dernier, on a moulé le crâne; l'opé-
ration a réussi parfaitement. Vendredi 18 octo-
bre, l'urne fatale sera inhumée. Dans cette oc-
casion, on illuminera d'une manière magnifique
le Panthéon.
« Ces détails ne peuvent être que précieux
pour un homme qui, comme vous, a voué un
culte éternel à la mémoire de Raphaël, et qui
lui a élevé un monument littéraire qui n'est pas
moins admiré en Italie que dans le reste de
l'Europe. »
E. Legouvé.
LES EXPOSITIONS
Le Salon de la Société des Artistes français.
A part quelques essais intéressants que nous citerons
au cours de cet article, essais bientôt réprimés par
la férule des maîtres, ou la manie de vouloir des ré-
compenses, le Salon est l'éternel recommencement,
l'exposition d'eeuvres d'artistes à court d'idées et
surtout d'idéal, qui retournent et encensent toujours
leurs mêmes idoles. C'est ainsi que le Salon de 1903
ressemble à celui de 1902, comme celui de l'année
prochaine ressemblera à celui de cette année, sans
changement et sans progrès. Tout cela parce que
les artistes limitent trop leur talent à la science du
faire, et que leur seul but est l'obtenlion des médailles
et des croix qui doivent leur rapporter, quelque jour,
dans l'administration compliquée des Beaux-Arts,
un rond de cuir productif, dernière auréole des fruits
secs de l'art.
Dans la grande salle que nous trouvons en entrant,
l'on voit la grande page blanche de M. Bourgonnier,
Plafond destiné à un salon Louis XV; cette composi-
tion manque d'ampleur, et les quelques figures ne
sont pas à l'échelle et se perdent dans un ciel beau-
coup trop lourd. Seuls, les Amours du premier plan
sont bien venus et forment une note heureuse. De
M. Midy, un portrait de femme plein de lumière et
d'air. La Sainte Famille de M. Grosso est dans une
jolie valeur de ton et d'un beau sentiment.
M. Didier Pouget nous paraît dans la plénitude de
son talent, mais ses bruyères me paraissent éternel-
lement la même chose. La marine de M. Hughes
Stanton est bien venue, le ciel même est d'une très
belle hardiesse de touche; nous n'en dirons pa-i autant
du plafond de M. Sciiommer. Jamais cet artisie, qui,
cependant a montré de réelles qualités dans ses
œuvres précédentes, n'a été plus mal inspiré; sa
composition est lourde et emphatique. De M. La
Lyre, une véritable orgie de chairs; c'est là l'exagé-
ration de la forme et de la couleur. Quel peintre dé-
licieux que M. Flameng, avec son Portrait de M]u Sorel,
peinture d'une grande distinction et d'un joli senti-
ment d'art!
Parmi les peintres de fleurs, je signalerai Mmo Foyot
d'Alvar, dont les roses si fraîches et si vivantes mé-
ritent d'attirer l'attention du jury,
j M. Planquette envoie un bon paysage plein de
poésie el d'une note simple, qui prête à la rêverie.
La Catastrophe de la Martinique, de M. Béroud, est
une peinture bien ennuyeuse ; le terrible volcan aurait
bien dû anéantir celle allégorie, cela aurait été le
seul bien de celte effroyable tragédie. Nous trouvons,
à côté, des chevaux de M. Checa, pleins de vie et de
lumière, œuvre d'un talent sain et d'une grande fran-
chise de palette.
Dans la salle 2, le triptyque de M. Geoffroy est
l'œuvre importante de celte salle; c'est le triomphe
de cet artisie. Jamais les (oui petits n'ont été aussi
savoureusement peints; il y a là un effort et une belle
\ exécution.
La Rafle, de M. Devambez, est fort habilement
traitée, bien observée ; c'est là un lableau vécu qui
l'ail honneur à ce peintre.
Les paysages de M. Julien Dupré sont toujours
empreints d'une humidité et d'une fraîcheur de cou-
leur bien particulières à ce peinlre; mais ses ani-
maux manquent de consistance.
Les œuvres de MM. Bouchor et Demarest, deux
artistes hors concours,sont conçues de la même façon:
on dirait le même auteur. Ces deux envois sont\rès
précieux et pleins d'une joliesse infiniment parisienne,
mais ils se nuisent d'être ainsi placés si près l'un de
l'autre.
M. Chartran expose, cetle année, le Portrait du
président Roosevelt et un portrait de femme. Le pre-
mier est d'une touche sèche et maniérée; dans celui
de MmB H..., nous retrouvons le talent el la touche du
maître, mais le séjour en Amérique n'a pas été
! favorable à cet artiste.
\ Jadis M. G. Ferrier exposait des femmes savou-
reuses dans de non moins savoureux coslumes, cette
année, G. Ferrier expose un christ dont le modelé
trop serré, donne de la sécheresse à l'ensemble.
Nous avions déjà vu, dans une salle précédente,
la Catastrophe de la Martinique de M. Béroud, nous
retrouvons ici le portrait du peintre, dans la galerie
des Rubens, au Louvre; le peintres'e-t représenté
faisant une copie. l'influence de Rubens ne peut
être que salutaire à M. Béroud, qui aurait bien dû
s'en rappeler en concevant la liguée de sa catas-
trophe.
M. Bordes nous a accoutumé à des envois, chaque
année, pleins de talent; cette année encore, l'envoi
de cet artiste, est d'une bien jolie couleur.
Les Chanteurs dans la rue, de M. V. Gilbert, sont
faussement éclairés ; jamais une lampe n'a éclairé
comme le plein jour, et des reflets dorés sur loutes
ces tètes seraient d'un effet plus heureux.
Le lableau de M. Dayvant est une expression très
juste, trèi vibrante ; c'est là une belle œuvre. Je
dirai de même de l'œuvre de M"0 Desportes, d'une
bien juste inspiration et très bien composée.
Dans le portrait de M. Demizel, nous trouvons une
hardiesse peul-être un peu téméraire, mais d'une
pâte vraiment remarquable; c'est d'une franchise un
peu brusque, mais pleine de talent.
Avec M. Gagliardini nous avons l'éternel soleil :
voilà de la lumière, c'est entendu, mais de la lumière
un peu trop électrique !
Nous trouvons en cette salle, de M. Etcheverry,
Vertige ; ce tableau aura beaucoup de succès et
plaira au public, au grand public, par le petit drime
qui se passe; il plaira aussi aux peintres, cir les
ligures sont trè-i jolimenl composées, bien dessinées
et bien peintes ; nous retrouvons l'auteur de Ils ne
lisaient plus, mais avec plus de force et plus de talent.
M. Dupuy a définitivement élu domicile dans les
jardins du Luxembourg; son tableau est un bel envoi,
mais la composition est un peu serrée, et les derniers
plans pas assez sacrifiés ; c'est cependant bien de
couleur et puissant de facture.
La salle 10 appartient à Hébert. Quel délicieux
maître ! Que de ravissement à regarder ses œuvres!
11 y a des profondeurs infiniment supeibes et des
langueurs de touches géniales, et c'est d'une couleur
merveilleuse. L'Ecole française peut être fière d'avoir
un tel artiste.
Les deux envois de M. F. HuiiBERTont vraimentdu
charme, c'est d'un joli mouvement, et ses façons de
ne pas finir ne sont pas faites pour déplaire.
Les deux tableaux de Henner sont d'une habileté
incomparable, mais bien toujours la même chose.
M. L. Printemps envoie une Vénus; le sentiment
et la délicatesse sont le propre de cet artiste, et nous
retrouvons en ce lableau tout le charme de ses pré-
cédentes compositions.
M. Luigi Loir nous avait habitué à des tableaux
lumineux moins éclairés, il est vrai que c'est l'expo-
sition avec toutes ses lumières et ses lampions.
La Madeleine, de M. Lefèvre, est vraiment admi-
rable, mais c'est d'une transparence d'aquarelle un
peu poussée.
M, Maxence a toujours une merveilleuse harmonie
de tons, et malgré ses couleurs atténuées, et quoique