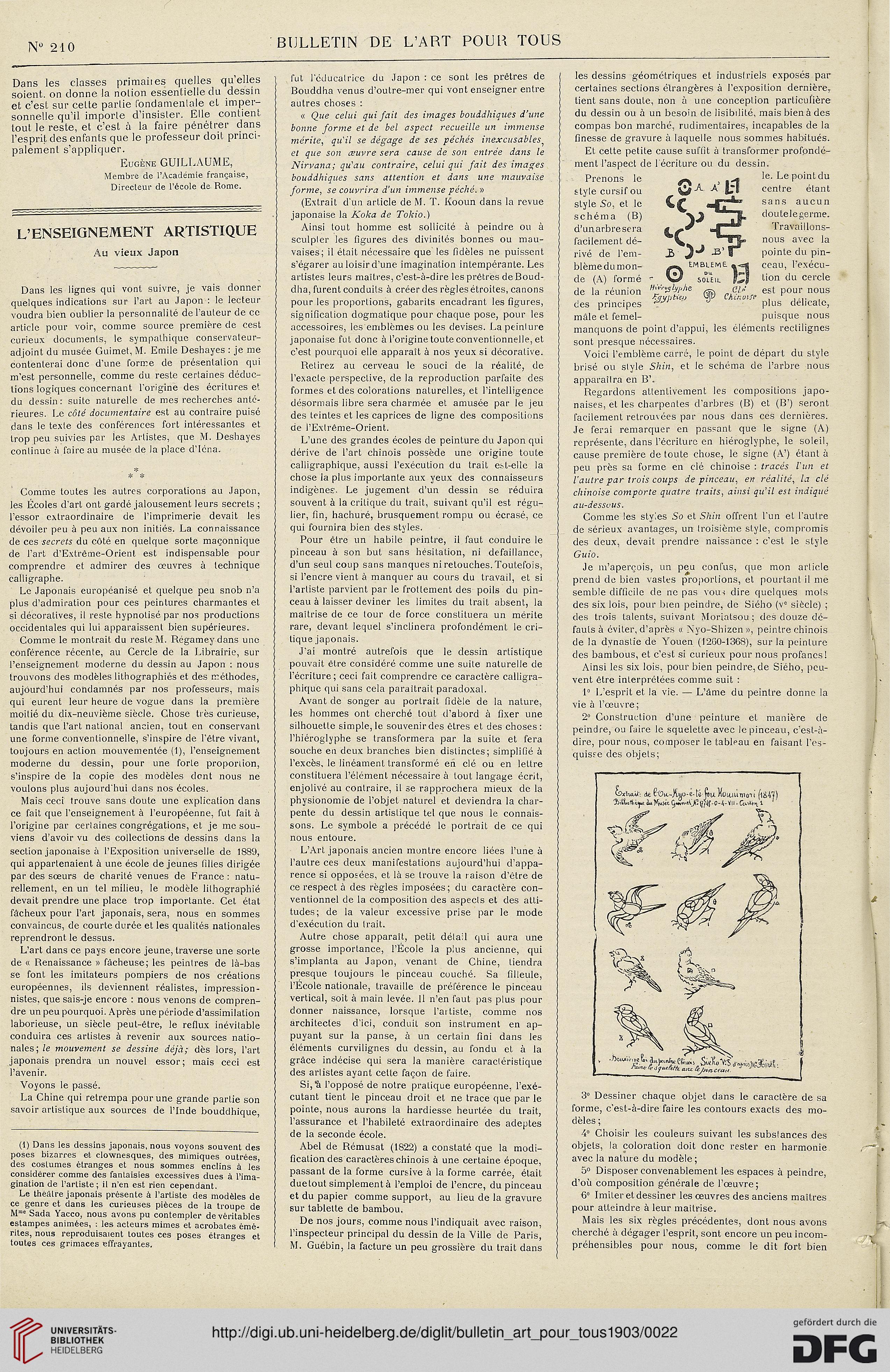N° 210
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
Dans les classes primaiies quelles quelles j fut lcducalrice du Japon : ce sont les prêtres de
soient, on donne la notion essentielle du dessin j Bouddha venus d'outre-mer qui vont enseigner entre
et c'est sur cette partie fondamentale et imper-
sonnelle qu'il importe d'insister. Elle contient
tout le reste, et c'est à la faire pénétrer dans
l'esprit des enfants que le professeur doit princi-
palement s'appliquer.
Eugène GUILLAUME,
Membre de l'Académie française,
Directeur de l'école de Rome.
les dessins géométriques et industriels exposés par
certaines sections étrangères à l'exposition dernière,
autres choses : tient sans doute, non à une conception particulière
« Que celui qui fait des images bouddhiques d'une du dessin ou à un besoin de lisibilité, mais bien à des
bonne forme et de bel aspect recueille un immense compas bon marché, rudimentaires, incapables de la
mérite, qiCil se dégage de ses péchés inexcusables^ finesse de gravure à laquelle nous sommes habitués.
et que son œuvre sera cause de son entrée dans le Et cette petite cause suffit à transformer profondé-
L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Au vieux Japon
Dans les lignes qui vont suivre, je vais donner
quelques indications sur l'art au Japon : le lecteur
voudra bien oublier la personnalité de l'auteur de ce
article pour voir, comme source première de cest
curieux documents, le sympathique conservateur-
adjoint du musée Guimet, M. Emile Deshayes : je me
contenterai donc d'une forme de présentation qui
m'est personnelle, comme du reste certaines déduc-
tions logiques concernant l'origine des écritures et
du dessin: suite naturelle de mes recherches anté-
rieures. Le côté documentaire est au contraire puisé
dans le texte des conférences fort intéressantes et
trop peu suivies par les Artistes, que M. Deshayes
continue à faire au musée de la place d'iéna.
Comme toutes les autres corporations au Japon,
les Écoles d'art ont gardé jalousement leurs secrets ;
l'essor extraordinaire de l'imprimerie devait les
dévoiler peu à peu aux non initiés. La connaissance
de ces secrets du côté en quelque sorte maçonnique
de l'art d'Extrême-Orient est indispensable pour
comprendre et admirer des œuvres à technique
calligraphe.
Le Japonais européanisé et quelque peu snob n'a
plus d'admiration pour ces peintures charmantes et
si décoratives, il reste hypnotisé par nos productions
occidentales qui lui apparaissent bien supérieures.
Comme le montrait du reste M. Regamey clans une
conférence récente, au Cercle de la Librairie, sur
l'enseignement moderne du dessin au Japon : nous
trouvons des modèles lithographiés et des méthodes,
aujourd'hui condamnés par nos professeurs, mais
qui eurent leur heure de vogue dans la première
moitié du dix-neuvième siècle. Chose très curieuse,
tandis que l'art national ancien, tout en conservant
une forme conventionnelle, s'inspire de l'être vivant,
toujours en action mouvementée (1), l'enseignement
moderne du dessin, pour une forte proportion,
ment l'aspect de récriture ou du dessin.
Prenons le ^ , le. Le point du
style cursifou 0A A V* centre étant
style So, et le Cf HE*"* SanS aucun
schéma (B) 'i-^ T_Tf* douteleScrme-
d'unarbresera g ~+ J—** Travaillons-
Nirvana; qu'au contraire, celui qui fait des images
bouddhiques sans attention et dans une mauvaise
forme, se couvrira d'un immense péché. »
(Extrait d'un article de M. T. Kooun dans la revue
japonaise la Koka de Tokio.)
Ainsi tout homme est sollicité à peindre ou à
sculpler les figures des divinités bonnes ou mau- j facilement dé- * B |» nous avec la
vaises; il était nécessaire que les fidèles ne puissent rivé de fera- _B -b'■ pointe du pin-
s'égarer au loisir d'une imagination intempérante. Les blèmedumon- —emblème-^* ccau, l'exécu-
artistes leurs maîtres, c'est-à-dire les prêtres de Boud- cie (a.) formé - soleil fZ'f L'on c'u cerc'e
dha, furent conduits à créer des règles étroites, canons cje la réunion W'Vlhphe ^ GL-' est pour nous
pour les proportions, gabarits encadrant les figures, ,jes principes >C" 'f* ' plus délicate,
signification dogmatique pour chaque pose, pour les mâle et femel- puisque nous
accessoires, les emblèmes ou les devises. La peinlure manquons de point d'appui, les éléments rectilignes
japonaise fut donc à l'origine toute conventionnelle, et sont presque nécessaires.
c'est pourquoi elle apparaît à nos yeux si décorative. Voici l'emblème carré, le point de départ du style
Retirez au cerveau le souci de la réalité, de brisé ou style Shin, et le schéma de l'arbre nous
l'exacte perspective, de la reproduction parfaite des apparaîtra en B\
formes et des colorations naturelles, et l'intelligence
désormais libre sera charmée et amusée par le jeu
des teintes et les caprices de ligne des compositions
de l'Extrême-Orient.
L'une des grandes écoles de peinture du Japon qui
dérive de l'art chinois possède une origine toute
calligraphique, aussi l'exécution du trait est-elle la
chose la plus importante aux yeux des connaisseurs
indigènes. Le jugement d'un dessin se réduira
souvent à la critique du trait, suivant qu'il est régu-
lier, fin, hachuré, brusquement rompu ou écrasé, ce
qui fournira bien des styles.
Pour être un habile peintre, il faut conduire le
pinceau à son but sans hésitation, ni défaillance,
d'un seul coup sans manques ni retouches. Toutefois,
si l'encre vient à manquer au cours du travail, et si
l'artiste parvient par le frottement des poils du pin-
ceau à laisser deviner les limites du trait absent, la
maîtrise de ce tour de force constituera un mérite
rare, devant lequel s'inclinera profondément le cri-
tique japonais.
J'ai montré autrefois que le dessin artistique
pouvait être considéré comme une suite naturelle de
l'écriture; ceci fait comprendre ce caractère calligra-
phique qui sans cela paraîtrait paradoxal.
Avant de songer au portrait fidèle de la nature,
les hommes ont cherché tout d'abord à fixer une
silhouette simple, le souvenir des êtres et des choses:
l'hiéroglyphe se transformera par la suite et fera
souche en deux branches bien distinctes; simplifié à
l'excès, le linéament transformé en clé ou en lettre
s'inspire de la copie des modèles dont nous ne constituera l'élément nécessaire à tout langage écrit,
voulons plus aujourd'hui dans nos écoles.
Mais ceci trouve sans cloute une explication clans
ce fait que l'enseignement à l'européenne, fut fait à
l'origine par cerlaines congrégations, et je me sou-
viens d'avoir vu des collections de dessins dans la
section japonaise à l'Exposition universelle de 1889,
qui appartenaient à une école déjeunes filles dirigée
par des sœurs de charité venues de France : natu-
rellement, en un tel milieu, le modèle lithographie
devait prendre une place trop importante. Cet état
fâcheux pour l'art japonais, sera, nous en sommes
convaincus, de courte durée et les qualités nationales
reprendront le dessus.
L'art dans ce pays encore jeune, traverse une sorte
de « Renaissance » fâcheuse; les peintres de là-bas
se font les imitateurs pompiers de nos créations
européennes, ils deviennent réalistes, impression-
nistes, que sais-je encore : nous venons de compren-
dre un peu pourquoi. Après une période d'assimilation
laborieuse, un siècle peut-être, le reflux inévitable
conduira ces artistes à revenir aux sources natio-
nales; le mouvement se dessine déjà; dès lors, l'art
japonais prendra un nouvel essor; mais ceci est
l'avenir.
Voyons le passé.
La Chine qui retrempa pour une grande partie son
savoir artistique aux sources de l'Inde bouddhique,
(1) Dans les dessins japonais, nous voyons souvent des
poses bizarres et clownesques, des mimiques outrées,
des costumes étranges et nous sommes enclins à les
considérer comme des fantaisies excessives dues à l'ima-
gination de l'artiste; il n'en est rien cependant.
Le thèàlre japonais présente à l'artiste des modèles de
ce genre et dans les curieuses pièces de la troupe de
Mme Sada Yacco, nous avons pu contempler de véritables
estampes animées, : les acteurs mimes et acrobates émé-
rites, nous reproduisaient toutes ces poses étranges et
toutes ces grimaces effrayantes.
enjolivé au contraire, il se rapprochera mieux de la
physionomie de l'objet naturel et deviendra la char-
pente du dessin artistique tel que nous le connais-
sons. Le symbole a précédé le portrait de ce qui
nous entoure.
L'Art japonais ancien montre encore liées l'une à
l'autre ces deux manifestations aujourd'hui d'appa-
rence si opposées, et là se trouve la raison d'être de
ce respect à des règles imposées; du caractère con-
ventionnel de la composition des aspects et des atti-
tudes; de la valeur excessive prise par le mode
d'exécution du Irait.
Autre chose apparaît, petit détail qui aura une
grosse importance, l'Ecole la plus ancienne, qui
s'implanta au Japon, venant de Chine, tiendra
presque toujours le pinceau couché. Sa filleule,
l'Ecole nationale, travaille de préférence le pinceau
vertical, soit à main levée. 11 n'en faut pas plus pour
donner naissance, lorsque l'artiste, comme nos
architectes d'ici, conduit son instrument en ap-
puyant sur la panse, à un certain fini dans les
éléments curvilignes du dessin, au fondu et à la
grâce indécise qui sera la manière caractéristique
des artistes ayant cette façon de l'aire.
Si, "à l'opposé de notre pratique européenne, l'exé-
cutant tient le pinceau droit et ne trace que par le
pointe, nous aurons la hardiesse heurtée du trait,
l'assurance et l'habileté extraordinaire des adeptes
de la seconde école.
Abel de Rémusat (1822) a constaté que la modi-
fication des caractères chinois à une certaine époque,
passant de la forme cursive à la forme carrée, était
duetout simplement à l'emploi de l'encre, du pinceau
et du papier comme support, au lieu de la gravure
sur tablette de bambou.
De nos jours, comme nous l'indiquait avec raison,
l'inspecteur principal du dessin de la Ville de Paris,
M. Guébin, la facture un peu grossière du trait dans
Regardons attentivement les compositions japo-
naises, et les charpentes d'arbres (B) et (B') seront
facilement retrouvées par nous dans ces dernières.
Je ferai remarquer en passant que le signe (A)
représente, dans l'écriture en hiéroglyphe, le soleil,
cause première de toute chose, le signe (A') étant à
peu près sa forme en clé chinoise : tracés l'un et
l'autre par trois coups de pinceau, en réalité, la clé
chinoise comporte quatre traits, ainsi qu'il est indiqué
au-dessous.
Comme les styles So et Shin offrent l'un et l'autre
de sérieux avantages, un troisième style, compromis
des deux, devait prendre naissance : c'est le style
Guio.
Je m'aperçois, un peu confus, (pie mon article
prend de bien vastes proportions, et pourtant il me
semble difficile de ne pas vous dire quelques mots
des six lois, pour bien peindre, de Siého (vc siècle) ;
des trois talents, suivant Moriatsou ; des douze dé-
fauts à éviter, d'après « Nyo-Shizen », peintre chinois
de la dynastie de Youen (12G0-1368), sur la peinture
des bambous, et c'est si curieux pour nous profanes!
Ainsi les six lois, pour bien peindre, de Siého, peu-
vent être interprétées comme suit :
1° L'esprit et la vie. — L'âme du peintre donne la
vie à l'œuvre;
2° Construction d'une peinture et manière de
peindre, ou faire le squelette avec le pinceau, c'est-à-
dire, pour nous, composer le tablpau en faisant l'es-
quisse des objets;
bxhoM: de (?Ou.-Auo-e-té (oulWmnio-it (lM7)
3° Dessiner chaque objet dans le caractère de sa
forme, c'est-à-dire faire les contours exacts des mo-
dèles ;
4" Choisir les couleurs suivant les substances des
objets, la coloration doit donc rester en harmonie
avec la nature du modèle ;
5° Disposer convenablement les espaces à peindre,
d'où composition générale de l'œuvre;
6° Imiter et dessiner les œuvres des anciens maîtres
pour atteindre à leur maîtrise.
Mais les six règles précédentes, dont nous avons
cherché à dégager l'esprit, sont encore un peu incom-
préhensibles pour nous, comme le dit fort bien
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
Dans les classes primaiies quelles quelles j fut lcducalrice du Japon : ce sont les prêtres de
soient, on donne la notion essentielle du dessin j Bouddha venus d'outre-mer qui vont enseigner entre
et c'est sur cette partie fondamentale et imper-
sonnelle qu'il importe d'insister. Elle contient
tout le reste, et c'est à la faire pénétrer dans
l'esprit des enfants que le professeur doit princi-
palement s'appliquer.
Eugène GUILLAUME,
Membre de l'Académie française,
Directeur de l'école de Rome.
les dessins géométriques et industriels exposés par
certaines sections étrangères à l'exposition dernière,
autres choses : tient sans doute, non à une conception particulière
« Que celui qui fait des images bouddhiques d'une du dessin ou à un besoin de lisibilité, mais bien à des
bonne forme et de bel aspect recueille un immense compas bon marché, rudimentaires, incapables de la
mérite, qiCil se dégage de ses péchés inexcusables^ finesse de gravure à laquelle nous sommes habitués.
et que son œuvre sera cause de son entrée dans le Et cette petite cause suffit à transformer profondé-
L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Au vieux Japon
Dans les lignes qui vont suivre, je vais donner
quelques indications sur l'art au Japon : le lecteur
voudra bien oublier la personnalité de l'auteur de ce
article pour voir, comme source première de cest
curieux documents, le sympathique conservateur-
adjoint du musée Guimet, M. Emile Deshayes : je me
contenterai donc d'une forme de présentation qui
m'est personnelle, comme du reste certaines déduc-
tions logiques concernant l'origine des écritures et
du dessin: suite naturelle de mes recherches anté-
rieures. Le côté documentaire est au contraire puisé
dans le texte des conférences fort intéressantes et
trop peu suivies par les Artistes, que M. Deshayes
continue à faire au musée de la place d'iéna.
Comme toutes les autres corporations au Japon,
les Écoles d'art ont gardé jalousement leurs secrets ;
l'essor extraordinaire de l'imprimerie devait les
dévoiler peu à peu aux non initiés. La connaissance
de ces secrets du côté en quelque sorte maçonnique
de l'art d'Extrême-Orient est indispensable pour
comprendre et admirer des œuvres à technique
calligraphe.
Le Japonais européanisé et quelque peu snob n'a
plus d'admiration pour ces peintures charmantes et
si décoratives, il reste hypnotisé par nos productions
occidentales qui lui apparaissent bien supérieures.
Comme le montrait du reste M. Regamey clans une
conférence récente, au Cercle de la Librairie, sur
l'enseignement moderne du dessin au Japon : nous
trouvons des modèles lithographiés et des méthodes,
aujourd'hui condamnés par nos professeurs, mais
qui eurent leur heure de vogue dans la première
moitié du dix-neuvième siècle. Chose très curieuse,
tandis que l'art national ancien, tout en conservant
une forme conventionnelle, s'inspire de l'être vivant,
toujours en action mouvementée (1), l'enseignement
moderne du dessin, pour une forte proportion,
ment l'aspect de récriture ou du dessin.
Prenons le ^ , le. Le point du
style cursifou 0A A V* centre étant
style So, et le Cf HE*"* SanS aucun
schéma (B) 'i-^ T_Tf* douteleScrme-
d'unarbresera g ~+ J—** Travaillons-
Nirvana; qu'au contraire, celui qui fait des images
bouddhiques sans attention et dans une mauvaise
forme, se couvrira d'un immense péché. »
(Extrait d'un article de M. T. Kooun dans la revue
japonaise la Koka de Tokio.)
Ainsi tout homme est sollicité à peindre ou à
sculpler les figures des divinités bonnes ou mau- j facilement dé- * B |» nous avec la
vaises; il était nécessaire que les fidèles ne puissent rivé de fera- _B -b'■ pointe du pin-
s'égarer au loisir d'une imagination intempérante. Les blèmedumon- —emblème-^* ccau, l'exécu-
artistes leurs maîtres, c'est-à-dire les prêtres de Boud- cie (a.) formé - soleil fZ'f L'on c'u cerc'e
dha, furent conduits à créer des règles étroites, canons cje la réunion W'Vlhphe ^ GL-' est pour nous
pour les proportions, gabarits encadrant les figures, ,jes principes >C" 'f* ' plus délicate,
signification dogmatique pour chaque pose, pour les mâle et femel- puisque nous
accessoires, les emblèmes ou les devises. La peinlure manquons de point d'appui, les éléments rectilignes
japonaise fut donc à l'origine toute conventionnelle, et sont presque nécessaires.
c'est pourquoi elle apparaît à nos yeux si décorative. Voici l'emblème carré, le point de départ du style
Retirez au cerveau le souci de la réalité, de brisé ou style Shin, et le schéma de l'arbre nous
l'exacte perspective, de la reproduction parfaite des apparaîtra en B\
formes et des colorations naturelles, et l'intelligence
désormais libre sera charmée et amusée par le jeu
des teintes et les caprices de ligne des compositions
de l'Extrême-Orient.
L'une des grandes écoles de peinture du Japon qui
dérive de l'art chinois possède une origine toute
calligraphique, aussi l'exécution du trait est-elle la
chose la plus importante aux yeux des connaisseurs
indigènes. Le jugement d'un dessin se réduira
souvent à la critique du trait, suivant qu'il est régu-
lier, fin, hachuré, brusquement rompu ou écrasé, ce
qui fournira bien des styles.
Pour être un habile peintre, il faut conduire le
pinceau à son but sans hésitation, ni défaillance,
d'un seul coup sans manques ni retouches. Toutefois,
si l'encre vient à manquer au cours du travail, et si
l'artiste parvient par le frottement des poils du pin-
ceau à laisser deviner les limites du trait absent, la
maîtrise de ce tour de force constituera un mérite
rare, devant lequel s'inclinera profondément le cri-
tique japonais.
J'ai montré autrefois que le dessin artistique
pouvait être considéré comme une suite naturelle de
l'écriture; ceci fait comprendre ce caractère calligra-
phique qui sans cela paraîtrait paradoxal.
Avant de songer au portrait fidèle de la nature,
les hommes ont cherché tout d'abord à fixer une
silhouette simple, le souvenir des êtres et des choses:
l'hiéroglyphe se transformera par la suite et fera
souche en deux branches bien distinctes; simplifié à
l'excès, le linéament transformé en clé ou en lettre
s'inspire de la copie des modèles dont nous ne constituera l'élément nécessaire à tout langage écrit,
voulons plus aujourd'hui dans nos écoles.
Mais ceci trouve sans cloute une explication clans
ce fait que l'enseignement à l'européenne, fut fait à
l'origine par cerlaines congrégations, et je me sou-
viens d'avoir vu des collections de dessins dans la
section japonaise à l'Exposition universelle de 1889,
qui appartenaient à une école déjeunes filles dirigée
par des sœurs de charité venues de France : natu-
rellement, en un tel milieu, le modèle lithographie
devait prendre une place trop importante. Cet état
fâcheux pour l'art japonais, sera, nous en sommes
convaincus, de courte durée et les qualités nationales
reprendront le dessus.
L'art dans ce pays encore jeune, traverse une sorte
de « Renaissance » fâcheuse; les peintres de là-bas
se font les imitateurs pompiers de nos créations
européennes, ils deviennent réalistes, impression-
nistes, que sais-je encore : nous venons de compren-
dre un peu pourquoi. Après une période d'assimilation
laborieuse, un siècle peut-être, le reflux inévitable
conduira ces artistes à revenir aux sources natio-
nales; le mouvement se dessine déjà; dès lors, l'art
japonais prendra un nouvel essor; mais ceci est
l'avenir.
Voyons le passé.
La Chine qui retrempa pour une grande partie son
savoir artistique aux sources de l'Inde bouddhique,
(1) Dans les dessins japonais, nous voyons souvent des
poses bizarres et clownesques, des mimiques outrées,
des costumes étranges et nous sommes enclins à les
considérer comme des fantaisies excessives dues à l'ima-
gination de l'artiste; il n'en est rien cependant.
Le thèàlre japonais présente à l'artiste des modèles de
ce genre et dans les curieuses pièces de la troupe de
Mme Sada Yacco, nous avons pu contempler de véritables
estampes animées, : les acteurs mimes et acrobates émé-
rites, nous reproduisaient toutes ces poses étranges et
toutes ces grimaces effrayantes.
enjolivé au contraire, il se rapprochera mieux de la
physionomie de l'objet naturel et deviendra la char-
pente du dessin artistique tel que nous le connais-
sons. Le symbole a précédé le portrait de ce qui
nous entoure.
L'Art japonais ancien montre encore liées l'une à
l'autre ces deux manifestations aujourd'hui d'appa-
rence si opposées, et là se trouve la raison d'être de
ce respect à des règles imposées; du caractère con-
ventionnel de la composition des aspects et des atti-
tudes; de la valeur excessive prise par le mode
d'exécution du Irait.
Autre chose apparaît, petit détail qui aura une
grosse importance, l'Ecole la plus ancienne, qui
s'implanta au Japon, venant de Chine, tiendra
presque toujours le pinceau couché. Sa filleule,
l'Ecole nationale, travaille de préférence le pinceau
vertical, soit à main levée. 11 n'en faut pas plus pour
donner naissance, lorsque l'artiste, comme nos
architectes d'ici, conduit son instrument en ap-
puyant sur la panse, à un certain fini dans les
éléments curvilignes du dessin, au fondu et à la
grâce indécise qui sera la manière caractéristique
des artistes ayant cette façon de l'aire.
Si, "à l'opposé de notre pratique européenne, l'exé-
cutant tient le pinceau droit et ne trace que par le
pointe, nous aurons la hardiesse heurtée du trait,
l'assurance et l'habileté extraordinaire des adeptes
de la seconde école.
Abel de Rémusat (1822) a constaté que la modi-
fication des caractères chinois à une certaine époque,
passant de la forme cursive à la forme carrée, était
duetout simplement à l'emploi de l'encre, du pinceau
et du papier comme support, au lieu de la gravure
sur tablette de bambou.
De nos jours, comme nous l'indiquait avec raison,
l'inspecteur principal du dessin de la Ville de Paris,
M. Guébin, la facture un peu grossière du trait dans
Regardons attentivement les compositions japo-
naises, et les charpentes d'arbres (B) et (B') seront
facilement retrouvées par nous dans ces dernières.
Je ferai remarquer en passant que le signe (A)
représente, dans l'écriture en hiéroglyphe, le soleil,
cause première de toute chose, le signe (A') étant à
peu près sa forme en clé chinoise : tracés l'un et
l'autre par trois coups de pinceau, en réalité, la clé
chinoise comporte quatre traits, ainsi qu'il est indiqué
au-dessous.
Comme les styles So et Shin offrent l'un et l'autre
de sérieux avantages, un troisième style, compromis
des deux, devait prendre naissance : c'est le style
Guio.
Je m'aperçois, un peu confus, (pie mon article
prend de bien vastes proportions, et pourtant il me
semble difficile de ne pas vous dire quelques mots
des six lois, pour bien peindre, de Siého (vc siècle) ;
des trois talents, suivant Moriatsou ; des douze dé-
fauts à éviter, d'après « Nyo-Shizen », peintre chinois
de la dynastie de Youen (12G0-1368), sur la peinture
des bambous, et c'est si curieux pour nous profanes!
Ainsi les six lois, pour bien peindre, de Siého, peu-
vent être interprétées comme suit :
1° L'esprit et la vie. — L'âme du peintre donne la
vie à l'œuvre;
2° Construction d'une peinture et manière de
peindre, ou faire le squelette avec le pinceau, c'est-à-
dire, pour nous, composer le tablpau en faisant l'es-
quisse des objets;
bxhoM: de (?Ou.-Auo-e-té (oulWmnio-it (lM7)
3° Dessiner chaque objet dans le caractère de sa
forme, c'est-à-dire faire les contours exacts des mo-
dèles ;
4" Choisir les couleurs suivant les substances des
objets, la coloration doit donc rester en harmonie
avec la nature du modèle ;
5° Disposer convenablement les espaces à peindre,
d'où composition générale de l'œuvre;
6° Imiter et dessiner les œuvres des anciens maîtres
pour atteindre à leur maîtrise.
Mais les six règles précédentes, dont nous avons
cherché à dégager l'esprit, sont encore un peu incom-
préhensibles pour nous, comme le dit fort bien