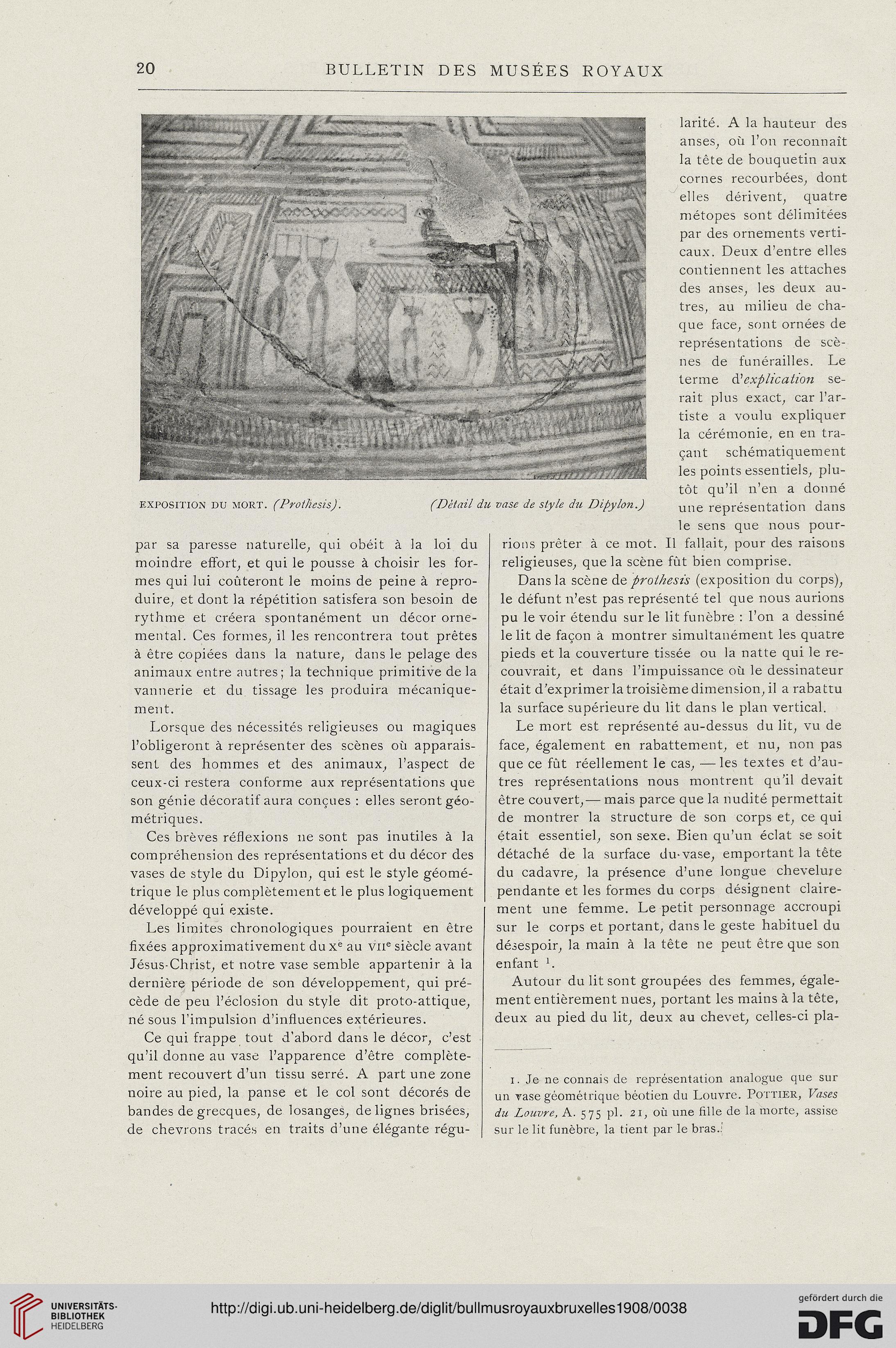20
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
exposition du mort. (Proihesis).
par sa paresse naturelle, qui obéit à la loi du
moindre effort, et qui le pousse à choisir les for-
mes qui lui coûteront le moins de peine à repro-
duire, et dont la répétition satisfera son besoin de
rythme et créera spontanément un décor orne-
mental. Ces formes, il les rencontrera tout prêtes
à être copiées dans la nature, dans le pelage des
animaux entre autres ; la technique primitive de la
vannerie et du tissage les produira mécanique-
ment.
Lorsque des nécessités religieuses ou magiques
l’obligeront à représenter des scènes où apparais-
sent des hommes et des animaux, l’aspect de
ceux-ci restera conforme aux représentations que
son génie décoratif aura conçues : elles seront géo-
métriques.
Ces brèves réflexions 11e sont pas inutiles à la
compréhension des représentations et du décor des
vases de style du Dipylon, qui est le style géomé-
trique le plus complètement et le plus logiquement
développé qui existe.
Les limites chronologiques pourraient en être
fixées approximativement du Xe au vne siècle avant
Jésus-Christ, et notre vase semble appartenir à la
dernière période de son développement, qui pré-
cède de peu l’éclosion du style dit proto-attique,
né sous l'impulsion d'influences extérieures.
Ce qui frappe tout d'abord dans le décor, c’est
qu’il donne au vase l’apparence d’être complète-
ment recouvert d’un tissu serré. A part une zone
noire au pied, la panse et le col sont décorés de
bandes de grecques, de losanges, de lignes brisées,
de chevrons tracés en traits d’une élégante régu-
larité. A la hauteur des
anses, où l’on reconnaît
la tête de bouquetin aux
cornes recourbées, dont
elles dérivent, quatre
métopes sont délimitées
par des ornements verti-
caux. Deux d’entre elles
contiennent les attaches
des anses, les deux au-
tres, au milieu de cha-
que face, sont ornées de
représentations de scè-
nes de funérailles. Le
terme d'explication se-
rait plus exact, car l’ar-
tiste a voulu expliquer
la cérémonie, en en tra-
çant schématiquement
les points essentiels, plu-
tôt qu’il n’en a donné
une représentation dans
le sens que nous pour-
rions prêter à ce mot. Il fallait, pour des raisons
religieuses, que la scène fût bien comprise.
Dans la scène de proihesis (exposition du corps),
le défunt n’est pas représenté tel que nous aurions
pu le voir étendu sur le lit funèbre : l’on a dessiné
le lit de façon à montrer simultanément les quatre
pieds et la couverture tissée ou la natte qui le re-
couvrait, et dans l’impuissance où le dessinateur
était d'exprimer la troisième dimension, il a rabattu
la surface supérieure du lit dans le plan vertical.
Le mort est représenté au-dessus du lit, vu de
face, également en rabattement, et nu, non pas
que ce fût réellement le cas, —les textes et d’au-
tres représentations nous montrent qu’il devait
être couvert,-— mais parce que la nudité permettait
de montrer la structure de son corps et, ce qui
était essentiel, son sexe. Bien qu’un éclat se soit
détaché de la surface du-vase, emportant la tête
du cadavre, la présence d’une longue chevelure
pendante et les formes du corps désignent claire-
ment une femme. Le petit personnage accroupi
sur le corps et portant, dans le geste habituel du
désespoir, la main à la tête ne peut être que son
enfant 1.
Autour du lit sont groupées des femmes, égale-
ment entièrement nues, portant les mains à la tête,
deux au pied du lit, deux au chevet, celles-ci pla-
1. Je ne connais de représentation analogue que sur
un rase géométrique béotien du Louvre. Pottier, Vases
du Louvre, A. 575 pl. 21, où une fille de la morte, assise
sur le lit funèbre, la tient par le bras.-
(Detail du vase de style du Dipylon.)
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
exposition du mort. (Proihesis).
par sa paresse naturelle, qui obéit à la loi du
moindre effort, et qui le pousse à choisir les for-
mes qui lui coûteront le moins de peine à repro-
duire, et dont la répétition satisfera son besoin de
rythme et créera spontanément un décor orne-
mental. Ces formes, il les rencontrera tout prêtes
à être copiées dans la nature, dans le pelage des
animaux entre autres ; la technique primitive de la
vannerie et du tissage les produira mécanique-
ment.
Lorsque des nécessités religieuses ou magiques
l’obligeront à représenter des scènes où apparais-
sent des hommes et des animaux, l’aspect de
ceux-ci restera conforme aux représentations que
son génie décoratif aura conçues : elles seront géo-
métriques.
Ces brèves réflexions 11e sont pas inutiles à la
compréhension des représentations et du décor des
vases de style du Dipylon, qui est le style géomé-
trique le plus complètement et le plus logiquement
développé qui existe.
Les limites chronologiques pourraient en être
fixées approximativement du Xe au vne siècle avant
Jésus-Christ, et notre vase semble appartenir à la
dernière période de son développement, qui pré-
cède de peu l’éclosion du style dit proto-attique,
né sous l'impulsion d'influences extérieures.
Ce qui frappe tout d'abord dans le décor, c’est
qu’il donne au vase l’apparence d’être complète-
ment recouvert d’un tissu serré. A part une zone
noire au pied, la panse et le col sont décorés de
bandes de grecques, de losanges, de lignes brisées,
de chevrons tracés en traits d’une élégante régu-
larité. A la hauteur des
anses, où l’on reconnaît
la tête de bouquetin aux
cornes recourbées, dont
elles dérivent, quatre
métopes sont délimitées
par des ornements verti-
caux. Deux d’entre elles
contiennent les attaches
des anses, les deux au-
tres, au milieu de cha-
que face, sont ornées de
représentations de scè-
nes de funérailles. Le
terme d'explication se-
rait plus exact, car l’ar-
tiste a voulu expliquer
la cérémonie, en en tra-
çant schématiquement
les points essentiels, plu-
tôt qu’il n’en a donné
une représentation dans
le sens que nous pour-
rions prêter à ce mot. Il fallait, pour des raisons
religieuses, que la scène fût bien comprise.
Dans la scène de proihesis (exposition du corps),
le défunt n’est pas représenté tel que nous aurions
pu le voir étendu sur le lit funèbre : l’on a dessiné
le lit de façon à montrer simultanément les quatre
pieds et la couverture tissée ou la natte qui le re-
couvrait, et dans l’impuissance où le dessinateur
était d'exprimer la troisième dimension, il a rabattu
la surface supérieure du lit dans le plan vertical.
Le mort est représenté au-dessus du lit, vu de
face, également en rabattement, et nu, non pas
que ce fût réellement le cas, —les textes et d’au-
tres représentations nous montrent qu’il devait
être couvert,-— mais parce que la nudité permettait
de montrer la structure de son corps et, ce qui
était essentiel, son sexe. Bien qu’un éclat se soit
détaché de la surface du-vase, emportant la tête
du cadavre, la présence d’une longue chevelure
pendante et les formes du corps désignent claire-
ment une femme. Le petit personnage accroupi
sur le corps et portant, dans le geste habituel du
désespoir, la main à la tête ne peut être que son
enfant 1.
Autour du lit sont groupées des femmes, égale-
ment entièrement nues, portant les mains à la tête,
deux au pied du lit, deux au chevet, celles-ci pla-
1. Je ne connais de représentation analogue que sur
un rase géométrique béotien du Louvre. Pottier, Vases
du Louvre, A. 575 pl. 21, où une fille de la morte, assise
sur le lit funèbre, la tient par le bras.-
(Detail du vase de style du Dipylon.)