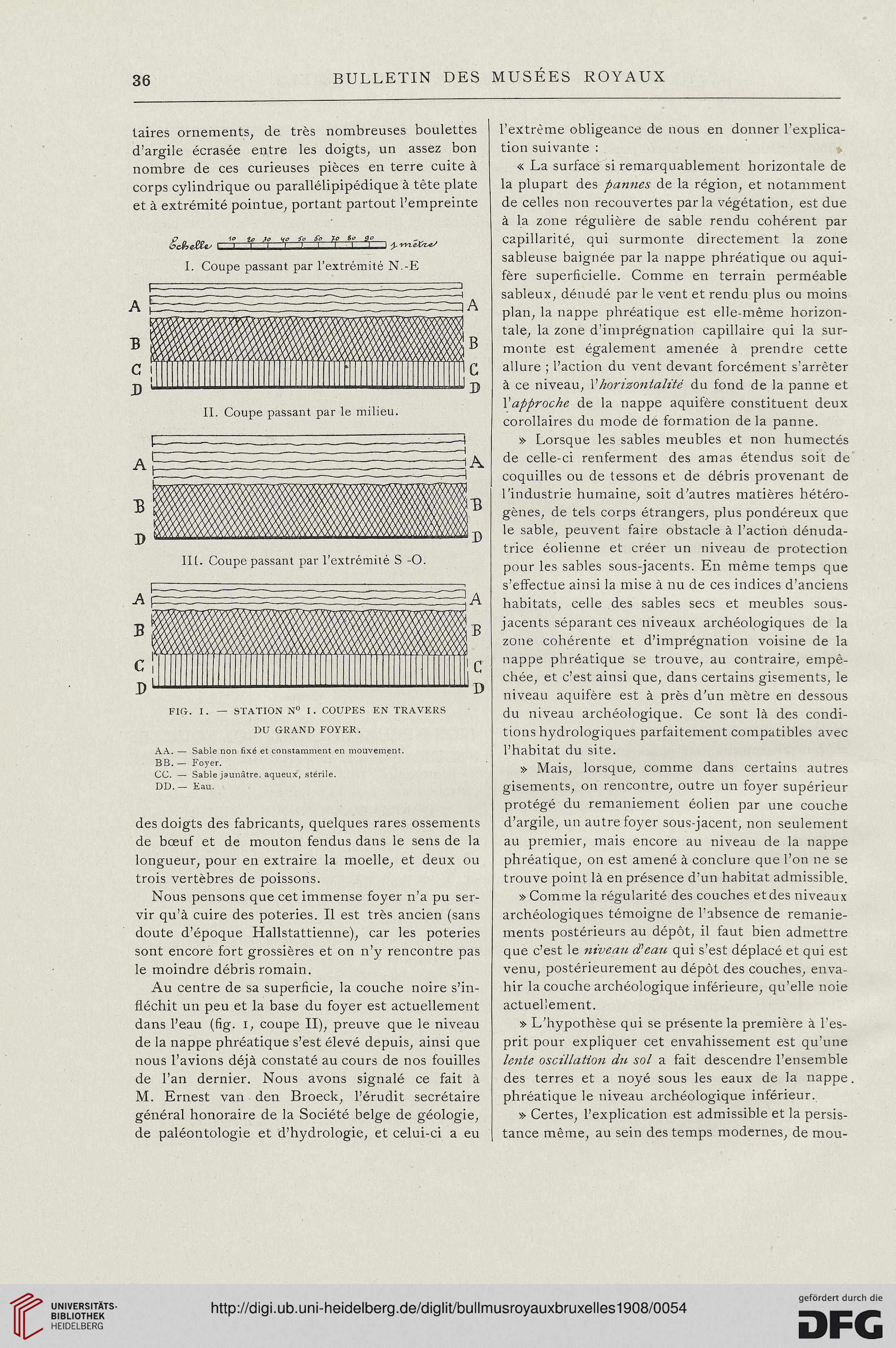36
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
laires ornements, de très nombreuses boulettes
d’argile écrasée entre les doigts, un assez bon
nombre de ces curieuses pièces en terre cuite à
corps cylindrique ou parallélipipédique à tête plate
et à extrémité pointue, portant partout l’empreinte
P n no . 10 30 So 90—, , "k y
Oc&eX&L' > 1 l 1 1 1 1 i 1 1 i
I. Coupe passant par l’extrémité N.-.E
A
B
C
B
II. Coupe passant par le milieu.
A
B
C
B
III. Coupe passant par l’extrémité S -O.
FIG. I. — STATION N° I. COUPES EN TRAVERS
DU GRAND FOYER.
AA. — Sable non fixé et constamment en mouvement.
BB. — Foyer.
CC. — Sable jaunâtre, aqueux, stérile.
DD. — Eau.
des doigts des fabricants, quelques rares ossements
de bœuf et de mouton fendus dans le sens de la
longueur, pour en extraire la moelle, et deux ou
trois vertèbres de poissons.
Nous pensons que cet immense foyer n’a pu ser-
vir qu’à cuire des poteries. Il est très ancien (sans
doute d’époque Hallstattienne), car les poteries
sont encore fort grossières et on n’y rencontre pas
le moindre débris romain.
Au centre de sa superficie, la couche noire s’in-
fléchit un peu et la base du foyer est actuellement
dans l’eau (fig. I, coupe II), preuve que le niveau
de la nappe phréatique s’est élevé depuis, ainsi que
nous l’avions déjà constaté au cours de nos fouilles
de l’an dernier. Nous avons signalé ce fait à
M. Ernest van den Broeck, l’érudit secrétaire
général honoraire de la Société belge de géologie,
de paléontologie et d’hydrologie, et celui-ci a eu
l’extrême obligeance de nous en donner l’explica-
tion suivante : »
« La surface si remarquablement horizontale de
la plupart des pannes de la région, et notamment
de celles non recouvertes parla végétation, est due
à la zone régulière de sable rendu cohérent par
capillarité, qui surmonte directement la zone
sableuse baignée par la nappe phréatique ou aqui-
fère superficielle. Comme en terrain perméable
sableux, dénudé par le vent et rendu plus ou moins
plan, la nappe phréatique est elle-même horizon-
tale, la zone d’imprégnation capillaire qui la sur-
monte est également amenée à prendre cette
allure ; l’action du vent devant forcément s’arrêter
à ce niveau, l'horizontalité du fond de la panne et
l’approche de la nappe aquifère constituent deux
corollaires du mode dé formation delà panne.
» Lorsque les sables meubles et non humectés
de celle-ci renferment des amas étendus soit de
coquilles ou de tessons et de débris provenant de
l’industrie humaine, soit d'autres matières hétéro-
gènes, de tels corps étrangers, plus pondéreux que
le sable, peuvent faire obstacle à l’action dénuda-
trice éolienne et créer un niveau de protection
pour les sables sous-jacents. En même temps que
s’effectue ainsi la mise à nu de ces indices d’anciens
habitats, celle des sables secs et meubles sous-
jacents séparant ces niveaux archéologiques de la
zone cohérente et d’imprégnation voisine de la
nappe phréatique se trouve, au contraire, empê-
chée, et c’est ainsi que, dans certains gisements, le
niveau aquifère est à près d'un mètre en dessous
du niveau archéologique. Ce sont là des condi-
tions hydrologiques parfaitement compatibles avec
l’habitat du site.
» Mais, lorsque, comme dans certains autres
gisements, on rencontre, outre un foyer supérieur
protégé du remaniement éolien par une couche
d’argile, un autre foyer sous-jacent, non seulement
au premier, mais encore au niveau de la nappe
phréatique, on est amené à conclure que l’on 11e se
trouve point là en présence d’un habitat admissible.
» Comme la régularité des couches et des niveaux
archéologiques témoigne de l’absence de remanie-
ments postérieurs au dépôt, il faut bien admettre
que c’est le niveau d'eau qui s’est déplacé et qui est
venu, postérieurement au dépôt des couches, enva-
hir la couche archéologique inférieure, qu’elle noie
actuellement.
» L’hypothèse qui se présente la première à l’es-
prit pour expliquer cet envahissement est qu’une
lente oscillation du sol a fait descendre l’ensemble
des terres et a noyé sous les eaux de la nappe.
phréatique le niveau archéologique inférieur.
» Certes, l’explication est admissible et la persis-
tance même, au sein des temps modernes, de mou-
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
laires ornements, de très nombreuses boulettes
d’argile écrasée entre les doigts, un assez bon
nombre de ces curieuses pièces en terre cuite à
corps cylindrique ou parallélipipédique à tête plate
et à extrémité pointue, portant partout l’empreinte
P n no . 10 30 So 90—, , "k y
Oc&eX&L' > 1 l 1 1 1 1 i 1 1 i
I. Coupe passant par l’extrémité N.-.E
A
B
C
B
II. Coupe passant par le milieu.
A
B
C
B
III. Coupe passant par l’extrémité S -O.
FIG. I. — STATION N° I. COUPES EN TRAVERS
DU GRAND FOYER.
AA. — Sable non fixé et constamment en mouvement.
BB. — Foyer.
CC. — Sable jaunâtre, aqueux, stérile.
DD. — Eau.
des doigts des fabricants, quelques rares ossements
de bœuf et de mouton fendus dans le sens de la
longueur, pour en extraire la moelle, et deux ou
trois vertèbres de poissons.
Nous pensons que cet immense foyer n’a pu ser-
vir qu’à cuire des poteries. Il est très ancien (sans
doute d’époque Hallstattienne), car les poteries
sont encore fort grossières et on n’y rencontre pas
le moindre débris romain.
Au centre de sa superficie, la couche noire s’in-
fléchit un peu et la base du foyer est actuellement
dans l’eau (fig. I, coupe II), preuve que le niveau
de la nappe phréatique s’est élevé depuis, ainsi que
nous l’avions déjà constaté au cours de nos fouilles
de l’an dernier. Nous avons signalé ce fait à
M. Ernest van den Broeck, l’érudit secrétaire
général honoraire de la Société belge de géologie,
de paléontologie et d’hydrologie, et celui-ci a eu
l’extrême obligeance de nous en donner l’explica-
tion suivante : »
« La surface si remarquablement horizontale de
la plupart des pannes de la région, et notamment
de celles non recouvertes parla végétation, est due
à la zone régulière de sable rendu cohérent par
capillarité, qui surmonte directement la zone
sableuse baignée par la nappe phréatique ou aqui-
fère superficielle. Comme en terrain perméable
sableux, dénudé par le vent et rendu plus ou moins
plan, la nappe phréatique est elle-même horizon-
tale, la zone d’imprégnation capillaire qui la sur-
monte est également amenée à prendre cette
allure ; l’action du vent devant forcément s’arrêter
à ce niveau, l'horizontalité du fond de la panne et
l’approche de la nappe aquifère constituent deux
corollaires du mode dé formation delà panne.
» Lorsque les sables meubles et non humectés
de celle-ci renferment des amas étendus soit de
coquilles ou de tessons et de débris provenant de
l’industrie humaine, soit d'autres matières hétéro-
gènes, de tels corps étrangers, plus pondéreux que
le sable, peuvent faire obstacle à l’action dénuda-
trice éolienne et créer un niveau de protection
pour les sables sous-jacents. En même temps que
s’effectue ainsi la mise à nu de ces indices d’anciens
habitats, celle des sables secs et meubles sous-
jacents séparant ces niveaux archéologiques de la
zone cohérente et d’imprégnation voisine de la
nappe phréatique se trouve, au contraire, empê-
chée, et c’est ainsi que, dans certains gisements, le
niveau aquifère est à près d'un mètre en dessous
du niveau archéologique. Ce sont là des condi-
tions hydrologiques parfaitement compatibles avec
l’habitat du site.
» Mais, lorsque, comme dans certains autres
gisements, on rencontre, outre un foyer supérieur
protégé du remaniement éolien par une couche
d’argile, un autre foyer sous-jacent, non seulement
au premier, mais encore au niveau de la nappe
phréatique, on est amené à conclure que l’on 11e se
trouve point là en présence d’un habitat admissible.
» Comme la régularité des couches et des niveaux
archéologiques témoigne de l’absence de remanie-
ments postérieurs au dépôt, il faut bien admettre
que c’est le niveau d'eau qui s’est déplacé et qui est
venu, postérieurement au dépôt des couches, enva-
hir la couche archéologique inférieure, qu’elle noie
actuellement.
» L’hypothèse qui se présente la première à l’es-
prit pour expliquer cet envahissement est qu’une
lente oscillation du sol a fait descendre l’ensemble
des terres et a noyé sous les eaux de la nappe.
phréatique le niveau archéologique inférieur.
» Certes, l’explication est admissible et la persis-
tance même, au sein des temps modernes, de mou-