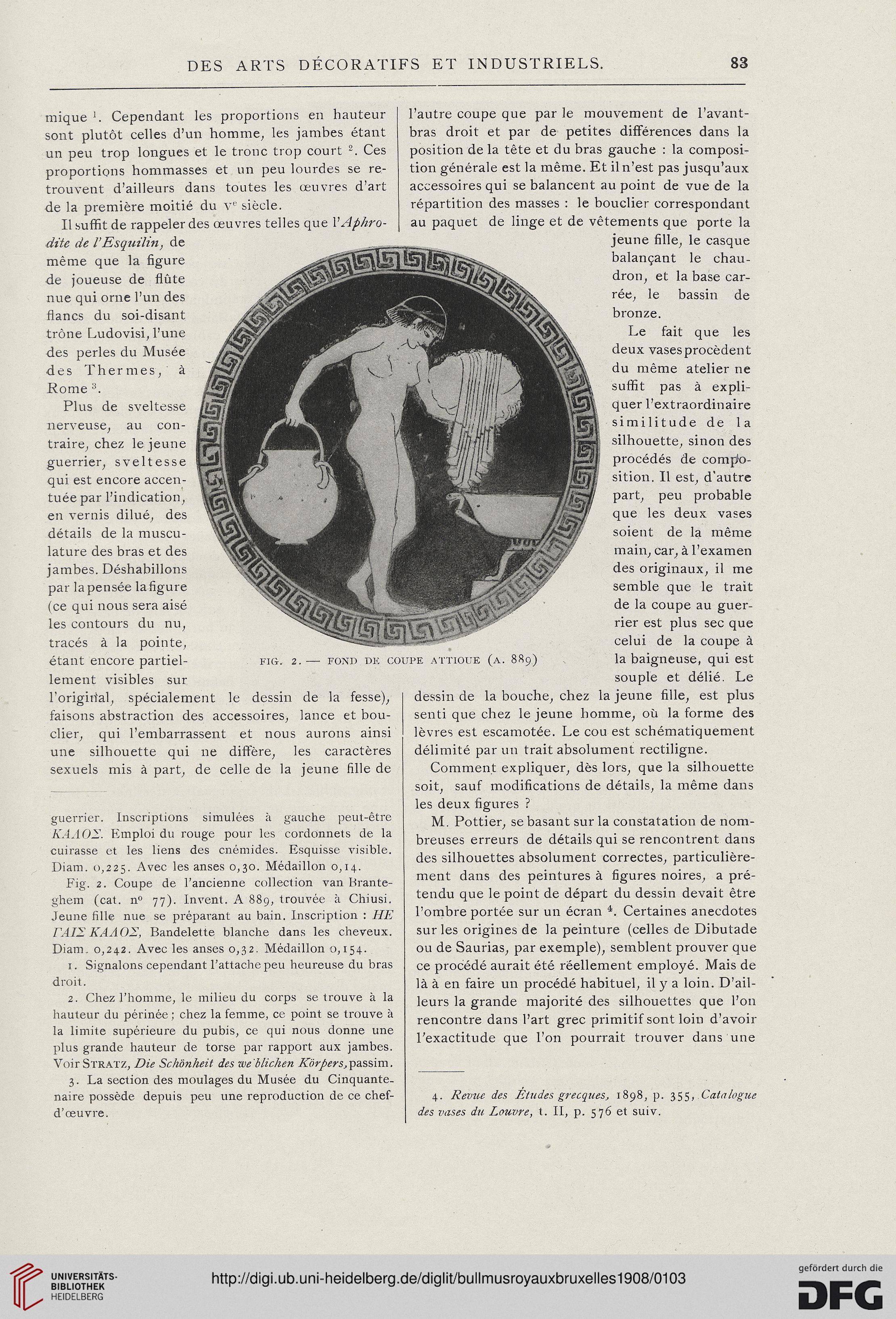DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS.
83
mique *. Cependant les proportions en hauteur
sont plutôt celles d’un homme, les jambes étant
un peu trop longues et le tronc trop court 2. Ces
proportions hommasses et un peu lourdes se re-
trouvent d’ailleurs dans toutes les œuvres d’art
de la première moitié du Ve siècle.
Il suffit de rappeler des œuvres telles que VAphro-
dite de l’Esquilin, de
même que la figure
de joueuse de flûte
nue qui orne l’un des
flancs du soi-disant
trône Ludovisi, l’une
des perles du Musée
des Thermes, à
Rome 3.
Plus de sveltesse
nerveuse, au con-
traire, chez le jeune
guerrier, sveltesse
qui est encore accen-
tuée par l’indication,
en vernis dilué, des
détails de la muscu-
lature des bras et des
jambes. Déshabillons
par lapensée lafigure
(ce qui nous sera aisé
les contours du nu,
tracés à la pointe,
étant encore partiel-
lement visibles sur
l’origirial, spécialement le dessin de la fesse),
faisons abstraction des accessoires, lance et bou-
clier, qui l’embarrassent et nous aurons ainsi
une silhouette qui ne diffère, les caractères
sexuels mis à part, de celle de la jeune fille de
guerrier. Inscriptions simulées à gauche peut-être
K A AOL. Emploi du rouge pour les cordonnets de la
cuirasse et les liens des cnémides. Esquisse visible.
Diam. 0,225. Avec les anses 0,30. Médaillon 0,14.
Fig. 2. Coupe de l’ancienne collection van Brante-
ghem (cat. n° 77). Invent. A 889, trouvée à Chiusi.
Jeune fille nue se préparant au bain. Inscription : HE
rAIS KAA02, Bandelette blanche dans les cheveux.
Diam. 0,242. Avec les anses 0,32. Médaillon 0,154.
1. Signalons cependant l’attache peu heureuse du bras
droit.
2. Chez l’homme, le milieu du corps se trouve à la
hauteur du périnée ; chez la femme, ce point se trouve à
la limite supérieure du pubis, ce qui nous donne une
plus grande hauteur de torse par rapport aux jambes.
VoirSTRATZ, Die Schônheit des web lichen Kôrpers, passirn.
3. La section des moulages du Musée du Cinquante-
naire possède depuis peu une reproduction de ce chef-
d’œuvre.
l’autre coupe que par le mouvement de l’avant-
bras droit et par de petites différences dans la
position delà tête et du bras gauche : la composi-
tion générale est la même. Et il n’est pas jusqu’aux
accessoires qui se balancent au point de vue de la
répartition des masses : le bouclier correspondant
au paquet de linge et de vêtements que porte la
jeune fille, le casque
balançant le chau-
dron, et la base car-
rée, le bassin de
bronze.
Le fait que les
deux vases procèdent
du même atelier ne
suffit pas à expli-
quer l’extraordinaire
similitude de 1 a
silhouette, sinon des
procédés de compto-
sition. Il est, d'autre
part, peu probable
que les deux vases
soient de la même
main, car, à l’examen
des originaux, il me
semble que le trait
de la coupe au guer-
rier est plus sec que
celui de la coupe à
la baigneuse, qui est
souple et délié. Le
dessin de la bouche, chez la jeune fille, est plus
senti que chez le jeune homme, où la forme des
lèvres est escamotée. Le cou est schématiquement
délimité par un trait absolument rectiligne.
Comment expliquer, dès lors, que la silhouette
soit, sauf modifications de détails, la même dans
les deux figures ?
M. Pottier, se basant sur la constatation de nom-
breuses erreurs de détails qui se rencontrent dans
des silhouettes absolument correctes, particulière-
ment dans des peintures à figures noires, a pré-
tendu que le point de départ du dessin devait être
l’ombre portée sur un écran 4. Certaines anecdotes
sur les origines de la peinture (celles de Dibutade
ou de Saurias, par exemple), semblent prouver que
ce procédé aurait été réellement employé. Mais de
là à en faire un procédé habituel, il y a loin. D’ail-
leurs la grande majorité des silhouettes que l’on
rencontre dans l’art grec primitif sont loin d’avoir
l’exactitude que l’on pourrait trouver dans une
4. Revue des Etudes grecques, 1898, p. 355, Catalogue
des vases du Louvre, t. II, p. 576 et suiv.
FIG. 2. —• FOND Dli COUPE ATTIOUE (a. 889)
83
mique *. Cependant les proportions en hauteur
sont plutôt celles d’un homme, les jambes étant
un peu trop longues et le tronc trop court 2. Ces
proportions hommasses et un peu lourdes se re-
trouvent d’ailleurs dans toutes les œuvres d’art
de la première moitié du Ve siècle.
Il suffit de rappeler des œuvres telles que VAphro-
dite de l’Esquilin, de
même que la figure
de joueuse de flûte
nue qui orne l’un des
flancs du soi-disant
trône Ludovisi, l’une
des perles du Musée
des Thermes, à
Rome 3.
Plus de sveltesse
nerveuse, au con-
traire, chez le jeune
guerrier, sveltesse
qui est encore accen-
tuée par l’indication,
en vernis dilué, des
détails de la muscu-
lature des bras et des
jambes. Déshabillons
par lapensée lafigure
(ce qui nous sera aisé
les contours du nu,
tracés à la pointe,
étant encore partiel-
lement visibles sur
l’origirial, spécialement le dessin de la fesse),
faisons abstraction des accessoires, lance et bou-
clier, qui l’embarrassent et nous aurons ainsi
une silhouette qui ne diffère, les caractères
sexuels mis à part, de celle de la jeune fille de
guerrier. Inscriptions simulées à gauche peut-être
K A AOL. Emploi du rouge pour les cordonnets de la
cuirasse et les liens des cnémides. Esquisse visible.
Diam. 0,225. Avec les anses 0,30. Médaillon 0,14.
Fig. 2. Coupe de l’ancienne collection van Brante-
ghem (cat. n° 77). Invent. A 889, trouvée à Chiusi.
Jeune fille nue se préparant au bain. Inscription : HE
rAIS KAA02, Bandelette blanche dans les cheveux.
Diam. 0,242. Avec les anses 0,32. Médaillon 0,154.
1. Signalons cependant l’attache peu heureuse du bras
droit.
2. Chez l’homme, le milieu du corps se trouve à la
hauteur du périnée ; chez la femme, ce point se trouve à
la limite supérieure du pubis, ce qui nous donne une
plus grande hauteur de torse par rapport aux jambes.
VoirSTRATZ, Die Schônheit des web lichen Kôrpers, passirn.
3. La section des moulages du Musée du Cinquante-
naire possède depuis peu une reproduction de ce chef-
d’œuvre.
l’autre coupe que par le mouvement de l’avant-
bras droit et par de petites différences dans la
position delà tête et du bras gauche : la composi-
tion générale est la même. Et il n’est pas jusqu’aux
accessoires qui se balancent au point de vue de la
répartition des masses : le bouclier correspondant
au paquet de linge et de vêtements que porte la
jeune fille, le casque
balançant le chau-
dron, et la base car-
rée, le bassin de
bronze.
Le fait que les
deux vases procèdent
du même atelier ne
suffit pas à expli-
quer l’extraordinaire
similitude de 1 a
silhouette, sinon des
procédés de compto-
sition. Il est, d'autre
part, peu probable
que les deux vases
soient de la même
main, car, à l’examen
des originaux, il me
semble que le trait
de la coupe au guer-
rier est plus sec que
celui de la coupe à
la baigneuse, qui est
souple et délié. Le
dessin de la bouche, chez la jeune fille, est plus
senti que chez le jeune homme, où la forme des
lèvres est escamotée. Le cou est schématiquement
délimité par un trait absolument rectiligne.
Comment expliquer, dès lors, que la silhouette
soit, sauf modifications de détails, la même dans
les deux figures ?
M. Pottier, se basant sur la constatation de nom-
breuses erreurs de détails qui se rencontrent dans
des silhouettes absolument correctes, particulière-
ment dans des peintures à figures noires, a pré-
tendu que le point de départ du dessin devait être
l’ombre portée sur un écran 4. Certaines anecdotes
sur les origines de la peinture (celles de Dibutade
ou de Saurias, par exemple), semblent prouver que
ce procédé aurait été réellement employé. Mais de
là à en faire un procédé habituel, il y a loin. D’ail-
leurs la grande majorité des silhouettes que l’on
rencontre dans l’art grec primitif sont loin d’avoir
l’exactitude que l’on pourrait trouver dans une
4. Revue des Etudes grecques, 1898, p. 355, Catalogue
des vases du Louvre, t. II, p. 576 et suiv.
FIG. 2. —• FOND Dli COUPE ATTIOUE (a. 889)