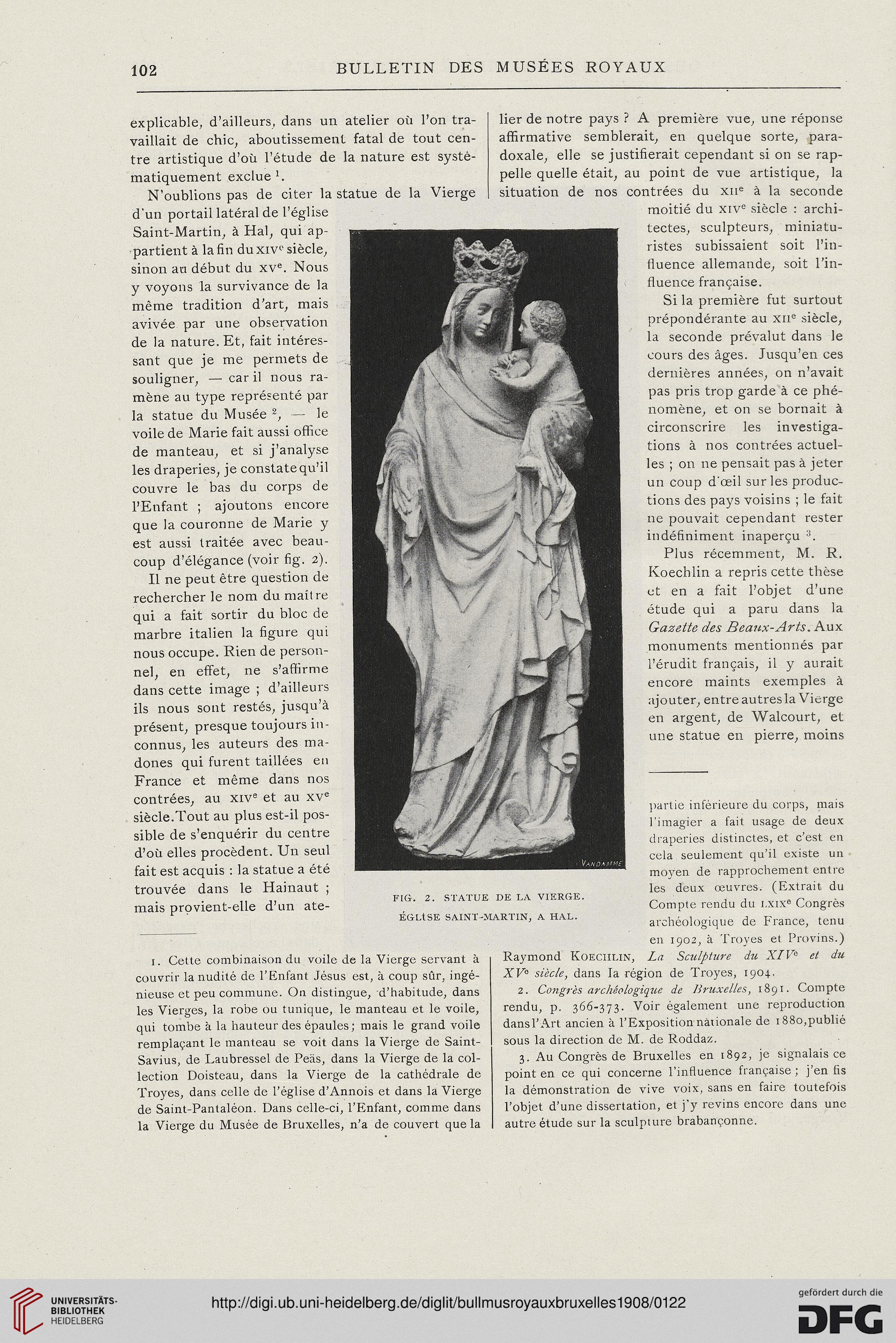102
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
explicable, d’ailleurs, dans un atelier où l’on tra-
vaillait de chic, aboutissement fatal de tout cen-
tre artistique d’où l’étude de la nature est systé-
matiquement exclue1.
N’oublions pas de citer la statue de la Vierge
d’un portail latéral de l'église
Saint-Martin, à Hal, qui ap-
partient à la fin du xivt! siècle,
sinon au début du xve. Nous
y voyons la survivance de la
même tradition d’art, mais
avivée par une observation
de la nature. Et, fait intéres-
sant que je me permets de
souligner, — car il nous ra-
mène au type représenté par
la statue du Musée 2 * * *, •— le
voile de Marie fait aussi office
de manteau, et si j’analyse
les draperies, je constate qu’il
couvre le bas du corps de
l’Enfant ; ajoutons encore
que la couronne de Marie y
est aussi traitée avec beau-
coup d’élégance (voir fig. 2).
Il ne peut être question de
rechercher le nom du maître
qui a fait sortir du bloc de
marbre italien la figure qui
nous occupe. Rien de person-
nel, en effet, ne s’affirme
dans cette image ; d’ailleurs
ils nous sont restés, jusqu’à
présent, presque toujours in-
connus, les auteurs des ma-
dones qui furent taillées en
France et même dans nos
contrées, au xive et au xve
siècle.Tout au plus est-il pos-
sible de s'enquérir du centre
d’où elles procèdent. Un seul
fait est acquis : la statue a été
trouvée dans le Hainaut ;
mais provient-elle d’un ate-
1. Cette combinaison du voile de la Vierge servant à
couvrir la nudité de l’Enfant Jésus est, à coup sûr, ingé-
nieuse et peu commune. On distingue, d’habitude, dans
les Vierges, la robe ou tunique, le manteau et le voile,
qui tombe à la hauteur des épaules; mais le grand voile
remplaçant le manteau se voit dans la Vierge de Saint-
Savius, de Laubressel de Peâs, dans la Vierge de la col-
lection Doisteau, dans la Vierge de la cathédrale de
Troyes, dans celle de l’église d’Annois et dans la Vierge
de Saint-Pantaléon. Dans celle-ci, l’Enfant, comme dans
la Vierge du Musée de Bruxelles, n’a de couvert que la
lier de notre pays ? A première vue, une réponse
affirmative semblerait, en quelque sorte, para-
doxale, elle se justifierait cependant si on se rap-
pelle quelle était, au point de vue artistique, la
situation de nos contrées du xue à la seconde
moitié du xive siècle : archi-
tectes, sculpteurs, miniatu-
ristes subissaient soit l’in-
fluence allemande, soit l’in-
fluence française.
Si la première fut surtout
prépondérante au xne siècle,
la seconde prévalut dans le
cours des âges. Jusqu’en ces
dernières années, on n’avait
pas pris trop garde à ce phé-
nomène, et on se bornait à
circonscrire les investiga-
tions à nos contrées actuel-
les ; on ne pensait pas à jeter
un coup d'œil sur les produc-
tions des pays voisins ; le fait
ne pouvait cependant rester
indéfiniment inaperçu :i.
Plus récemment, M. R.
Koechlin a repris cette thèse
et en a fait l’objet d’une
étude qui a paru dans la
Gazette des Beaux-Arts. Aux
monuments mentionnés par
l’érudit français, il y aurait
encore maints exemples à
ajouter, entre autres la Vierge
en argent, de Walcourt, et
une statue en pierre, moins
partie inférieure du corps, mais
l’imagier a fait usage de deux
draperies distinctes, et c’est en
cela seulement qu’il existe un
moyen de rapprochement entre
les deux œuvres. (Extrait du
Compte rendu du i.xix6 Congrès
archéologique de France, tenu
en 1902, à Troyes et Provins.)
Raymond Koechlin, La Sculpture du XIVe et du
XVe siècle, dans la région de Troyes, 1904..
2. Congrès archéologique de Bruxelles, 1891. Compte
rendu, p. 366-373. Voir également une reproduction
dans l’Art ancien à l’Exposition nationale de 1880,publié
sous la direction de M. de Roddaz.
3. Au Congrès de Bruxelles en 1892, je signalais ce
point en ce qui concerne l’influence française ; j’en fis
la démonstration de vive voix, sans en faire toutefois
l’objet d’une dissertation, et j’y revins encore dans une
autre étude sur la sculpture brabançonne.
FIG. 2. STATUE DE LA VIERGE.
ÉGLtSE SAINT-MARTIN, A HAL.
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
explicable, d’ailleurs, dans un atelier où l’on tra-
vaillait de chic, aboutissement fatal de tout cen-
tre artistique d’où l’étude de la nature est systé-
matiquement exclue1.
N’oublions pas de citer la statue de la Vierge
d’un portail latéral de l'église
Saint-Martin, à Hal, qui ap-
partient à la fin du xivt! siècle,
sinon au début du xve. Nous
y voyons la survivance de la
même tradition d’art, mais
avivée par une observation
de la nature. Et, fait intéres-
sant que je me permets de
souligner, — car il nous ra-
mène au type représenté par
la statue du Musée 2 * * *, •— le
voile de Marie fait aussi office
de manteau, et si j’analyse
les draperies, je constate qu’il
couvre le bas du corps de
l’Enfant ; ajoutons encore
que la couronne de Marie y
est aussi traitée avec beau-
coup d’élégance (voir fig. 2).
Il ne peut être question de
rechercher le nom du maître
qui a fait sortir du bloc de
marbre italien la figure qui
nous occupe. Rien de person-
nel, en effet, ne s’affirme
dans cette image ; d’ailleurs
ils nous sont restés, jusqu’à
présent, presque toujours in-
connus, les auteurs des ma-
dones qui furent taillées en
France et même dans nos
contrées, au xive et au xve
siècle.Tout au plus est-il pos-
sible de s'enquérir du centre
d’où elles procèdent. Un seul
fait est acquis : la statue a été
trouvée dans le Hainaut ;
mais provient-elle d’un ate-
1. Cette combinaison du voile de la Vierge servant à
couvrir la nudité de l’Enfant Jésus est, à coup sûr, ingé-
nieuse et peu commune. On distingue, d’habitude, dans
les Vierges, la robe ou tunique, le manteau et le voile,
qui tombe à la hauteur des épaules; mais le grand voile
remplaçant le manteau se voit dans la Vierge de Saint-
Savius, de Laubressel de Peâs, dans la Vierge de la col-
lection Doisteau, dans la Vierge de la cathédrale de
Troyes, dans celle de l’église d’Annois et dans la Vierge
de Saint-Pantaléon. Dans celle-ci, l’Enfant, comme dans
la Vierge du Musée de Bruxelles, n’a de couvert que la
lier de notre pays ? A première vue, une réponse
affirmative semblerait, en quelque sorte, para-
doxale, elle se justifierait cependant si on se rap-
pelle quelle était, au point de vue artistique, la
situation de nos contrées du xue à la seconde
moitié du xive siècle : archi-
tectes, sculpteurs, miniatu-
ristes subissaient soit l’in-
fluence allemande, soit l’in-
fluence française.
Si la première fut surtout
prépondérante au xne siècle,
la seconde prévalut dans le
cours des âges. Jusqu’en ces
dernières années, on n’avait
pas pris trop garde à ce phé-
nomène, et on se bornait à
circonscrire les investiga-
tions à nos contrées actuel-
les ; on ne pensait pas à jeter
un coup d'œil sur les produc-
tions des pays voisins ; le fait
ne pouvait cependant rester
indéfiniment inaperçu :i.
Plus récemment, M. R.
Koechlin a repris cette thèse
et en a fait l’objet d’une
étude qui a paru dans la
Gazette des Beaux-Arts. Aux
monuments mentionnés par
l’érudit français, il y aurait
encore maints exemples à
ajouter, entre autres la Vierge
en argent, de Walcourt, et
une statue en pierre, moins
partie inférieure du corps, mais
l’imagier a fait usage de deux
draperies distinctes, et c’est en
cela seulement qu’il existe un
moyen de rapprochement entre
les deux œuvres. (Extrait du
Compte rendu du i.xix6 Congrès
archéologique de France, tenu
en 1902, à Troyes et Provins.)
Raymond Koechlin, La Sculpture du XIVe et du
XVe siècle, dans la région de Troyes, 1904..
2. Congrès archéologique de Bruxelles, 1891. Compte
rendu, p. 366-373. Voir également une reproduction
dans l’Art ancien à l’Exposition nationale de 1880,publié
sous la direction de M. de Roddaz.
3. Au Congrès de Bruxelles en 1892, je signalais ce
point en ce qui concerne l’influence française ; j’en fis
la démonstration de vive voix, sans en faire toutefois
l’objet d’une dissertation, et j’y revins encore dans une
autre étude sur la sculpture brabançonne.
FIG. 2. STATUE DE LA VIERGE.
ÉGLtSE SAINT-MARTIN, A HAL.