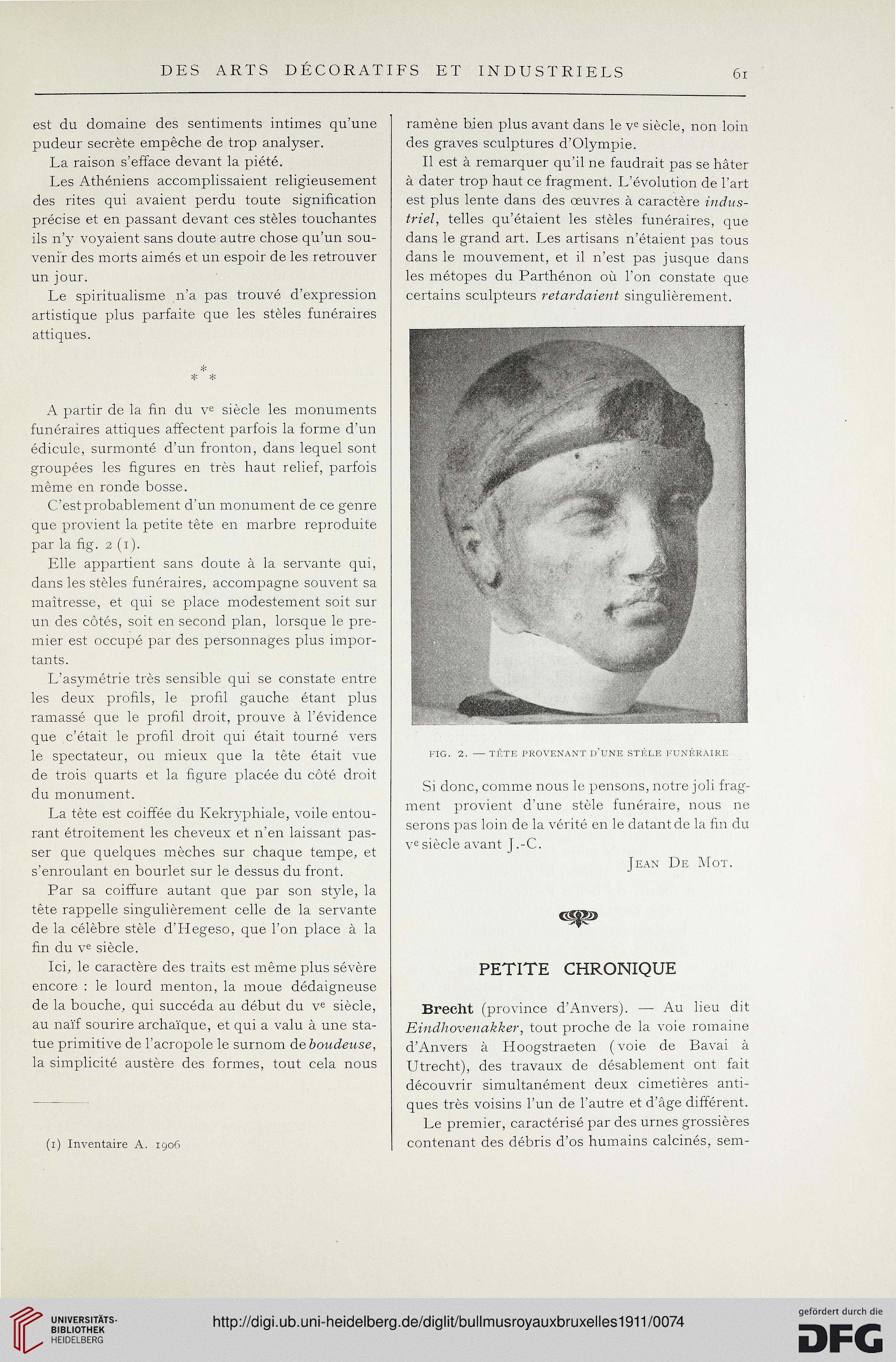DES ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS
61
est du domaine des sentiments intimes qu'une
pudeur secrète empêche de trop analyser.
La raison s’efface devant la piété.
Les Athéniens accomplissaient religieusement
des rites qui avaient perdu toute signification
précise et en passant devant ces stèles touchantes
ils n’y voyaient sans doute autre chose qu’un sou-
venir des morts aimés et un espoir de les retrouver
un jour.
Le spiritualisme n’a pas trouvé d’expression
artistique plus parfaite que les stèles funéraires
attiques.
*
* *
A partir de la fin du ve siècle les monuments
funéraires attiques affectent parfois la forme d’un
édicule, surmonté d’un fronton, dans lequel sont
groupées les figures en très haut relief, parfois
même en ronde bosse.
C’est probablement d’un monument de ce genre
que provient la petite tète en marbre reproduite
par la fig. 2 (1).
Elle appartient sans doute à la servante qui,
dans les stèles funéraires, accompagne souvent sa
maîtresse, et qui se place modestement soit sur
un des côtés, soit en second plan, lorsque le pre-
mier est occupé par des personnages plus impor-
tants.
L’asymétrie très sensible qui se constate entre
les deux profils, le profil gauche étant plus
ramassé que le profil droit, prouve à l’évidence
que c’était le profil droit qui était tourné vers
le spectateur, ou mieux que la tête était vue
de trois quarts et la figure placée du côté droit
du monument.
La tète est coiffée du Kekryphiale, voile entou-
rant étroitement les cheveux et n’en laissant pas-
ser que quelques mèches sur chaque tempe, et
s’enroulant en bourlet sur le dessus du front.
Par sa coiffure autant que par son style, la
tête rappelle singulièrement celle de la servante
de la célèbre stèle d’Hegeso, que l’on place à la
fin du ve siècle.
Ici, le caractère des traits est même plus sévère
encore : le lourd menton, la moue dédaigneuse
de la bouche, qui succéda au début du ve siècle,
au naïf sourire archaïque, et qui a valu à une sta-
tue primitive de l’acropole le surnom de boudeuse,
la simplicité austère des formes, tout cela nous
(1) Inventaire A. 1906
ramène bien plus avant dans le ve siècle, non loin
des graves sculptures d’Olympie.
Il est à remarquer qu’il ne faudrait pas se hâter
à dater trop haut ce fragment. L’évolution de l’art
est plus lente dans des œuvres à caractère indus-
triel, telles qu’étaient les stèles funéraires, que
dans le grand art. Les artisans n’étaient pas tous
dans le mouvement, et il n’est pas jusque dans
les métopes du Parthénon où l’on constate que
certains sculpteurs retardaient singulièrement.
FIG. 2. — TÊTE PROVENANT ü’uNE STÈLE FUNÉRAIRE
Si donc, comme nous le pensons, notre joli frag-
ment provient d’une stèle funéraire, nous ne
serons pas loin de la vérité en le datant de la fin du
Vesiècle avant J.-C.
Jean De Mot.
<apj>
PETITE CHRONIQUE
Brecht (province d’Anvers). — Au lieu dit
Eindhovenakker, tout proche de la voie romaine
d’Anvers à Hoogstraeten (voie de Bavai à
Utrecht), des travaux de désablement ont fait
découvrir simultanément deux cimetières anti-
ques très voisins l’un de l’autre et d’âge différent.
Le premier, caractérisé par des urnes grossières
contenant des débris d’os humains calcinés, sem-
61
est du domaine des sentiments intimes qu'une
pudeur secrète empêche de trop analyser.
La raison s’efface devant la piété.
Les Athéniens accomplissaient religieusement
des rites qui avaient perdu toute signification
précise et en passant devant ces stèles touchantes
ils n’y voyaient sans doute autre chose qu’un sou-
venir des morts aimés et un espoir de les retrouver
un jour.
Le spiritualisme n’a pas trouvé d’expression
artistique plus parfaite que les stèles funéraires
attiques.
*
* *
A partir de la fin du ve siècle les monuments
funéraires attiques affectent parfois la forme d’un
édicule, surmonté d’un fronton, dans lequel sont
groupées les figures en très haut relief, parfois
même en ronde bosse.
C’est probablement d’un monument de ce genre
que provient la petite tète en marbre reproduite
par la fig. 2 (1).
Elle appartient sans doute à la servante qui,
dans les stèles funéraires, accompagne souvent sa
maîtresse, et qui se place modestement soit sur
un des côtés, soit en second plan, lorsque le pre-
mier est occupé par des personnages plus impor-
tants.
L’asymétrie très sensible qui se constate entre
les deux profils, le profil gauche étant plus
ramassé que le profil droit, prouve à l’évidence
que c’était le profil droit qui était tourné vers
le spectateur, ou mieux que la tête était vue
de trois quarts et la figure placée du côté droit
du monument.
La tète est coiffée du Kekryphiale, voile entou-
rant étroitement les cheveux et n’en laissant pas-
ser que quelques mèches sur chaque tempe, et
s’enroulant en bourlet sur le dessus du front.
Par sa coiffure autant que par son style, la
tête rappelle singulièrement celle de la servante
de la célèbre stèle d’Hegeso, que l’on place à la
fin du ve siècle.
Ici, le caractère des traits est même plus sévère
encore : le lourd menton, la moue dédaigneuse
de la bouche, qui succéda au début du ve siècle,
au naïf sourire archaïque, et qui a valu à une sta-
tue primitive de l’acropole le surnom de boudeuse,
la simplicité austère des formes, tout cela nous
(1) Inventaire A. 1906
ramène bien plus avant dans le ve siècle, non loin
des graves sculptures d’Olympie.
Il est à remarquer qu’il ne faudrait pas se hâter
à dater trop haut ce fragment. L’évolution de l’art
est plus lente dans des œuvres à caractère indus-
triel, telles qu’étaient les stèles funéraires, que
dans le grand art. Les artisans n’étaient pas tous
dans le mouvement, et il n’est pas jusque dans
les métopes du Parthénon où l’on constate que
certains sculpteurs retardaient singulièrement.
FIG. 2. — TÊTE PROVENANT ü’uNE STÈLE FUNÉRAIRE
Si donc, comme nous le pensons, notre joli frag-
ment provient d’une stèle funéraire, nous ne
serons pas loin de la vérité en le datant de la fin du
Vesiècle avant J.-C.
Jean De Mot.
<apj>
PETITE CHRONIQUE
Brecht (province d’Anvers). — Au lieu dit
Eindhovenakker, tout proche de la voie romaine
d’Anvers à Hoogstraeten (voie de Bavai à
Utrecht), des travaux de désablement ont fait
découvrir simultanément deux cimetières anti-
ques très voisins l’un de l’autre et d’âge différent.
Le premier, caractérisé par des urnes grossières
contenant des débris d’os humains calcinés, sem-