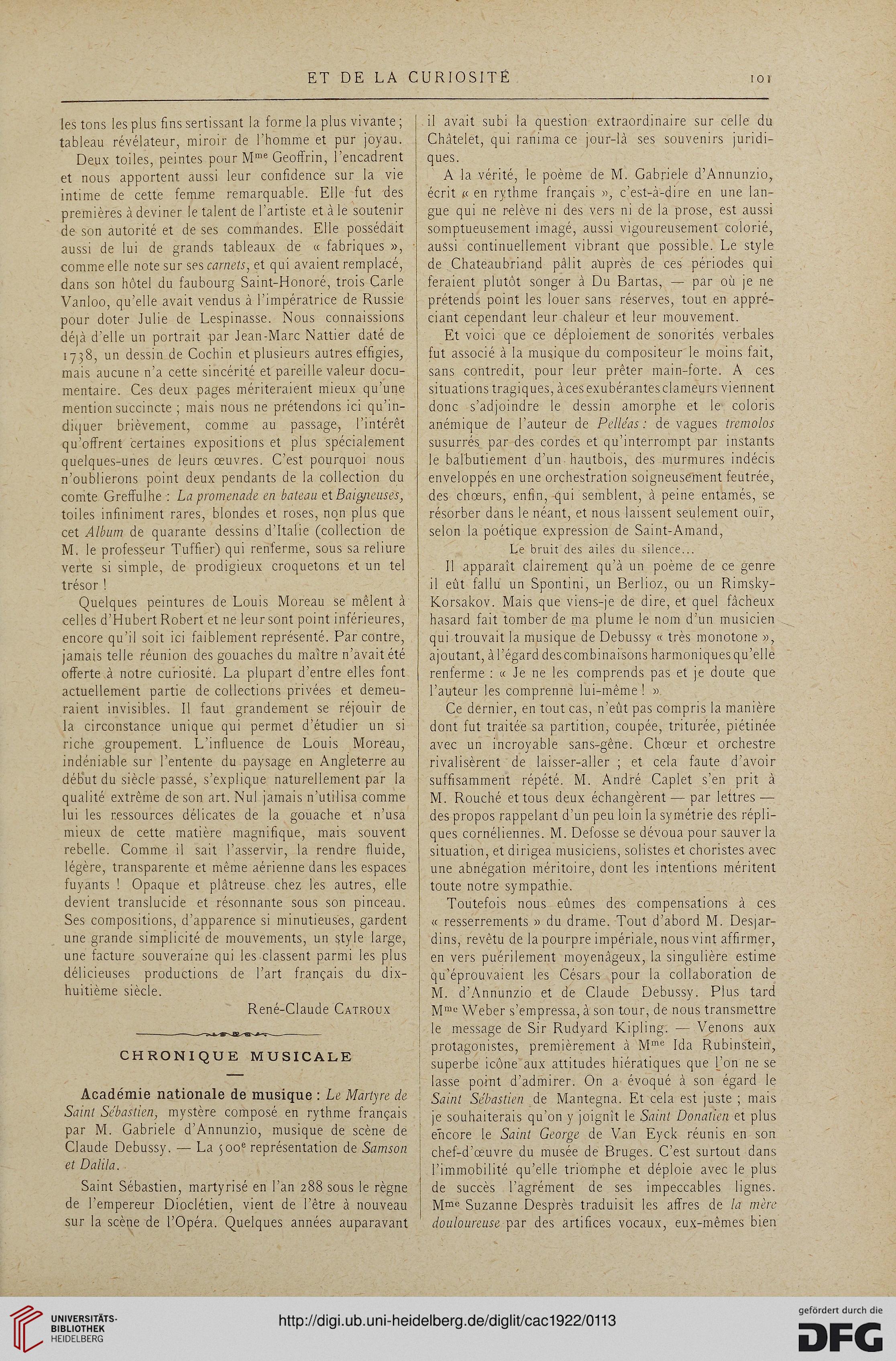ET DE LA CURIOSITÉ
i o i
les tons les plus fins sertissant la forme la plus vivante ;
tableau révélateur, miroir de l'homme et pur joyau.
Deux toiles, peintes pour Mme Geoffrin, l’encadrent
et nous apportent aussi leur confidence sur la vie
intime de cette femme remarquable. Elle fut des
premières à deviner le talent de l’artiste et à le soutenir
de son autorité et de ses commandes. Elle possédait
aussi de lui de grands tableaux de « fabriques »,
comme elle note sur ses carnets, et qui avaient remplacé,
dans son hôtel du faubourg Saint-Honoré, trois Carie
Vanloo, qu’elle avait vendus à l’impératrice de Russie
pour doter Julie de Lespinasse. Nous connaissions
déjà d’elle un portrait par Jean-Marc Nattier daté de
1738, un dessin de Cochin et plusieurs autres effigies,
mais aucune n’a cette sincérité et pareille valeur docu-
mentaire. Ces deux page-s mériteraient mieux qu’une
mention succincte ; mais nous ne prétendons ici qu’in-
diquer brièvement, comme au passage, l’intérêt
qu’offrent certaines expositions et plus spécialement
quelques-unes de leurs œuvres. C’est pourquoi nous
n’oublierons point deux pendants de la collection du
comte Greffulhe : La promenade en bateau et Baigneuses,
toiles infiniment rares, blondes et roses, non plus que
cet Album de quarante dessins d’Italie (collection de
M. le professeur Tuffier) qui renferme, sous sa reliure
verte si simple, de prodigieux croquetons et un tel
trésor !
Quelques peintures de Louis Moreau se mêlent à
celles d’Hubert Robert et ne leur sont point inférieures,
encore qu’il soit ici faiblement représenté. Par contre,
jamais telle réunion des gouaches du maître n’avait été
offerte à notre curiosité. La plupart d’entre elles font
actuellement partie de collections privées et demeu-
raient invisibles. Il faut grandement se réjouir de
la circonstance unique qui permet d’étudier un si
riche groupement. L’influence de Louis Moreau,
indéniable sur l’entente du paysage en Angleterre au
début du siècle passé, s’explique naturellement par la
qualité extrême de son art. Nul jamais n’utilisa comme
lui les ressources délicates de la gouache et n’usa
mieux de cette matière magnifique, mais souvent
rebelle. Comme il sait l’asservir, la rendre fluide,
légère, transparente et même aérienne dans les espaces
fuyants ! Opaque et plâtreuse chez les autres, elle
devient translucide et résonnante sous son pinceau.
Ses compositions, d’apparence si minutieuses, gardent
une grande simplicité de mouvements, un style large,
une facture souveraine qui les classent parmi les plus
délicieuses productions de l’art français du- dix-
huitième siècle.
René-Claude Catroux
CHRONIQUE MUSICALE
Académie nationale de musique : Le Martyre de
Saint Sébastien, mystère composé en rythme français
par M. Gabriele d’Annunzio, musique de scène de
Claude Debussy. — La 500e représentation de Samson
et Dalila.
Saint Sébastien, martyrisé en l’an 288 sous le règne
de l’empereur Dioclétien, vient de l’être à nouveau
sur la scène de l’Opéra. Quelques années auparavant
il avait subi la question extraordinaire sur celle du
Châtelet, qui ranima ce jour-là ses souvenirs juridi-
ques.
A la vérité, le poème de M. Gabriele d’Annunzio,
écrit en rythme français », c’est-à-dire en une lan-
gue qui ne relève ni des vers ni de la prose, est aussi
somptueusement imagé, aussi vigoureusement colorié,
aussi continuellement vibrant que possible. Le style
de Chateaubriand pâlit auprès de ces périodes qui
feraient plutôt songer à Du Bartas, — par où je ne
prétends point les louer sans réserves, tout en appré-
ciant cependant leur chaleur et leur mouvement.
Et voici que ce déploiement de sonorités verbales
fut associé à la musique du compositeur le moins fait,
sans contredit, pour leur prêter main-forte. A ces
situations tragiques, àcesexubérantesclameurs viennent
donc s’adjoindre le dessin amorphe et le coloris
anémique de l’auteur de Pelléas : de vagues trémolos
susurrés par des cordes et qu’interrompt par instants
le balbutiement d’un hautbois, des murmures indécis
enveloppés en une orchestration soigneusement feutrée,
des chœurs, enfin,-qui semblent, à peine entamés, se
résorber dans le néant, et nous laissent seulement ouïr,
selon la poétique expression de Saint-Amand,
Le bruit des ailes du silence...
11 apparaît clairement qu’à un poème de ce genre
il eût fallu un Spontini, un Berlioz, ou un Rimsky-
Korsakov. Mais que viens-je de dire, et quel fâcheux
hasard fait tomber de ma plume le nom d’un musicien
qui trouvait la musique de Debussy « très monotone »,
ajoutant, à l’égard des combinaisons harmoniques qu’elle
renferme : « Je ne les comprends pas et je doute que
l’auteur les comprenne lui-même! ».
Ce dernier, en tout cas, n’eût pas compris la manière
dont fut traitée sa partition, coupée, triturée, piétinée
avec un incroyable sans-gêne. Chœur et orchestre
rivalisèrent de laisser-aller ; et cela faute d’avoir
suffisamment répété. M. André Caplet s’en prit à
M. Rouché et tous deux échangèrent — par lettres —
des propos rappelant d’un peu loin la symétrie des répli-
ques cornéliennes. M. Defosse se dévoua pour sauver la
situation, et dirigea musiciens, solistes et choristes avec
une abnégation méritoire, dont les intentions méritent
toute notre sympathie.
Toutefois nous eûmes des compensations à ces
« resserrements » du drame. Tout d’abord M. Desjar-
dins, revêtu de la pourpre impériale, nous vint affirmer,
en vers puérilement moyenâgeux, la singulière estime
qu’éprouvaient les Césars pour la collaboration de
M. d’Annunzio et de Claude Debussy. Plus tard
Mmc Weber s’empressa, à son tour, de nous transmettre
le message de Sir Rudyard Kipling. — Venons aux
protagonistes, premièrement à Mme Ida Rubinstein,
superbe icône aux attitudes hiératiques que bon ne se
lasse point d’admirer. On a évoqué à son égard le
Saint Sébastien de Mantegna. Et cela est juste ; mais
je souhaiterais qu’on y joignît le Saint Donatien et plus
encore le Saint George de Van Eyck réunis en son
chef-d’œuvre du musée de Bruges. C’est surtout dans
l’immobilité qu’elle triomphe et déploie avec le plus
de succès l’agrément de ses impeccables lignes.
Mme Suzanne Desprès traduisit les affres de la mère
douloureuse par des artifices vocaux, eux-mêmes bien
i o i
les tons les plus fins sertissant la forme la plus vivante ;
tableau révélateur, miroir de l'homme et pur joyau.
Deux toiles, peintes pour Mme Geoffrin, l’encadrent
et nous apportent aussi leur confidence sur la vie
intime de cette femme remarquable. Elle fut des
premières à deviner le talent de l’artiste et à le soutenir
de son autorité et de ses commandes. Elle possédait
aussi de lui de grands tableaux de « fabriques »,
comme elle note sur ses carnets, et qui avaient remplacé,
dans son hôtel du faubourg Saint-Honoré, trois Carie
Vanloo, qu’elle avait vendus à l’impératrice de Russie
pour doter Julie de Lespinasse. Nous connaissions
déjà d’elle un portrait par Jean-Marc Nattier daté de
1738, un dessin de Cochin et plusieurs autres effigies,
mais aucune n’a cette sincérité et pareille valeur docu-
mentaire. Ces deux page-s mériteraient mieux qu’une
mention succincte ; mais nous ne prétendons ici qu’in-
diquer brièvement, comme au passage, l’intérêt
qu’offrent certaines expositions et plus spécialement
quelques-unes de leurs œuvres. C’est pourquoi nous
n’oublierons point deux pendants de la collection du
comte Greffulhe : La promenade en bateau et Baigneuses,
toiles infiniment rares, blondes et roses, non plus que
cet Album de quarante dessins d’Italie (collection de
M. le professeur Tuffier) qui renferme, sous sa reliure
verte si simple, de prodigieux croquetons et un tel
trésor !
Quelques peintures de Louis Moreau se mêlent à
celles d’Hubert Robert et ne leur sont point inférieures,
encore qu’il soit ici faiblement représenté. Par contre,
jamais telle réunion des gouaches du maître n’avait été
offerte à notre curiosité. La plupart d’entre elles font
actuellement partie de collections privées et demeu-
raient invisibles. Il faut grandement se réjouir de
la circonstance unique qui permet d’étudier un si
riche groupement. L’influence de Louis Moreau,
indéniable sur l’entente du paysage en Angleterre au
début du siècle passé, s’explique naturellement par la
qualité extrême de son art. Nul jamais n’utilisa comme
lui les ressources délicates de la gouache et n’usa
mieux de cette matière magnifique, mais souvent
rebelle. Comme il sait l’asservir, la rendre fluide,
légère, transparente et même aérienne dans les espaces
fuyants ! Opaque et plâtreuse chez les autres, elle
devient translucide et résonnante sous son pinceau.
Ses compositions, d’apparence si minutieuses, gardent
une grande simplicité de mouvements, un style large,
une facture souveraine qui les classent parmi les plus
délicieuses productions de l’art français du- dix-
huitième siècle.
René-Claude Catroux
CHRONIQUE MUSICALE
Académie nationale de musique : Le Martyre de
Saint Sébastien, mystère composé en rythme français
par M. Gabriele d’Annunzio, musique de scène de
Claude Debussy. — La 500e représentation de Samson
et Dalila.
Saint Sébastien, martyrisé en l’an 288 sous le règne
de l’empereur Dioclétien, vient de l’être à nouveau
sur la scène de l’Opéra. Quelques années auparavant
il avait subi la question extraordinaire sur celle du
Châtelet, qui ranima ce jour-là ses souvenirs juridi-
ques.
A la vérité, le poème de M. Gabriele d’Annunzio,
écrit en rythme français », c’est-à-dire en une lan-
gue qui ne relève ni des vers ni de la prose, est aussi
somptueusement imagé, aussi vigoureusement colorié,
aussi continuellement vibrant que possible. Le style
de Chateaubriand pâlit auprès de ces périodes qui
feraient plutôt songer à Du Bartas, — par où je ne
prétends point les louer sans réserves, tout en appré-
ciant cependant leur chaleur et leur mouvement.
Et voici que ce déploiement de sonorités verbales
fut associé à la musique du compositeur le moins fait,
sans contredit, pour leur prêter main-forte. A ces
situations tragiques, àcesexubérantesclameurs viennent
donc s’adjoindre le dessin amorphe et le coloris
anémique de l’auteur de Pelléas : de vagues trémolos
susurrés par des cordes et qu’interrompt par instants
le balbutiement d’un hautbois, des murmures indécis
enveloppés en une orchestration soigneusement feutrée,
des chœurs, enfin,-qui semblent, à peine entamés, se
résorber dans le néant, et nous laissent seulement ouïr,
selon la poétique expression de Saint-Amand,
Le bruit des ailes du silence...
11 apparaît clairement qu’à un poème de ce genre
il eût fallu un Spontini, un Berlioz, ou un Rimsky-
Korsakov. Mais que viens-je de dire, et quel fâcheux
hasard fait tomber de ma plume le nom d’un musicien
qui trouvait la musique de Debussy « très monotone »,
ajoutant, à l’égard des combinaisons harmoniques qu’elle
renferme : « Je ne les comprends pas et je doute que
l’auteur les comprenne lui-même! ».
Ce dernier, en tout cas, n’eût pas compris la manière
dont fut traitée sa partition, coupée, triturée, piétinée
avec un incroyable sans-gêne. Chœur et orchestre
rivalisèrent de laisser-aller ; et cela faute d’avoir
suffisamment répété. M. André Caplet s’en prit à
M. Rouché et tous deux échangèrent — par lettres —
des propos rappelant d’un peu loin la symétrie des répli-
ques cornéliennes. M. Defosse se dévoua pour sauver la
situation, et dirigea musiciens, solistes et choristes avec
une abnégation méritoire, dont les intentions méritent
toute notre sympathie.
Toutefois nous eûmes des compensations à ces
« resserrements » du drame. Tout d’abord M. Desjar-
dins, revêtu de la pourpre impériale, nous vint affirmer,
en vers puérilement moyenâgeux, la singulière estime
qu’éprouvaient les Césars pour la collaboration de
M. d’Annunzio et de Claude Debussy. Plus tard
Mmc Weber s’empressa, à son tour, de nous transmettre
le message de Sir Rudyard Kipling. — Venons aux
protagonistes, premièrement à Mme Ida Rubinstein,
superbe icône aux attitudes hiératiques que bon ne se
lasse point d’admirer. On a évoqué à son égard le
Saint Sébastien de Mantegna. Et cela est juste ; mais
je souhaiterais qu’on y joignît le Saint Donatien et plus
encore le Saint George de Van Eyck réunis en son
chef-d’œuvre du musée de Bruges. C’est surtout dans
l’immobilité qu’elle triomphe et déploie avec le plus
de succès l’agrément de ses impeccables lignes.
Mme Suzanne Desprès traduisit les affres de la mère
douloureuse par des artifices vocaux, eux-mêmes bien