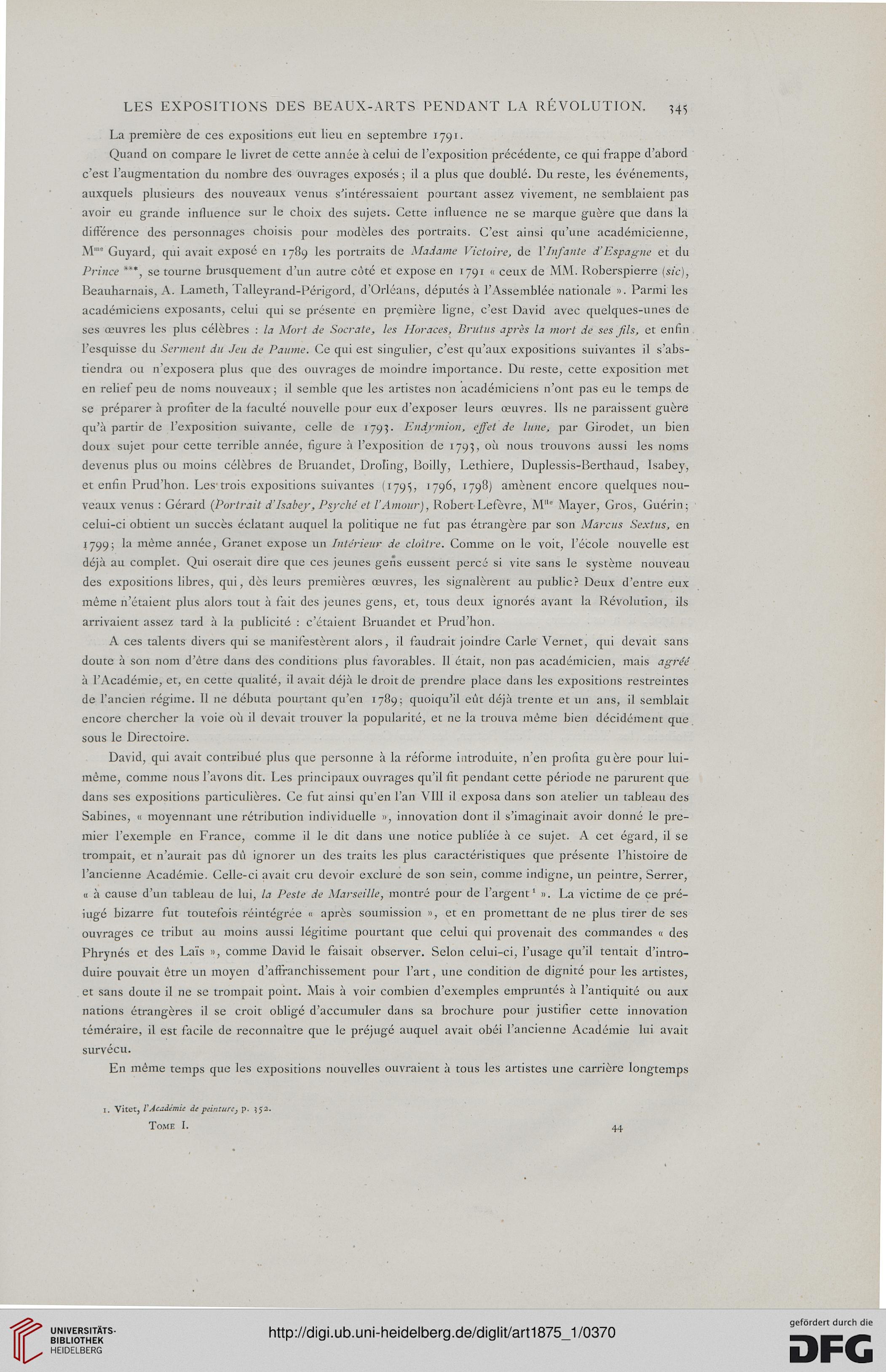LES EXPOSITIONS DES BEAUX-ARTS PENDANT LA RÉVOLUTION. 345
La première de ces expositions eut lieu en septembre 1791.
Quand on compare le livret de cette année à celui de l'exposition précédente, ce qui frappe d'abord
c'est l'augmentation du nombre des ouvrages exposés ; il a plus que doublé. Du reste, les événements,
auxquels plusieurs des nouveaux venus s'intéressaient pourtant assez vivement, ne semblaient pas
avoir eu grande influence sur le choix des sujets. Cette influence ne se marque guère que dans la
différence des personnages choisis pour modèles des portraits. C'est ainsi qu'une académicienne.
M'"6 Guyard, qui avait exposé en 1789 les portraits de Madame Victoire, de Y Infante d'Espagne et du
Prince ***, se tourne brusquement d'un autre côté et expose en 1791 « ceux de MM. Roberspierre (sic),
Beauharnais, A. Lameth, Talleyrand-Périgord, d'Orléans, députés à l'Assemblée nationale ». Parmi les
académiciens exposants, celui qui se présente en première ligne, c'est David avec quelques-unes de
ses œuvres les plus célèbres : la Mort de Socrate, les Horaces, Brutus après la mort de ses fils, et enfin
l'esquisse du Serment du Jeu de Paume. Ce qui est singulier, c'est qu'aux expositions suivantes il s'abs-
tiendra ou n'exposera plus que des ouvrages de moindre importance. Du reste, cette exposition met
en relief peu de noms nouveaux; il semble que les artistes non académiciens n'ont pas eu le temps de
se préparer à profiter de la faculté nouvelle pour eux d'exposer leurs œuvres. Ils ne paraissent guère
qu'à partir de l'exposition suivante, celle de 1793. Endrmion, effet de lune, par Girodet, un bien
doux sujet pour cette terrible année, ligure à l'exposition de 1793, où nous trouvons aussi les noms
devenus plus ou moins célèbres de Rruandet, Droling, Boilly, Lethiere, Duplessis-Berthaud, Isabey,
et enfin Prud'hon. Les trois expositions suivantes (1795, 1796, 1798) amènent encore quelques nou-
veaux venus : Gérard (Portrait d'Isabey, Psyché et l'Amour), Robert-Lefèvre, M"e Mayer, Gros, Guérin;
celui-ci obtient un succès éclatant auquel la politique ne fut pas étrangère par son Marais Sextus, en
1799; la même année, Granet expose un Intérieur de cloître. Comme on le voit, l'école nouvelle est
déjà au complet. Qui oserait dire que ces jeunes gens eussent percé si vite sans le système nouveau
des expositions libres, qui, dès leurs premières œuvres, les signalèrent au public? Deux d'entre eux
même n'étaient plus alors tout à fait des jeunes gens, et, tous deux ignorés avant la Révolution, ils
arrivaient assez tard à la publicité : c'étaient Bruandet et Prud'hon.
A ces talents divers qui se manifestèrent alors, il faudrait joindre Carie Vernet, qui devait sans
doute à son nom d'être dans des conditions plus favorables. Il était, non pas académicien, mais agréé
à l'Académie, et, en cette qualité, il avait déjà le droit de prendre place dans les expositions restreintes
de l'ancien régime. Il ne débuta pourtant qu'en 1789; quoiqu'il eût déjà trente et un ans, il semblait
encore chercher la voie où il devait trouver la popularité, et ne la trouva même bien décidément que
sous le Directoire.
David, qui avait contribué plus que personne à la réforme introduite, n'en profita guère pour lui-
même, comme nous l'avons dit. Les principaux ouvrages qu'il fit pendant cette période ne parurent que
dans ses expositions particulières. Ce fut ainsi qu'en l'an VIII il exposa dans son atelier un tableau des
Sabines, « moyennant une rétribution individuelle », innovation dont il s'imaginait avoir donné le pre-
mier l'exemple en France, comme il le dit dans une notice publiée à ce sujet. A cet égard, il se
trompait, et n'aurait pas dû ignorer un des traits les plus caractéristiques que présente l'histoire de
l'ancienne Académie. Celle-ci avait cru devoir exclure de son sein, comme indigne, un peintre, Serrer,
« à cause d'un tableau de lui, la Peste de Marseille, montré pour de l'argent1 ». La victime de ce pré-
iugé bizarre fut toutefois réintégrée « après soumission », et en promettant de ne plus tirer de ses
ouvrages ce tribut au moins aussi légitime pourtant que celui qui provenait des commandes « des
Phrynés et des Laïs », comme David le faisait observer. Selon celui-ci, l'usage qu'il tentait d'intro-
duire pouvait être un moyen d'affranchissement pour l'art, une condition de dignité pour les artistes,
et sans doute il ne se trompait point. Mais à voir combien d'exemples empruntés à l'antiquité ou aux
nations étrangères il se croit obligé d'accumuler dans sa brochure pour justifier cette innovation
téméraire, il est facile de reconnaître que le préjugé auquel avait obéi l'ancienne Académie lui avait
survécu.
En même temps que les expositions nouvelles ouvraient à tous les artistes une carrière longtemps
1. Vitct, VAcadémie de peinture, p. 352.
Tome I.
44
La première de ces expositions eut lieu en septembre 1791.
Quand on compare le livret de cette année à celui de l'exposition précédente, ce qui frappe d'abord
c'est l'augmentation du nombre des ouvrages exposés ; il a plus que doublé. Du reste, les événements,
auxquels plusieurs des nouveaux venus s'intéressaient pourtant assez vivement, ne semblaient pas
avoir eu grande influence sur le choix des sujets. Cette influence ne se marque guère que dans la
différence des personnages choisis pour modèles des portraits. C'est ainsi qu'une académicienne.
M'"6 Guyard, qui avait exposé en 1789 les portraits de Madame Victoire, de Y Infante d'Espagne et du
Prince ***, se tourne brusquement d'un autre côté et expose en 1791 « ceux de MM. Roberspierre (sic),
Beauharnais, A. Lameth, Talleyrand-Périgord, d'Orléans, députés à l'Assemblée nationale ». Parmi les
académiciens exposants, celui qui se présente en première ligne, c'est David avec quelques-unes de
ses œuvres les plus célèbres : la Mort de Socrate, les Horaces, Brutus après la mort de ses fils, et enfin
l'esquisse du Serment du Jeu de Paume. Ce qui est singulier, c'est qu'aux expositions suivantes il s'abs-
tiendra ou n'exposera plus que des ouvrages de moindre importance. Du reste, cette exposition met
en relief peu de noms nouveaux; il semble que les artistes non académiciens n'ont pas eu le temps de
se préparer à profiter de la faculté nouvelle pour eux d'exposer leurs œuvres. Ils ne paraissent guère
qu'à partir de l'exposition suivante, celle de 1793. Endrmion, effet de lune, par Girodet, un bien
doux sujet pour cette terrible année, ligure à l'exposition de 1793, où nous trouvons aussi les noms
devenus plus ou moins célèbres de Rruandet, Droling, Boilly, Lethiere, Duplessis-Berthaud, Isabey,
et enfin Prud'hon. Les trois expositions suivantes (1795, 1796, 1798) amènent encore quelques nou-
veaux venus : Gérard (Portrait d'Isabey, Psyché et l'Amour), Robert-Lefèvre, M"e Mayer, Gros, Guérin;
celui-ci obtient un succès éclatant auquel la politique ne fut pas étrangère par son Marais Sextus, en
1799; la même année, Granet expose un Intérieur de cloître. Comme on le voit, l'école nouvelle est
déjà au complet. Qui oserait dire que ces jeunes gens eussent percé si vite sans le système nouveau
des expositions libres, qui, dès leurs premières œuvres, les signalèrent au public? Deux d'entre eux
même n'étaient plus alors tout à fait des jeunes gens, et, tous deux ignorés avant la Révolution, ils
arrivaient assez tard à la publicité : c'étaient Bruandet et Prud'hon.
A ces talents divers qui se manifestèrent alors, il faudrait joindre Carie Vernet, qui devait sans
doute à son nom d'être dans des conditions plus favorables. Il était, non pas académicien, mais agréé
à l'Académie, et, en cette qualité, il avait déjà le droit de prendre place dans les expositions restreintes
de l'ancien régime. Il ne débuta pourtant qu'en 1789; quoiqu'il eût déjà trente et un ans, il semblait
encore chercher la voie où il devait trouver la popularité, et ne la trouva même bien décidément que
sous le Directoire.
David, qui avait contribué plus que personne à la réforme introduite, n'en profita guère pour lui-
même, comme nous l'avons dit. Les principaux ouvrages qu'il fit pendant cette période ne parurent que
dans ses expositions particulières. Ce fut ainsi qu'en l'an VIII il exposa dans son atelier un tableau des
Sabines, « moyennant une rétribution individuelle », innovation dont il s'imaginait avoir donné le pre-
mier l'exemple en France, comme il le dit dans une notice publiée à ce sujet. A cet égard, il se
trompait, et n'aurait pas dû ignorer un des traits les plus caractéristiques que présente l'histoire de
l'ancienne Académie. Celle-ci avait cru devoir exclure de son sein, comme indigne, un peintre, Serrer,
« à cause d'un tableau de lui, la Peste de Marseille, montré pour de l'argent1 ». La victime de ce pré-
iugé bizarre fut toutefois réintégrée « après soumission », et en promettant de ne plus tirer de ses
ouvrages ce tribut au moins aussi légitime pourtant que celui qui provenait des commandes « des
Phrynés et des Laïs », comme David le faisait observer. Selon celui-ci, l'usage qu'il tentait d'intro-
duire pouvait être un moyen d'affranchissement pour l'art, une condition de dignité pour les artistes,
et sans doute il ne se trompait point. Mais à voir combien d'exemples empruntés à l'antiquité ou aux
nations étrangères il se croit obligé d'accumuler dans sa brochure pour justifier cette innovation
téméraire, il est facile de reconnaître que le préjugé auquel avait obéi l'ancienne Académie lui avait
survécu.
En même temps que les expositions nouvelles ouvraient à tous les artistes une carrière longtemps
1. Vitct, VAcadémie de peinture, p. 352.
Tome I.
44