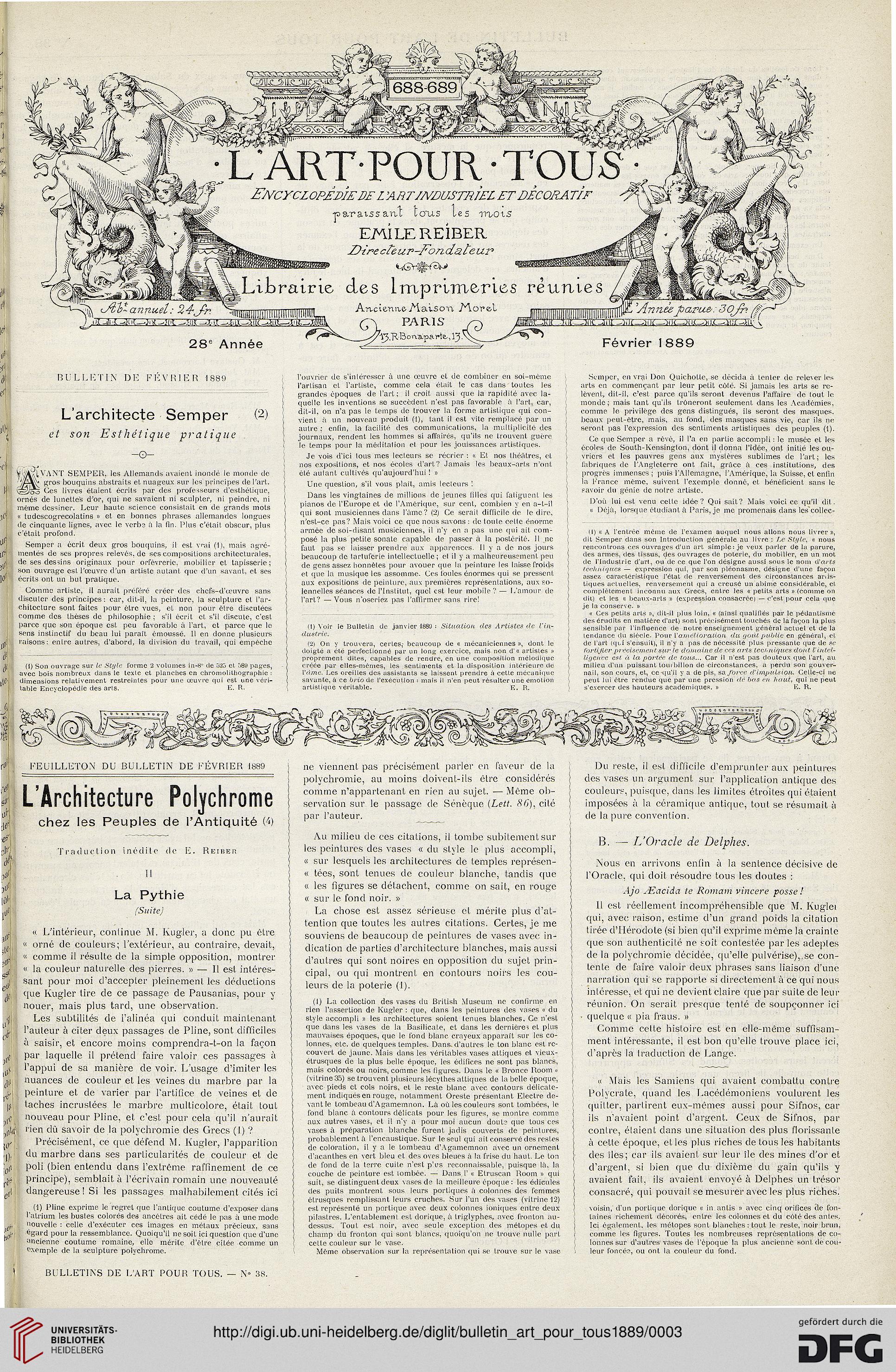5-
A
t
I
é
i
«
ri
|e|
1*
à
d
6(
I
U']
i f'
/
10
■;é
s»'
ni'
:1«!
■eSl
%
j
/
/
,D>
il"
A
i"!
/
A
10'
;i)i
io"
rl-
c1
JC"
t>0‘
L'ART-POUR. -TOUS
Encyclopédie df liartindustriel et décora tie
-p ar s.iss ard to'us les ituhs
EMILE REIBER
Dire cPe ur-Fon date ur
le
■wi—ai
■XiraurDÀKPiR
28e Année
Lit rai rie des Imprimeries réunies
An.cie.nn.e-Aiai.Son Alorel
(JY PARIS
■yj.RBon.aip&rte., TJ.'
uiAaai. Alix. -Dûx^iui;,-iaiL^!i ).c.-ÆE5i \
Février 1889
R U L L K TI N DK FÉVRIER 1889
L’architecte Semper (2)
ta so?z Esthétique pratique
-G-
-r AIDANT SEMPER, les Allemands avaient inondé le monde de )
gros bouquins abstraits et nuageux sur les principes de Fart. )
Èes livres étaient écrits par des professeurs d’esthétique,
ornés de lunette^ d’or, qui ne savaient ni sculpter, ni peindre, ni
même dessiner. Leur haute science consistait en de grands mots \
« tudcscogrecolatins » et en bonnes phrases allemandes longues (
de cinquante lignes, avec le verbe à la Fin. Plus c’était obscur, plus
c’était profond.
Semper a écrit deux gros bouquins, il est vrai (1), mais agré-
mentés de ses propres relevés, de ses compositions architecturales,
de ses dessins originaux pour orfèvrerie, mobilier et tapisserie ;
son ouvrage est l’œuvre d’un artiste autant que d’un savant, et ses
écrits ont un but pratique.
Comme artiste, il aurait préféré créer des chefs-d’œuvre sans
discuter des principes: car, dit-il, la peinture, la sculpture et Far- j
chitccture sont faites pour être vues, et non pour être discutées j
comme des thèses de philosophie ; s’il écrit et s’il discute, c’est
parce que son époque est peu favorable à l’art, et parce que le
sens instinctif du beau lui paraît émoussé. 11 en donne plusieurs \
raisons: entre autres, d’abord, la division du travail, qui empêche (
(1) Son ouvrage sur le Style forme 2 volumes in-8° de 523 et 589 pages, ,
avec bois nombreux clans le texlc et planches en chromolithographie :
dimensions relativement restreintes pour une œuvre qui est une véri-
table Encyclopédie des arts. E. R.
l’ouvrier de s’intéresser à une œuvre et de combiner en soi-même
l’artisan et l’artiste, comme cela était le cas dans toutes les
grandes époques de Fart ; il croit aussi que la rapidité avec la-
quelle les inventions se succèdent n’est pas favorable à Fart, car,
dit-il, on n’a pas le temps de trouver la forme artistique qui con-
vient à un nouveau produit (1), tant il est vite remplacé par un
autre : enfin, la facilité des communications, la multiplicité des
journaux, rendent les hommes si affairés, qu’ils ne trouvent guère
le temps pour la méditation et pour les jouissances artistiques.
Je vois d’ici tous mes lecteurs se récrier : « Et nos théâtres, et
nos expositions, et nos écoles d’art? Jamais les beaux-arts n’ont
été autant cultivés qu’aujourd’hui ! »
Une question, s’il vous plaît, amis lecteurs !
Dans les vingtaines de millions de jeunes filles qui fatiguent les
pianos de l’Europe et de l’Amérique, sur cent, combien y en a-t-il
qui sont musiciennes dans l’âme? (2) Ce serait difficile de le dire,
n’est-ce pas? Mais voici ce que nous savons : de toute cette énorme
armée de soi-disant musiciennes, il n’y en a pas une qui ait com-
posé la plus petite sonate capable de passer à la postérité. 11 ne
faut pas se laisser prendre aux apparences. Il y a de nos jours
beaucoup de tartuferie intellectuelle; et il y a malheureusement peu
de gens assez honnêtes pour avouer que la peinture les laisse froids
et que la musique les assomme. Ces foules énormes qui se pressent
aux expositions de peinture, aux premières représentations, aux so-
lennelles séances de l’Institut, quel est leur mobile? — L'amour de
l’art? —Vous n'oseriez pas l’affirmer sans rire!
(1) Voir le Bulletin de janvier 1889 : Situation des Artistes de T in-
dustrie.
(2) On y trouvera, certes,- beaucoup de « mécaniciennes », dont le
doigté a été perfectionné par un long exercice, mais non d'« artistes »
proprement dites, capables de rendre, en une composition mélodique
créée par elles-mêmes, les sentiments et la disposition intérieure de
Vàme. Les oreilles des assistants se laissent prendre à cette mécanique
savante, à ce brio de l’exécution : mais il n’en peut résulter une émotion
artistique véritable. E. R.
Semper, en vrai Don Quichotte, se décida à tenter de relever les
arts en commençant par leur petit côté. Si jamais les arts se re-
lèvent, dit-il, c’est parce qu’ils seront devenus l’affaire de tout le
monde; mais tant qu’ils trôneront seulement dans les Académies,
comme le privilège des gens distingués, ils seront des masques,
beaux peut-être, mais, au fond, des masques sans vie, car ils ne
seront pas l’expression des sentiments artistiques des peuples (1).
Ce que Semper a rêvé, il Fa en partie accompli : le musée et les
écoles de South-Kensington, dont il donna l’idée, ont initié les ou-
vriers et les pauvres gens aux mystères sublimes de Fart; les
fabriques de l'Angleterre ont fait, grâce à ces institutions, des
progrès immenses ; puis l’Allemagne, l’Amérique, la Suisse, cl enfin
la France même, suivent l’exemple donné, et, bénéficient sans le
savoir du ,génie de notre artiste.
D’où lui est venu celle idée? Qui sait? Mais voici ce qu’il dit.
« Déjà, lorsque étudiant à Paris, je me promenais dans les collec-
(1) « A l'entrée même de l’examen auquel nous allons nous livrer »,
dit Semper dans son Introduction générale au livre : Le Style, « nous
rencontrons ces ouvrages d’un art simple: je veux parler de la parure,
des armes, des tissus, des ouvrages de poterie, du mobilier, en un mot
de l’Industrie d'art, ou de ce que l’on désigne aussi sous le nom d'arts
techniques — expression qui, par son pléonasme, désigne d’une façon
assez caractéristique l’état de renversement des circonstances artis-
tiques actuelles, renversement qui a creusé un abîme considérable, et
complètement inconnu aux Grecs, entre les « petits arts » (comme on
dit) et les « beaux-arts » (expression consacrée) — c’est pour cela que
je la conserve. »
« Ces petits arts », dit-il plus loin, « (ainsi qualifiés par le pédantisme
des érudits en matière d’art) sont précisément touchés de la façon la plus
sensible par l'influence de notre enseignement général actuel et de la
tendance du siècle. Pour Y amélioration du goût public en général, et
de l’art (qui s’ensuit), il n’y a pas de nécessité plus pressante que de se
fortifier précisément sur le domaine de ces arts techniques dont Vintel-
ligence est à la portée de tous... Car il n’est pas douteux que l’art, au
milieu d’un puissant loin billon de circonstances, a perdu son gouver-
nail, son cours, et, ce qu’il y a de pis, sa force d’impulsion. Gelie-ei ne
peut lui être rendue que par une pression dé bas en haut, qui ne peut
s’exercer des hauteurs académiques. » E. R.
FEUILLETON DU BULLETIN DE FÉVRIER 1889
L’Architecture Polychrome
chez les Peuples de l’Antiquité à)
Traduction inédite de E. R e i n e ri
La Pythie
(Suite)
« L’intérieur, conlinue M. Kugler, a donc pu être
« orné de couleurs; l’extérieur, au contraire, devait,
« comme il résulte de la simple opposition, montrer
« la couleur naturelle des pierres. » — Il est intéres-
sant pour moi d’accepter pleinement les déductions
que Kugler tire de ce passage de Pausanias, pour y
nouer, mais plus tard, une observation.
Les subtilités de l’alinéa qui conduit maintenant
l’auteur à citer deux passages de Pline, sont difficiles
à saisir, et encore moins comprendra-t-on la façon
par laquelle il prétend faire valoir ces passages à
l’appui de sa manière de voir. L’usage d’imiter les
nuances de couleur et les veines du marbre par la
peinture et de varier par l’artifice de veines et de
taches incrustées le marbre multicolore, était tout
nouveau pour Pline, et c’est pour cela qu’il n’aurait
rien dû savoir de la polychromie des Grecs (1) ?
Précisément, ce que défend M. Kugler, l’apparition
du marbre dans ses particularités de couleur et de
poli (bien entendu dans l’extrême raffinement de ce
principe), semblait à l’écrivain romain une nouveauté
dangereuse ! Si les passages malhabilement cités ici
(1) Pline exprime le regret, que l’antique coutume d’exposer dans
1 atrium les bustes colorés des ancêtres ait cédé le pas à une mode
nouvelle : celle d’exécuter ces images en métaux précieux, sans
égard pour la ressemblance. Quoiqu’il ne soit ici question que d’une
ancienne coutume romaine, elle mérite d’être citée comme un
exemple de la sculpture polychrome.
j ne viennent pas précisément parler en faveur de la
polychromie, au moins doivent-ils être considérés
\ comme n’appartenant en rien au sujet. — Même ob-
j servation sur le passage de Sénèque (Lett. 86), cité
j par l’auteur.
Au milieu de ces citations, il tombe subitement sur
les peintures des vases « du style le plus accompli,
S « sur lesquels les architectures de temples représen-
« tées, sont tenues de couleur blanche, tandis que
« les figures se détachent, comme on sait, en rouge
« sur le fond noir. »
La chose est assez sérieuse et mérite plus d’at-
j tendon que toutes les autres citations. Certes, je me
I souviens de beaucoup de peintures de vases avec in-
J dication de parties d’architecture blanches, mais aussi
; d’autres qui sont noires en opposition du sujet prin-
j cipal, ou qui montrent en contours noirs les cou-
j leurs de la poterie (I).
(1) La collection des vases du British Muséum ne confirme en
rien l’assertion de Kugler : que, dans les peintures des vases « du
) style accompli » les architectures soient tenues blanches. Ce n'est
que dans les vases de la Basilicate, et dans les dernières et plus
j mauvaises époques, que le fond blanc crayeux apparaît sur les co-
( lonnes, etc. de quelques temples. Dans, d’autres le ton blanc est rc-
( couvert de jaune. Mais dans les véritables vases attiques et vieux-
étrusques de la plus belle époque, les édifices ne sont pas blancs,
, mais colorés ou noirs, comme les figures. Dans le « Bronce Boom »
(vitrine 35) se trouvent plusieurs lécythes attiques de la belle époque,
; avec pieds et cols noirs, et le reste blanc avec contours délicate-
| ment indiqués en rouge, notamment Oreste présentant Electre de-
vant le tombeau d’Agamemnon. Là où les couleurs sont tombées, le
fond blanc à contours délicats pour les figures, se montre comme
aux autres vases, et il n'y a pour moi aucun doute que tous ces
vases à préparation blanche furent jadis couverts de peintures,
probablement à l’encaustique. Sur le seul qui ait conservé des restes
de coloration, il y a le tombeau d’Agamemnon avec un ornement.
\ d’acanthes en vert bleu et des oves bleues à la frise du haut. Le ton
de fond de la terre cuite n’est p'us reconnaissable, puisque lâ, la
couche de peinture est lombée. — Dans F « Etruscan Boom » qui
suit, se distinguent deux vases de la meilleure époque : les édicules
des puits montrent sous leurs portiques à colonnes des femmes
| étrusques remplissant leurs cruches. Sur l'un des vases (vitrine 12)
est représenté un portique avec deux colonnes ioniques entre deux
pilastres. L’entablement est dorique, à triglyphes, avec fronton au-
dessus. Tout est noir, avec seule exception des métopes et du
champ du fronton qui sont blancs, quoiqu’on ne trouve nulle part
( cette couleur sur le vase.
Même observation sur la représentation qui se trouve sur le vase
Du reste, il est difficile d’emprunter aux peintures
des vases un argument sur l’application antique des
i couleurs, puisque, dans les limites étroites qui étaient
! imposées à la céramique antique, tout se résumait à
de la pure convention.
B. - L’Oracle de Delphes.
Nous en arrivons enfin à la sentence décisive de
j l’Oracle, qui doit résoudre tous les doutes :
Ajo Æacida te Romain vincere posse !
Il est réellement incompréhensible que M. Kuglei
) qui, avec raison, estime d’un grand poids la citation
tirée d’Hérodote (si bien qu’il exprime même la crainte
j que son authenticité ne soit contestée par les adeptes
i de la polychromie décidée, qu’elle pulvérise),.se con-
tente de faire valoir deux phrases sans liaison d’une
narration qui se rapporte si directement à ce qui nous
j intéressé* et qui ne devient claire que par suite de leur
! réunion. On serait presque tenté de soupçonner ici
j quelque « pia fraus. »
Comme cette histoire est en elle-même suffisam-
ment intéressante, il est bon qu’elle trouve place ici,
d’après la traduction de Lange.
« Mais les Samiens qui avaient combattu contre
Polvcrate, quand les Lacédémoniens voulurent les
quitter, partirent eux-mêmes aussi pour Sifnos, car
ils n’avaient point d’argent. Ceux de Sifnos, par
! contre, étaient dans une situation des plus florissante
j à cetle époque, et les plus riches de tous les habitants
• des îles; car ils avaient sur leur île des mines d’or et
d’argent, si bien que du dixième du gain qu’ils y
I avaient fait, ils avaient envoyé à Delphes un trésor
j consacré, qui pouvait se mesurer avec les plus riches.
) voisin, d’un portique dorique « in antis » avec cinq orifices de fon-
! laines richement décorés, entre les colonnes et du côté des antes,
\ Ici également, les métopes sont blanches : tout le reste, noir brun,
/ comme les figures. Toutes les nombreuses représentations de co-
lonnes sur d’autres vases de l’époque la plus ancienne sont de cou-
leur foncée, ou ont la couleur du fond.
|
BULLETINS DE L’ART POUR TOUS. — N* 38.
A
t
I
é
i
«
ri
|e|
1*
à
d
6(
I
U']
i f'
/
10
■;é
s»'
ni'
:1«!
■eSl
%
j
/
/
,D>
il"
A
i"!
/
A
10'
;i)i
io"
rl-
c1
JC"
t>0‘
L'ART-POUR. -TOUS
Encyclopédie df liartindustriel et décora tie
-p ar s.iss ard to'us les ituhs
EMILE REIBER
Dire cPe ur-Fon date ur
le
■wi—ai
■XiraurDÀKPiR
28e Année
Lit rai rie des Imprimeries réunies
An.cie.nn.e-Aiai.Son Alorel
(JY PARIS
■yj.RBon.aip&rte., TJ.'
uiAaai. Alix. -Dûx^iui;,-iaiL^!i ).c.-ÆE5i \
Février 1889
R U L L K TI N DK FÉVRIER 1889
L’architecte Semper (2)
ta so?z Esthétique pratique
-G-
-r AIDANT SEMPER, les Allemands avaient inondé le monde de )
gros bouquins abstraits et nuageux sur les principes de Fart. )
Èes livres étaient écrits par des professeurs d’esthétique,
ornés de lunette^ d’or, qui ne savaient ni sculpter, ni peindre, ni
même dessiner. Leur haute science consistait en de grands mots \
« tudcscogrecolatins » et en bonnes phrases allemandes longues (
de cinquante lignes, avec le verbe à la Fin. Plus c’était obscur, plus
c’était profond.
Semper a écrit deux gros bouquins, il est vrai (1), mais agré-
mentés de ses propres relevés, de ses compositions architecturales,
de ses dessins originaux pour orfèvrerie, mobilier et tapisserie ;
son ouvrage est l’œuvre d’un artiste autant que d’un savant, et ses
écrits ont un but pratique.
Comme artiste, il aurait préféré créer des chefs-d’œuvre sans
discuter des principes: car, dit-il, la peinture, la sculpture et Far- j
chitccture sont faites pour être vues, et non pour être discutées j
comme des thèses de philosophie ; s’il écrit et s’il discute, c’est
parce que son époque est peu favorable à l’art, et parce que le
sens instinctif du beau lui paraît émoussé. 11 en donne plusieurs \
raisons: entre autres, d’abord, la division du travail, qui empêche (
(1) Son ouvrage sur le Style forme 2 volumes in-8° de 523 et 589 pages, ,
avec bois nombreux clans le texlc et planches en chromolithographie :
dimensions relativement restreintes pour une œuvre qui est une véri-
table Encyclopédie des arts. E. R.
l’ouvrier de s’intéresser à une œuvre et de combiner en soi-même
l’artisan et l’artiste, comme cela était le cas dans toutes les
grandes époques de Fart ; il croit aussi que la rapidité avec la-
quelle les inventions se succèdent n’est pas favorable à Fart, car,
dit-il, on n’a pas le temps de trouver la forme artistique qui con-
vient à un nouveau produit (1), tant il est vite remplacé par un
autre : enfin, la facilité des communications, la multiplicité des
journaux, rendent les hommes si affairés, qu’ils ne trouvent guère
le temps pour la méditation et pour les jouissances artistiques.
Je vois d’ici tous mes lecteurs se récrier : « Et nos théâtres, et
nos expositions, et nos écoles d’art? Jamais les beaux-arts n’ont
été autant cultivés qu’aujourd’hui ! »
Une question, s’il vous plaît, amis lecteurs !
Dans les vingtaines de millions de jeunes filles qui fatiguent les
pianos de l’Europe et de l’Amérique, sur cent, combien y en a-t-il
qui sont musiciennes dans l’âme? (2) Ce serait difficile de le dire,
n’est-ce pas? Mais voici ce que nous savons : de toute cette énorme
armée de soi-disant musiciennes, il n’y en a pas une qui ait com-
posé la plus petite sonate capable de passer à la postérité. 11 ne
faut pas se laisser prendre aux apparences. Il y a de nos jours
beaucoup de tartuferie intellectuelle; et il y a malheureusement peu
de gens assez honnêtes pour avouer que la peinture les laisse froids
et que la musique les assomme. Ces foules énormes qui se pressent
aux expositions de peinture, aux premières représentations, aux so-
lennelles séances de l’Institut, quel est leur mobile? — L'amour de
l’art? —Vous n'oseriez pas l’affirmer sans rire!
(1) Voir le Bulletin de janvier 1889 : Situation des Artistes de T in-
dustrie.
(2) On y trouvera, certes,- beaucoup de « mécaniciennes », dont le
doigté a été perfectionné par un long exercice, mais non d'« artistes »
proprement dites, capables de rendre, en une composition mélodique
créée par elles-mêmes, les sentiments et la disposition intérieure de
Vàme. Les oreilles des assistants se laissent prendre à cette mécanique
savante, à ce brio de l’exécution : mais il n’en peut résulter une émotion
artistique véritable. E. R.
Semper, en vrai Don Quichotte, se décida à tenter de relever les
arts en commençant par leur petit côté. Si jamais les arts se re-
lèvent, dit-il, c’est parce qu’ils seront devenus l’affaire de tout le
monde; mais tant qu’ils trôneront seulement dans les Académies,
comme le privilège des gens distingués, ils seront des masques,
beaux peut-être, mais, au fond, des masques sans vie, car ils ne
seront pas l’expression des sentiments artistiques des peuples (1).
Ce que Semper a rêvé, il Fa en partie accompli : le musée et les
écoles de South-Kensington, dont il donna l’idée, ont initié les ou-
vriers et les pauvres gens aux mystères sublimes de Fart; les
fabriques de l'Angleterre ont fait, grâce à ces institutions, des
progrès immenses ; puis l’Allemagne, l’Amérique, la Suisse, cl enfin
la France même, suivent l’exemple donné, et, bénéficient sans le
savoir du ,génie de notre artiste.
D’où lui est venu celle idée? Qui sait? Mais voici ce qu’il dit.
« Déjà, lorsque étudiant à Paris, je me promenais dans les collec-
(1) « A l'entrée même de l’examen auquel nous allons nous livrer »,
dit Semper dans son Introduction générale au livre : Le Style, « nous
rencontrons ces ouvrages d’un art simple: je veux parler de la parure,
des armes, des tissus, des ouvrages de poterie, du mobilier, en un mot
de l’Industrie d'art, ou de ce que l’on désigne aussi sous le nom d'arts
techniques — expression qui, par son pléonasme, désigne d’une façon
assez caractéristique l’état de renversement des circonstances artis-
tiques actuelles, renversement qui a creusé un abîme considérable, et
complètement inconnu aux Grecs, entre les « petits arts » (comme on
dit) et les « beaux-arts » (expression consacrée) — c’est pour cela que
je la conserve. »
« Ces petits arts », dit-il plus loin, « (ainsi qualifiés par le pédantisme
des érudits en matière d’art) sont précisément touchés de la façon la plus
sensible par l'influence de notre enseignement général actuel et de la
tendance du siècle. Pour Y amélioration du goût public en général, et
de l’art (qui s’ensuit), il n’y a pas de nécessité plus pressante que de se
fortifier précisément sur le domaine de ces arts techniques dont Vintel-
ligence est à la portée de tous... Car il n’est pas douteux que l’art, au
milieu d’un puissant loin billon de circonstances, a perdu son gouver-
nail, son cours, et, ce qu’il y a de pis, sa force d’impulsion. Gelie-ei ne
peut lui être rendue que par une pression dé bas en haut, qui ne peut
s’exercer des hauteurs académiques. » E. R.
FEUILLETON DU BULLETIN DE FÉVRIER 1889
L’Architecture Polychrome
chez les Peuples de l’Antiquité à)
Traduction inédite de E. R e i n e ri
La Pythie
(Suite)
« L’intérieur, conlinue M. Kugler, a donc pu être
« orné de couleurs; l’extérieur, au contraire, devait,
« comme il résulte de la simple opposition, montrer
« la couleur naturelle des pierres. » — Il est intéres-
sant pour moi d’accepter pleinement les déductions
que Kugler tire de ce passage de Pausanias, pour y
nouer, mais plus tard, une observation.
Les subtilités de l’alinéa qui conduit maintenant
l’auteur à citer deux passages de Pline, sont difficiles
à saisir, et encore moins comprendra-t-on la façon
par laquelle il prétend faire valoir ces passages à
l’appui de sa manière de voir. L’usage d’imiter les
nuances de couleur et les veines du marbre par la
peinture et de varier par l’artifice de veines et de
taches incrustées le marbre multicolore, était tout
nouveau pour Pline, et c’est pour cela qu’il n’aurait
rien dû savoir de la polychromie des Grecs (1) ?
Précisément, ce que défend M. Kugler, l’apparition
du marbre dans ses particularités de couleur et de
poli (bien entendu dans l’extrême raffinement de ce
principe), semblait à l’écrivain romain une nouveauté
dangereuse ! Si les passages malhabilement cités ici
(1) Pline exprime le regret, que l’antique coutume d’exposer dans
1 atrium les bustes colorés des ancêtres ait cédé le pas à une mode
nouvelle : celle d’exécuter ces images en métaux précieux, sans
égard pour la ressemblance. Quoiqu’il ne soit ici question que d’une
ancienne coutume romaine, elle mérite d’être citée comme un
exemple de la sculpture polychrome.
j ne viennent pas précisément parler en faveur de la
polychromie, au moins doivent-ils être considérés
\ comme n’appartenant en rien au sujet. — Même ob-
j servation sur le passage de Sénèque (Lett. 86), cité
j par l’auteur.
Au milieu de ces citations, il tombe subitement sur
les peintures des vases « du style le plus accompli,
S « sur lesquels les architectures de temples représen-
« tées, sont tenues de couleur blanche, tandis que
« les figures se détachent, comme on sait, en rouge
« sur le fond noir. »
La chose est assez sérieuse et mérite plus d’at-
j tendon que toutes les autres citations. Certes, je me
I souviens de beaucoup de peintures de vases avec in-
J dication de parties d’architecture blanches, mais aussi
; d’autres qui sont noires en opposition du sujet prin-
j cipal, ou qui montrent en contours noirs les cou-
j leurs de la poterie (I).
(1) La collection des vases du British Muséum ne confirme en
rien l’assertion de Kugler : que, dans les peintures des vases « du
) style accompli » les architectures soient tenues blanches. Ce n'est
que dans les vases de la Basilicate, et dans les dernières et plus
j mauvaises époques, que le fond blanc crayeux apparaît sur les co-
( lonnes, etc. de quelques temples. Dans, d’autres le ton blanc est rc-
( couvert de jaune. Mais dans les véritables vases attiques et vieux-
étrusques de la plus belle époque, les édifices ne sont pas blancs,
, mais colorés ou noirs, comme les figures. Dans le « Bronce Boom »
(vitrine 35) se trouvent plusieurs lécythes attiques de la belle époque,
; avec pieds et cols noirs, et le reste blanc avec contours délicate-
| ment indiqués en rouge, notamment Oreste présentant Electre de-
vant le tombeau d’Agamemnon. Là où les couleurs sont tombées, le
fond blanc à contours délicats pour les figures, se montre comme
aux autres vases, et il n'y a pour moi aucun doute que tous ces
vases à préparation blanche furent jadis couverts de peintures,
probablement à l’encaustique. Sur le seul qui ait conservé des restes
de coloration, il y a le tombeau d’Agamemnon avec un ornement.
\ d’acanthes en vert bleu et des oves bleues à la frise du haut. Le ton
de fond de la terre cuite n’est p'us reconnaissable, puisque lâ, la
couche de peinture est lombée. — Dans F « Etruscan Boom » qui
suit, se distinguent deux vases de la meilleure époque : les édicules
des puits montrent sous leurs portiques à colonnes des femmes
| étrusques remplissant leurs cruches. Sur l'un des vases (vitrine 12)
est représenté un portique avec deux colonnes ioniques entre deux
pilastres. L’entablement est dorique, à triglyphes, avec fronton au-
dessus. Tout est noir, avec seule exception des métopes et du
champ du fronton qui sont blancs, quoiqu’on ne trouve nulle part
( cette couleur sur le vase.
Même observation sur la représentation qui se trouve sur le vase
Du reste, il est difficile d’emprunter aux peintures
des vases un argument sur l’application antique des
i couleurs, puisque, dans les limites étroites qui étaient
! imposées à la céramique antique, tout se résumait à
de la pure convention.
B. - L’Oracle de Delphes.
Nous en arrivons enfin à la sentence décisive de
j l’Oracle, qui doit résoudre tous les doutes :
Ajo Æacida te Romain vincere posse !
Il est réellement incompréhensible que M. Kuglei
) qui, avec raison, estime d’un grand poids la citation
tirée d’Hérodote (si bien qu’il exprime même la crainte
j que son authenticité ne soit contestée par les adeptes
i de la polychromie décidée, qu’elle pulvérise),.se con-
tente de faire valoir deux phrases sans liaison d’une
narration qui se rapporte si directement à ce qui nous
j intéressé* et qui ne devient claire que par suite de leur
! réunion. On serait presque tenté de soupçonner ici
j quelque « pia fraus. »
Comme cette histoire est en elle-même suffisam-
ment intéressante, il est bon qu’elle trouve place ici,
d’après la traduction de Lange.
« Mais les Samiens qui avaient combattu contre
Polvcrate, quand les Lacédémoniens voulurent les
quitter, partirent eux-mêmes aussi pour Sifnos, car
ils n’avaient point d’argent. Ceux de Sifnos, par
! contre, étaient dans une situation des plus florissante
j à cetle époque, et les plus riches de tous les habitants
• des îles; car ils avaient sur leur île des mines d’or et
d’argent, si bien que du dixième du gain qu’ils y
I avaient fait, ils avaient envoyé à Delphes un trésor
j consacré, qui pouvait se mesurer avec les plus riches.
) voisin, d’un portique dorique « in antis » avec cinq orifices de fon-
! laines richement décorés, entre les colonnes et du côté des antes,
\ Ici également, les métopes sont blanches : tout le reste, noir brun,
/ comme les figures. Toutes les nombreuses représentations de co-
lonnes sur d’autres vases de l’époque la plus ancienne sont de cou-
leur foncée, ou ont la couleur du fond.
|
BULLETINS DE L’ART POUR TOUS. — N* 38.