Hinweis: Dies ist eine zusätzlich gescannte Seite, um Farbkeil und Maßstab abbilden zu können.
0.5
1 cm
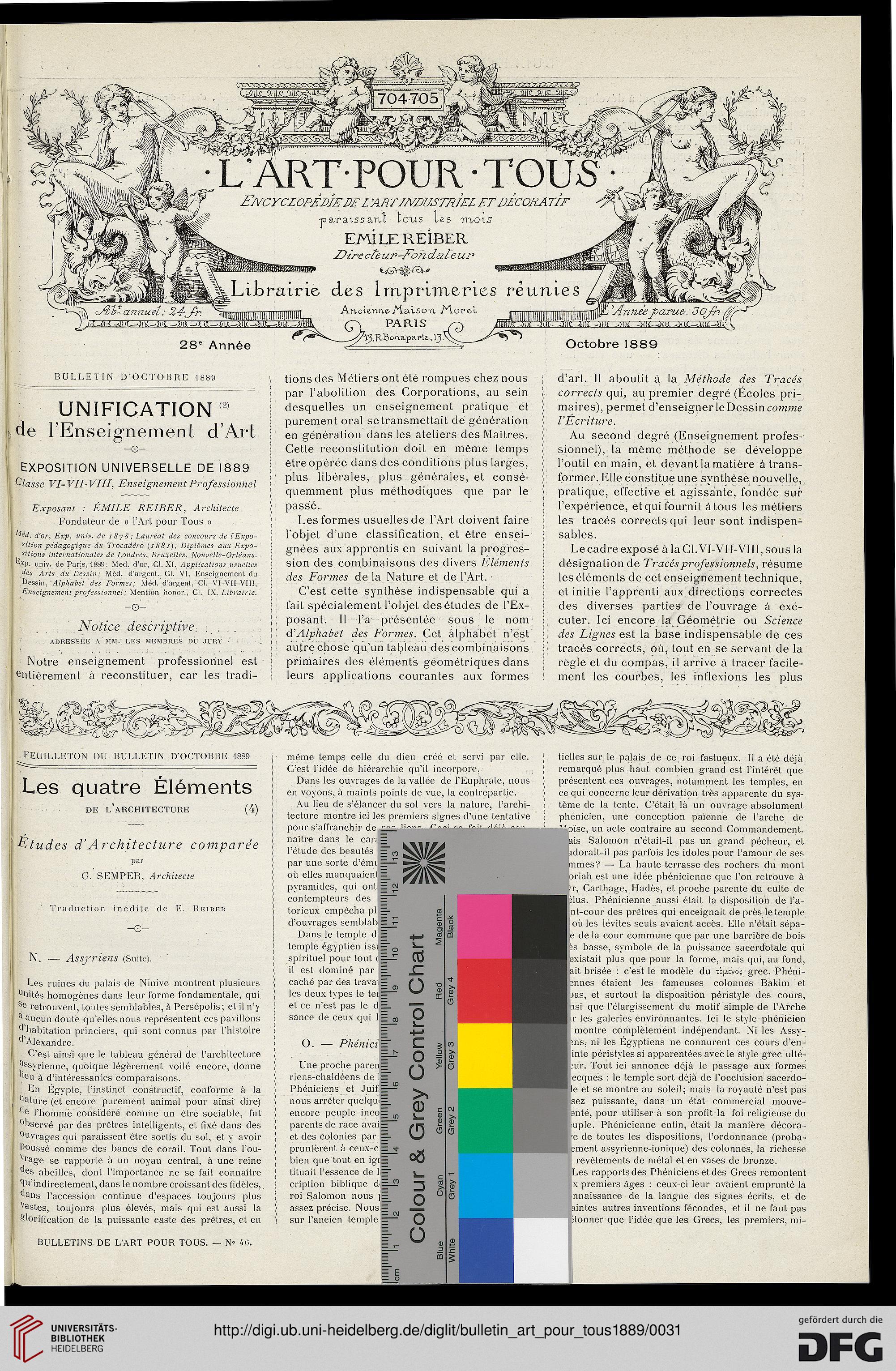
L'ART-POUR-TOUS
Encyclopédiedf z 'artindustriel et décora t/e
■paraissant to'us les wois
Ei^ILEREIBER
ILDc cPeu p -Non ci a Leu iJ
28e Année
Lit rairie des imprimeries réunies
ArucienaeZlalson TAorol
PARIS
'■fpR Bonaparte., g
Octobre 1889
BULLETIN D’OCTOBRE 1889
UNIFICATION
(2)
de l’Enseignement d’Art
-o-
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Classe VI- VII- VIII, Enseignement Professionnel
Exposant : ÉMILE REIBER, Architecte
Fondateur de « l’Art pour Tous »
d’or, Exp. unir, de 1878 ; Lauréat des concours de l'Expo-
sition pédagogique du Trocadéro (1881); Diplômes aux Expo-
rtions internationales de Londres, Bruxelles, Nouvelle-Orléans. .
LXP- univ. de Paris, 1889: Méd. d’or, Cl. XI, Applications usuelles
des Arts .du Dessin; Méd. d’argent, Cl. VI, Enseignement du
Dessin, Alphabet des Formes; Méd. d’argent, Cl. VI-VII—VIII,
Enseignement professionnel; Mention honor., Cl. IX. Librairie.
-O-
Notice descriptive.
ADRESSÉE A MM. LES MEMBRES DU JURY
Noire
Entièrement
enseignement
professionnel est
à reconstituer, car les tradi-
tions des Métiers ont été rompues chez nous
par l’abolition des Corporations, au sein
desquelles un enseignement pratique et
purement oral se transmettait de génération
en génération dans les ateliers des Maîtres.
Cette reconstitution doit en même temps
être opérée dans des conditions plus larges,
plus libérales, plus générales, et consé-
quemment plus méthodiques que par le
passé.
Les formes usuelles de l’Art doivent faire
l’objet d’une classification, et être ensei-
gnées aux apprentis en suivant la progres-
sion des combinaisons des divers Eléments
des Formes de la Nature et de l’Art.
C’est cette synthèse indispensable qui a
fait spécialement l’objet des études de l’Ex-
posant. Il l’a présentée sous le nom
A'Alphabet des Formes. Cet alphabet n’est'
autre chose qu’un tableau des combinaisons
primaires des éléments géométriques dans
leurs applications courantes aux formes
d’art. Il aboutit à la Méthode des Tracés
corrects qui, au premier degré (Écoles pri-
maires), permet d’enseigner le Dessin comme
V Ecriture.
Au second degré (Enseignement profes-
sionnel), la même mélhode se développe
l’outil en main, et devant la matière à trans-
former. Elle constitue une synthèse nouvelle,
pratique, effective et agissante, fondée sur
l’expérience, et qui fournit à tous les métiers
les tracés corrects qui leur sont indispen-
sables.
Le cadre exposé à la Cl. VI-VII-VIII, sous la
désignation de Tracés professionnels, résume
les éléments de cet enseignement technique,
et initie l’apprenti aux directions correctes
des diverses parties de l’ouvrage à exé-
cuter. Ici encore la Géométrie ou Science
des Lignes est la base indispensable de ces
tracés corrects, où, tout en se servant de la
règle et du compas, il arrive à tracer facile-
ment les courbes, les inflexions les plus
'^feuilleton du bulletin d’octobre issù
Les quatre Éléments
de l’architecture (4)
Etudes d’Architecture comparée
par
G. SEMPER, Architecte
T r a cl u c t io n inédite de E. R e i b e r
-G-
N. ■— Assyriens (Suite).
Les ruines du palais de Ninive montrent plusieurs
unités homogènes dans leur forme fondamentale, qui
Se retrouvent, toutes semblables, à Persépolis; et il n’y
a aucun douté qu’elles nous représentent ces pavillons
D habitation princiers, qui sont connus par l’histoire
D’Alexandre.
C’est ainsi que le tableau général de l’architecture
assy rienne, quoique légèrement voilé encore, donne
'jeu à d’intéressantes comparaisons.
En Égypte, l’instinct constructif, conforme à la
èalure (et encore purement animal pour ainsi dire)
De l'homme considéré comme un être sociable, fut
observé par des prêtres intelligents, et fixé dans des
Ouvrages qui paraissent être sorlis du sol, et y avoir
Poussé comme des bancs de corail. Tout dans rou-
lage se rapporte à un noyau central, à une reine
Des abeilles, dont l’importance ne se fait connaître
^^'indirectement, dans le nombre croissant des fidèles,
Dans l’accession continue d’espaces toujours plus
'astes, toujours plus élevés, mais qui est aussi la
glorification de la puissante caste des prêtres, et en
SHg
7m
même temps celle du dieu créé et servi par elle.
C’est l’idée de hiérarchie qu’il incorpore.
Dans les ouvrages de la vallée de l’Euphrate, nous
en voyons, à maints points de vue, la contrepartie.
Au lieu de s’élancer du sol vers la nature, l’archi-
tecture montre ici les premiers signes d’une tentative
pour s’affranchir de
naître dans le car: -
l’étude des beautés E"m
par une sorte d’émi E—
où elles manquaient —
pyramides, qui ont E n
contempteurs des E
torieux empêcha pl E-
d’ouvrages semblab ~ t-
Dans le temple d E
temple égyptien issiE~0
spirituel pour tout <
il est dominé par E_
caché par des travai E œ
les deux types le tei -
et ce n’est pas le d E_
sance de ceux qui I E co
O.
Pliénici -
Une proche pareil
riens-chaldéens de 1
Phéniciens et Juif:
nous arrêter quelque
encore peuple inco|
parents de race avai
et des colonies par
pruntèrent à ceux-c
bien que tout en igr
tituait l’essence de 1
cription biblique d>
roi Salomon nous |
assez précise. Nous
sur l’ancien temple
I ü
08
—
^ O
E E
CD
CD
tielles sur le palais de ce roi fastueux. Il a été déjà
remarqué plus haut combien grand est l’intérêt que
présentent ces ouvrages, notamment les temples, en
ce qui concerne leur dérivation très apparente du sys-
tème de la lente. C’était là un ouvrage absolument
phénicien, une conception païenne de l’arche de
"ioïse, un acte contraire au second Commandement,
ais Salomon n’était-il pas un grand pécheur, et
rdorail-il pas parfois les idoles pour l’amour de ses
Hmmes? — La haute terrasse des rochers du mont
; qoriah est une idée phénicienne que l’on retrouve à
n', Carthage, Hadès, et proche parente du culte de
dus. Phénicienne aussi était la disposition de l’a-
nl-cour des prêtres qui enceignait de près le temple
où les lévites seuls avaient accès. Elle n’était sépa-
I e de la cour commune que par une barrière de bois
Hbs basse, symbole de la puissance sacerdotale qui
■existait plus que pour la forme, mais qui, au fond,
1 ait brisée : c’est le modèle du Tègsvo; grec. Phéni-
ennes étaient les fameuses colonnes Bakim et
■aas, et surtout la disposition péristyle des cours,
nsi que l’élargissement du motif simple de l’Arche
ir les galeries environnantes. Ici le style phénicien
montre complètement indépendant. Ni les Assy-
hîns,- ni les Égyptiens ne connurent ces cours d’en-
inte péristyles si apparentées avec le style grec ulté-
l'iïr. Tout ici annonce déjà le passage aux formes
ecques : le temple sort déjà de l’occlusion sacerdo-
le et se montre au soleil; mais la royauté n’est pas
sez puissante, dans un état commercial mouve-
ènté, pour utiliser à son profit la foi religieuse du
uple. Phénicienne enfin, était la manière décora-
■e de toutes les dispositions, l’ordonnance (proba-
ement assyrienne-ionique) des colonnes, la richesse
revêtements de métal et en vases de bronze.
|Les rapports des Phéniciens et des Grecs remontent
|x premiers âges : ceux-ci leur avaient emprunté la
nnaissance de la langue des signes écrits, et de
(aintes autres inventions fécondes, et il ne faut pas
donner que l’idée que les Grecs, les premiers, mi-
BULLETINS DE L'ART POUR TOUS. — N- 40.
Encyclopédiedf z 'artindustriel et décora t/e
■paraissant to'us les wois
Ei^ILEREIBER
ILDc cPeu p -Non ci a Leu iJ
28e Année
Lit rairie des imprimeries réunies
ArucienaeZlalson TAorol
PARIS
'■fpR Bonaparte., g
Octobre 1889
BULLETIN D’OCTOBRE 1889
UNIFICATION
(2)
de l’Enseignement d’Art
-o-
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Classe VI- VII- VIII, Enseignement Professionnel
Exposant : ÉMILE REIBER, Architecte
Fondateur de « l’Art pour Tous »
d’or, Exp. unir, de 1878 ; Lauréat des concours de l'Expo-
sition pédagogique du Trocadéro (1881); Diplômes aux Expo-
rtions internationales de Londres, Bruxelles, Nouvelle-Orléans. .
LXP- univ. de Paris, 1889: Méd. d’or, Cl. XI, Applications usuelles
des Arts .du Dessin; Méd. d’argent, Cl. VI, Enseignement du
Dessin, Alphabet des Formes; Méd. d’argent, Cl. VI-VII—VIII,
Enseignement professionnel; Mention honor., Cl. IX. Librairie.
-O-
Notice descriptive.
ADRESSÉE A MM. LES MEMBRES DU JURY
Noire
Entièrement
enseignement
professionnel est
à reconstituer, car les tradi-
tions des Métiers ont été rompues chez nous
par l’abolition des Corporations, au sein
desquelles un enseignement pratique et
purement oral se transmettait de génération
en génération dans les ateliers des Maîtres.
Cette reconstitution doit en même temps
être opérée dans des conditions plus larges,
plus libérales, plus générales, et consé-
quemment plus méthodiques que par le
passé.
Les formes usuelles de l’Art doivent faire
l’objet d’une classification, et être ensei-
gnées aux apprentis en suivant la progres-
sion des combinaisons des divers Eléments
des Formes de la Nature et de l’Art.
C’est cette synthèse indispensable qui a
fait spécialement l’objet des études de l’Ex-
posant. Il l’a présentée sous le nom
A'Alphabet des Formes. Cet alphabet n’est'
autre chose qu’un tableau des combinaisons
primaires des éléments géométriques dans
leurs applications courantes aux formes
d’art. Il aboutit à la Méthode des Tracés
corrects qui, au premier degré (Écoles pri-
maires), permet d’enseigner le Dessin comme
V Ecriture.
Au second degré (Enseignement profes-
sionnel), la même mélhode se développe
l’outil en main, et devant la matière à trans-
former. Elle constitue une synthèse nouvelle,
pratique, effective et agissante, fondée sur
l’expérience, et qui fournit à tous les métiers
les tracés corrects qui leur sont indispen-
sables.
Le cadre exposé à la Cl. VI-VII-VIII, sous la
désignation de Tracés professionnels, résume
les éléments de cet enseignement technique,
et initie l’apprenti aux directions correctes
des diverses parties de l’ouvrage à exé-
cuter. Ici encore la Géométrie ou Science
des Lignes est la base indispensable de ces
tracés corrects, où, tout en se servant de la
règle et du compas, il arrive à tracer facile-
ment les courbes, les inflexions les plus
'^feuilleton du bulletin d’octobre issù
Les quatre Éléments
de l’architecture (4)
Etudes d’Architecture comparée
par
G. SEMPER, Architecte
T r a cl u c t io n inédite de E. R e i b e r
-G-
N. ■— Assyriens (Suite).
Les ruines du palais de Ninive montrent plusieurs
unités homogènes dans leur forme fondamentale, qui
Se retrouvent, toutes semblables, à Persépolis; et il n’y
a aucun douté qu’elles nous représentent ces pavillons
D habitation princiers, qui sont connus par l’histoire
D’Alexandre.
C’est ainsi que le tableau général de l’architecture
assy rienne, quoique légèrement voilé encore, donne
'jeu à d’intéressantes comparaisons.
En Égypte, l’instinct constructif, conforme à la
èalure (et encore purement animal pour ainsi dire)
De l'homme considéré comme un être sociable, fut
observé par des prêtres intelligents, et fixé dans des
Ouvrages qui paraissent être sorlis du sol, et y avoir
Poussé comme des bancs de corail. Tout dans rou-
lage se rapporte à un noyau central, à une reine
Des abeilles, dont l’importance ne se fait connaître
^^'indirectement, dans le nombre croissant des fidèles,
Dans l’accession continue d’espaces toujours plus
'astes, toujours plus élevés, mais qui est aussi la
glorification de la puissante caste des prêtres, et en
SHg
7m
même temps celle du dieu créé et servi par elle.
C’est l’idée de hiérarchie qu’il incorpore.
Dans les ouvrages de la vallée de l’Euphrate, nous
en voyons, à maints points de vue, la contrepartie.
Au lieu de s’élancer du sol vers la nature, l’archi-
tecture montre ici les premiers signes d’une tentative
pour s’affranchir de
naître dans le car: -
l’étude des beautés E"m
par une sorte d’émi E—
où elles manquaient —
pyramides, qui ont E n
contempteurs des E
torieux empêcha pl E-
d’ouvrages semblab ~ t-
Dans le temple d E
temple égyptien issiE~0
spirituel pour tout <
il est dominé par E_
caché par des travai E œ
les deux types le tei -
et ce n’est pas le d E_
sance de ceux qui I E co
O.
Pliénici -
Une proche pareil
riens-chaldéens de 1
Phéniciens et Juif:
nous arrêter quelque
encore peuple inco|
parents de race avai
et des colonies par
pruntèrent à ceux-c
bien que tout en igr
tituait l’essence de 1
cription biblique d>
roi Salomon nous |
assez précise. Nous
sur l’ancien temple
I ü
08
—
^ O
E E
CD
CD
tielles sur le palais de ce roi fastueux. Il a été déjà
remarqué plus haut combien grand est l’intérêt que
présentent ces ouvrages, notamment les temples, en
ce qui concerne leur dérivation très apparente du sys-
tème de la lente. C’était là un ouvrage absolument
phénicien, une conception païenne de l’arche de
"ioïse, un acte contraire au second Commandement,
ais Salomon n’était-il pas un grand pécheur, et
rdorail-il pas parfois les idoles pour l’amour de ses
Hmmes? — La haute terrasse des rochers du mont
; qoriah est une idée phénicienne que l’on retrouve à
n', Carthage, Hadès, et proche parente du culte de
dus. Phénicienne aussi était la disposition de l’a-
nl-cour des prêtres qui enceignait de près le temple
où les lévites seuls avaient accès. Elle n’était sépa-
I e de la cour commune que par une barrière de bois
Hbs basse, symbole de la puissance sacerdotale qui
■existait plus que pour la forme, mais qui, au fond,
1 ait brisée : c’est le modèle du Tègsvo; grec. Phéni-
ennes étaient les fameuses colonnes Bakim et
■aas, et surtout la disposition péristyle des cours,
nsi que l’élargissement du motif simple de l’Arche
ir les galeries environnantes. Ici le style phénicien
montre complètement indépendant. Ni les Assy-
hîns,- ni les Égyptiens ne connurent ces cours d’en-
inte péristyles si apparentées avec le style grec ulté-
l'iïr. Tout ici annonce déjà le passage aux formes
ecques : le temple sort déjà de l’occlusion sacerdo-
le et se montre au soleil; mais la royauté n’est pas
sez puissante, dans un état commercial mouve-
ènté, pour utiliser à son profit la foi religieuse du
uple. Phénicienne enfin, était la manière décora-
■e de toutes les dispositions, l’ordonnance (proba-
ement assyrienne-ionique) des colonnes, la richesse
revêtements de métal et en vases de bronze.
|Les rapports des Phéniciens et des Grecs remontent
|x premiers âges : ceux-ci leur avaient emprunté la
nnaissance de la langue des signes écrits, et de
(aintes autres inventions fécondes, et il ne faut pas
donner que l’idée que les Grecs, les premiers, mi-
BULLETINS DE L'ART POUR TOUS. — N- 40.



