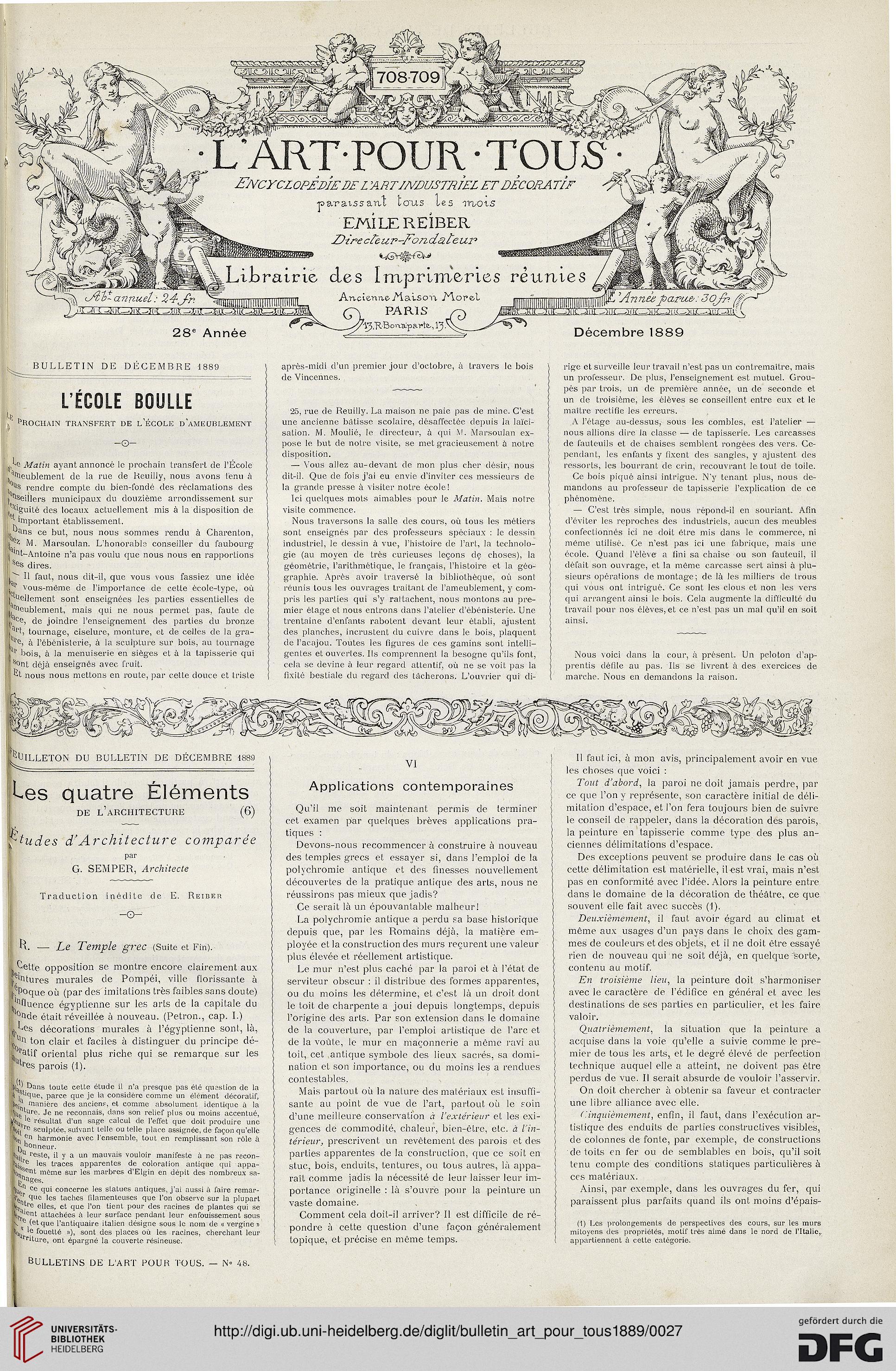L'ARTPOUR TOUS
Encyclopédie df z art industriel et décora tIe
arat-ssant to'us les mot s
EMILE REIBER
Z)îre de ur-Eon date ur
Lib rairie des Imprimeries réunie
Arvciena&Zlavsorv YVovCL
PARIS
^.RBoivaiparte., ljj '
inïirsaiASii
Décembre 1889
tes Joarue: 3Ojh N
h
‘
L’ÉCOLE BOULLE
Prochain transfert de l’école d’ameublement
-O-
Matin ayant annoncé le prochain transfert de l’École
,''Kieublemenl de la rue de Keuilly, nous avons tenu à
As rendre compte du bien-fondé des réclamations des
i| Aeillers municipaux du douzième arrondissement sur
guilé des locaux actuellement mis à la disposition de
important établissement
L -hins ce but, nous nous sommes rendu à Charenton,
A2 M. Marsoulan. L’honorable conseiller du faubourg
j 'àt-Antoine n’a pas voulu que nous nous en rapportions
j dires.
■A P faut, nous dit-il, que vous vous fassiez une idée
A vous-même de l’importance de cette école-type, où
/^tellement sont enseignées les parties essentielles de
ameublement, mais qui ne nous permet pas, faute de
L^e, de joindre l’enseignement des parties du bronze
A, tournage, ciselure, monture, et de celles de la gra-
e, à l’ébénislerie, à la sculpture sur bois, au tournage
A
l||> bois, à la menuiserie en sièges et à la tapisserie qui
s°nt déjà enseignés avec fruit.
lt nous nous mettons en route, par cette douce et triste
après-midi d’un premier jour d’octobre, à travers le bois
de Vincenncs.
25, rue de Reuilly. La maison ne paie pas de mine. C’est
une ancienne bâtisse scolaire, désaffectée depuis la laïci-
sation. M. Moulié, le directeur, à qui M. Marsoulan ex-
pose le but de notre visite, se met gracieusement à notre
disposition.
— Vous allez au-devant de mon plus cher désir, nous
dit-il. Que de fois j’ai eu envie d’inviter ces messieurs de
la grande presse à visiter notre école!
Ici quelques mots aimables pour le Matin. Mais notre
visite commence.
Nous traversons la salle des cours, où tous les métiers
sont enseignés par des professeurs spéciaux : le dessin
industriel, le dessin à vue, l’histoire de l’art, la technolo-
gie (au moyen de très curieuses leçons de choses), la
géométrie, l’arithmétique, le français, l’histoire et la géo-
graphie. Après avoir traversé la bibliothèque, où sont
réunis tous les ouvrages traitant de l’ameublement, y com-
pris les parties qui s’y rattachent, nous montons au pre-
mier étage et nous entrons dans l’atelier d’ébénisterie. Une
trentaine d’enfants rabotent devant leur établi, ajustent
des planches, incrustent du cuivre dans le bois, plaquent
de l’acajou. Toutes les figures de ces gamins sont intelli-
gentes et ouvertes. Ils comprennent la besogne qu’ils font,
cela se devine à leur regard attentif, où ne se voit pas la
fixité bestiale du regard des tâcherons. L’ouvrier qui di-
rige et surveille leur travail n’est pas un contremaître, mais
un professeur. De plus, l’enseignement est mutuel. Grou-
pés par trois, un de première année, un de seconde et
un de troisième, les élèves se conseillent entre eux et le
maître rectifie les erreurs.
A l’étage au-dessus, sous les combles, est l’atelier —
nous allions dire la classe — de tapisserie. Les carcasses
de fauteuils et de chaises semblent rongées des vers. Ce-
pendant, les enfants y fixent des sangles, y ajustent des
ressorts, les bourrant de crin, recouvrant le tout de toile.
Ce bois piqué ainsi intrigue. N'y tenant plus, nous de-
mandons au professeur de tapisserie l’explication de ce
phénomène.
— C’est très simple, nous répond-il en souriant. Afin
d’éviter les reproches des industriels, aucun des meubles
confectionnés ici ne doit être mis dans le commerce, ni
même utilisé. Ce n’est pas ici une fabrique, mais une
école. Quand l’élève a fini sa chaise ou son fauteuil, il
défait son ouvrage, et la même carcasse sert ainsi à plu-
sieurs opérations démontage; de là les milliers de trous
qui vous ont intrigué. Ce sont les clous et non les vers
qui arrangent ainsi le bois. Cela augmente la difficulté du
travail pour nos élèves, et ce n’est pas un mal qu’il en soit
ainsi.
Nous voici dans la cour, à présent. Un peloton d’ap-
prentis défile au pas. Ils se livrent à des exercices de
marche. Nous en demandons la raison.
[Œilleton du bulletin de décembre issu
Les quatre Éléments
de l’architecture (6)
tudes d’Architecture comparée
}■
par
G. SEMPER, Architecte
Traduction inédite de E. Reibeiî
-o-
H. _ Le Temple grec (Suite et Fin).
Éette opposition se montre encore clairement aux
■Futures murales de Pompéi, ville florissante à
phoque où (par des imitations très faibles sans doute)
Influence égyptienne sur les arts de la capitale du
°Rde était réveillée à nouveau. (Petron., cap. I.)
décorations murales à l’égyplienne sont, là,
|l|h ton clair et faciles à distinguer du principe dé-
j/Altif oriental plus riche qui se remarque sur les
A’es parois (1).
îfiLDanB oute celle étude il n’a presque pas été question de la
k |S^que, parce que je la considère comme un élément décoratif,
IfU1 manière des anciens, et comme absolument identique à la
I^Lire. Je ne reconnais, dans son relief plus ou moins accentué,
e résultat d’un sage calcul de l’effet que doit produire une
sculptée, suivant telle ou telle place assignée, de façon qu’elle
pw harmonie avec l’ensemble, tout en remplissant son rôle à
! ^honneur.
reste, il y a un mauvais vouloir manifeste à ne pas recon-
bj re les traces apparentes de coloration antique qui appa-
nt it ‘ ■
tîT^ges.
LSerit même sur les marbres d’Elgin en dépit des nombreux sa-
| j^ges.
Wn Ce qui concerne les statues antiques, j’ai aussi à faire remar-
m,, — -J *. VVIlVVillV ■ ' ' ... ..--- -- ~ ^ . J l Cl»-*U.JJ. Cl mil L, 1 V. Il ici l
IV r que les taches filamenteuses que l’on observe sur la plupart
e^es» que l’on tient pour des racines de plantes qui se
ient attachées à leur surface pendant leur enfouissement sous
. e (et que l’antiquaire italien désigne sous le nom de « vergine »
le fouetté »), sont des places où les racines, cherchant leur
friture, ont épargné la couverte résineuse.
Applications contemporaines
Qu’il me soit maintenant permis de terminer
cet examen par quelques brèves applications pra-
tiques :
Devons-nous recommencer à construire à nouveau
des temples grecs et essayer si, dans l’emploi de la
polychromie antique et des finesses nouvellement
découvertes de la pratique antique des arts, nous ne
réussirons pas mieux que jadis?
Ce serait là un épouvantable malheur!
La polychromie antique a perdu sa base historique
depuis que, par les Romains déjà, la matière em-
ployée et la construction des murs reçurent une valeur
plus élevée et réellement artistique.
Le mur n’est plus caché par la paroi et à l’état de
serviteur obscur : il distribue des formes apparentes,
ou du moins les détermine, et c’est là un droit dont
le toit de charpente a joui depuis longtemps, depuis
l’origine des arts, l’ar son extension dans le domaine
de la couverture, par l’emploi artistique de l’arc et
de la voûte, le mur en maçonnerie a même ravi au
toit, cet antique symbole des lieux sacrés, sa domi-
nation et son importance, ou du moins les a rendues
contestables.
Mais partout où la nature des matériaux est insuffi-
sante au point de vue de l’art, partout où le soin
d’une meilleure conservation à l’extérieur et les exi-
gences de commodité, chaleur, bien-être, etc. à l'in-
térieur, prescrivent un revêtement des parois et des
parties apparentes de ia construction, que ce soit en
stuc, bois, enduits, tentures, ou tous autres, là appa-
raît comme jadis la nécessité de leur laisser leur im-
portance originelle : là s’ouvre pour la peinture un
vaste domaine.
Comment cela doit-il arriver? Il est difficile de ré-
pondre à cette question d’une façon généralement
topique, et précise en même temps.
Il faut ici, à mon avis, principalement avoir en vue
les choses que voici :
Tout d’abord, la paroi ne doit jamais perdre, par
ce que l’on y représente, son caractère initial de déli-
mitation d’espace, et l’on fera toujours bien de suivre
le conseil de rappeler, dans la décoration des parois,
la peinture en tapisserie comme type des plus an-
ciennes délimitations d’espace.
Des exceptions peuvent se produire dans le cas où
cette délimitation est matérielle, il-est vrai, mais n’est
pas en conformité avec l’idée. Alors la peinture entre
dans le domaine de la décoration de théâtre, ce que
souvent elle fait avec succès (1).
Deuxièmement, il faut avoir égard au climat et
même aux usages d’un pays dans le choix des gam-
mes de couleurs et des objets, et il ne doit être essayé
rien de nouveau qui ne soit déjà, en quelque sorte,
contenu au motif.
En troisième lieu, la peinture doit s’harmoniser
avec le caractère de l’édifice en général et avec les
destinations de ses parties en particulier, et les faire
valoir.
Quatrièmement, la situation que la peinture a
acquise dans la voie qu’elle a suivie comme le pre-
mier de tous les arts, et le degré élevé de perfection
technique auquel elle a atteint, ne doivent pas être
perdus de vue. Il serait absurde de vouloir l’asservir.
On doit chercher à obtenir sa faveur et contracter
une libre alliance avec elle.
Cinquièmement, enfin, il faut, dans l’exécution ar-
tistique des enduits de parties constructives visibles,
de colonnes de fonte, par exemple, de constructions
de toits en fer ou de semblables en bois, qu’il soit
tenu compte des conditions statiques particulières à
ces matériaux.
Ainsi, par exemple, dans les ouvrages du fer, qui
paraissent plus parfaits quand ils ont moins d’épais-
(1) Les prolongements de perspectives des cours, sur les murs
mitoyens des propriétés, motif très aimé dans le nord de l’Ualic,.
appartiennent à cette catégorie.
Bulletins de l’art pour tous. — n° 48.
Encyclopédie df z art industriel et décora tIe
arat-ssant to'us les mot s
EMILE REIBER
Z)îre de ur-Eon date ur
Lib rairie des Imprimeries réunie
Arvciena&Zlavsorv YVovCL
PARIS
^.RBoivaiparte., ljj '
inïirsaiASii
Décembre 1889
tes Joarue: 3Ojh N
h
‘
L’ÉCOLE BOULLE
Prochain transfert de l’école d’ameublement
-O-
Matin ayant annoncé le prochain transfert de l’École
,''Kieublemenl de la rue de Keuilly, nous avons tenu à
As rendre compte du bien-fondé des réclamations des
i| Aeillers municipaux du douzième arrondissement sur
guilé des locaux actuellement mis à la disposition de
important établissement
L -hins ce but, nous nous sommes rendu à Charenton,
A2 M. Marsoulan. L’honorable conseiller du faubourg
j 'àt-Antoine n’a pas voulu que nous nous en rapportions
j dires.
■A P faut, nous dit-il, que vous vous fassiez une idée
A vous-même de l’importance de cette école-type, où
/^tellement sont enseignées les parties essentielles de
ameublement, mais qui ne nous permet pas, faute de
L^e, de joindre l’enseignement des parties du bronze
A, tournage, ciselure, monture, et de celles de la gra-
e, à l’ébénislerie, à la sculpture sur bois, au tournage
A
l||> bois, à la menuiserie en sièges et à la tapisserie qui
s°nt déjà enseignés avec fruit.
lt nous nous mettons en route, par cette douce et triste
après-midi d’un premier jour d’octobre, à travers le bois
de Vincenncs.
25, rue de Reuilly. La maison ne paie pas de mine. C’est
une ancienne bâtisse scolaire, désaffectée depuis la laïci-
sation. M. Moulié, le directeur, à qui M. Marsoulan ex-
pose le but de notre visite, se met gracieusement à notre
disposition.
— Vous allez au-devant de mon plus cher désir, nous
dit-il. Que de fois j’ai eu envie d’inviter ces messieurs de
la grande presse à visiter notre école!
Ici quelques mots aimables pour le Matin. Mais notre
visite commence.
Nous traversons la salle des cours, où tous les métiers
sont enseignés par des professeurs spéciaux : le dessin
industriel, le dessin à vue, l’histoire de l’art, la technolo-
gie (au moyen de très curieuses leçons de choses), la
géométrie, l’arithmétique, le français, l’histoire et la géo-
graphie. Après avoir traversé la bibliothèque, où sont
réunis tous les ouvrages traitant de l’ameublement, y com-
pris les parties qui s’y rattachent, nous montons au pre-
mier étage et nous entrons dans l’atelier d’ébénisterie. Une
trentaine d’enfants rabotent devant leur établi, ajustent
des planches, incrustent du cuivre dans le bois, plaquent
de l’acajou. Toutes les figures de ces gamins sont intelli-
gentes et ouvertes. Ils comprennent la besogne qu’ils font,
cela se devine à leur regard attentif, où ne se voit pas la
fixité bestiale du regard des tâcherons. L’ouvrier qui di-
rige et surveille leur travail n’est pas un contremaître, mais
un professeur. De plus, l’enseignement est mutuel. Grou-
pés par trois, un de première année, un de seconde et
un de troisième, les élèves se conseillent entre eux et le
maître rectifie les erreurs.
A l’étage au-dessus, sous les combles, est l’atelier —
nous allions dire la classe — de tapisserie. Les carcasses
de fauteuils et de chaises semblent rongées des vers. Ce-
pendant, les enfants y fixent des sangles, y ajustent des
ressorts, les bourrant de crin, recouvrant le tout de toile.
Ce bois piqué ainsi intrigue. N'y tenant plus, nous de-
mandons au professeur de tapisserie l’explication de ce
phénomène.
— C’est très simple, nous répond-il en souriant. Afin
d’éviter les reproches des industriels, aucun des meubles
confectionnés ici ne doit être mis dans le commerce, ni
même utilisé. Ce n’est pas ici une fabrique, mais une
école. Quand l’élève a fini sa chaise ou son fauteuil, il
défait son ouvrage, et la même carcasse sert ainsi à plu-
sieurs opérations démontage; de là les milliers de trous
qui vous ont intrigué. Ce sont les clous et non les vers
qui arrangent ainsi le bois. Cela augmente la difficulté du
travail pour nos élèves, et ce n’est pas un mal qu’il en soit
ainsi.
Nous voici dans la cour, à présent. Un peloton d’ap-
prentis défile au pas. Ils se livrent à des exercices de
marche. Nous en demandons la raison.
[Œilleton du bulletin de décembre issu
Les quatre Éléments
de l’architecture (6)
tudes d’Architecture comparée
}■
par
G. SEMPER, Architecte
Traduction inédite de E. Reibeiî
-o-
H. _ Le Temple grec (Suite et Fin).
Éette opposition se montre encore clairement aux
■Futures murales de Pompéi, ville florissante à
phoque où (par des imitations très faibles sans doute)
Influence égyptienne sur les arts de la capitale du
°Rde était réveillée à nouveau. (Petron., cap. I.)
décorations murales à l’égyplienne sont, là,
|l|h ton clair et faciles à distinguer du principe dé-
j/Altif oriental plus riche qui se remarque sur les
A’es parois (1).
îfiLDanB oute celle étude il n’a presque pas été question de la
k |S^que, parce que je la considère comme un élément décoratif,
IfU1 manière des anciens, et comme absolument identique à la
I^Lire. Je ne reconnais, dans son relief plus ou moins accentué,
e résultat d’un sage calcul de l’effet que doit produire une
sculptée, suivant telle ou telle place assignée, de façon qu’elle
pw harmonie avec l’ensemble, tout en remplissant son rôle à
! ^honneur.
reste, il y a un mauvais vouloir manifeste à ne pas recon-
bj re les traces apparentes de coloration antique qui appa-
nt it ‘ ■
tîT^ges.
LSerit même sur les marbres d’Elgin en dépit des nombreux sa-
| j^ges.
Wn Ce qui concerne les statues antiques, j’ai aussi à faire remar-
m,, — -J *. VVIlVVillV ■ ' ' ... ..--- -- ~ ^ . J l Cl»-*U.JJ. Cl mil L, 1 V. Il ici l
IV r que les taches filamenteuses que l’on observe sur la plupart
e^es» que l’on tient pour des racines de plantes qui se
ient attachées à leur surface pendant leur enfouissement sous
. e (et que l’antiquaire italien désigne sous le nom de « vergine »
le fouetté »), sont des places où les racines, cherchant leur
friture, ont épargné la couverte résineuse.
Applications contemporaines
Qu’il me soit maintenant permis de terminer
cet examen par quelques brèves applications pra-
tiques :
Devons-nous recommencer à construire à nouveau
des temples grecs et essayer si, dans l’emploi de la
polychromie antique et des finesses nouvellement
découvertes de la pratique antique des arts, nous ne
réussirons pas mieux que jadis?
Ce serait là un épouvantable malheur!
La polychromie antique a perdu sa base historique
depuis que, par les Romains déjà, la matière em-
ployée et la construction des murs reçurent une valeur
plus élevée et réellement artistique.
Le mur n’est plus caché par la paroi et à l’état de
serviteur obscur : il distribue des formes apparentes,
ou du moins les détermine, et c’est là un droit dont
le toit de charpente a joui depuis longtemps, depuis
l’origine des arts, l’ar son extension dans le domaine
de la couverture, par l’emploi artistique de l’arc et
de la voûte, le mur en maçonnerie a même ravi au
toit, cet antique symbole des lieux sacrés, sa domi-
nation et son importance, ou du moins les a rendues
contestables.
Mais partout où la nature des matériaux est insuffi-
sante au point de vue de l’art, partout où le soin
d’une meilleure conservation à l’extérieur et les exi-
gences de commodité, chaleur, bien-être, etc. à l'in-
térieur, prescrivent un revêtement des parois et des
parties apparentes de ia construction, que ce soit en
stuc, bois, enduits, tentures, ou tous autres, là appa-
raît comme jadis la nécessité de leur laisser leur im-
portance originelle : là s’ouvre pour la peinture un
vaste domaine.
Comment cela doit-il arriver? Il est difficile de ré-
pondre à cette question d’une façon généralement
topique, et précise en même temps.
Il faut ici, à mon avis, principalement avoir en vue
les choses que voici :
Tout d’abord, la paroi ne doit jamais perdre, par
ce que l’on y représente, son caractère initial de déli-
mitation d’espace, et l’on fera toujours bien de suivre
le conseil de rappeler, dans la décoration des parois,
la peinture en tapisserie comme type des plus an-
ciennes délimitations d’espace.
Des exceptions peuvent se produire dans le cas où
cette délimitation est matérielle, il-est vrai, mais n’est
pas en conformité avec l’idée. Alors la peinture entre
dans le domaine de la décoration de théâtre, ce que
souvent elle fait avec succès (1).
Deuxièmement, il faut avoir égard au climat et
même aux usages d’un pays dans le choix des gam-
mes de couleurs et des objets, et il ne doit être essayé
rien de nouveau qui ne soit déjà, en quelque sorte,
contenu au motif.
En troisième lieu, la peinture doit s’harmoniser
avec le caractère de l’édifice en général et avec les
destinations de ses parties en particulier, et les faire
valoir.
Quatrièmement, la situation que la peinture a
acquise dans la voie qu’elle a suivie comme le pre-
mier de tous les arts, et le degré élevé de perfection
technique auquel elle a atteint, ne doivent pas être
perdus de vue. Il serait absurde de vouloir l’asservir.
On doit chercher à obtenir sa faveur et contracter
une libre alliance avec elle.
Cinquièmement, enfin, il faut, dans l’exécution ar-
tistique des enduits de parties constructives visibles,
de colonnes de fonte, par exemple, de constructions
de toits en fer ou de semblables en bois, qu’il soit
tenu compte des conditions statiques particulières à
ces matériaux.
Ainsi, par exemple, dans les ouvrages du fer, qui
paraissent plus parfaits quand ils ont moins d’épais-
(1) Les prolongements de perspectives des cours, sur les murs
mitoyens des propriétés, motif très aimé dans le nord de l’Ualic,.
appartiennent à cette catégorie.
Bulletins de l’art pour tous. — n° 48.