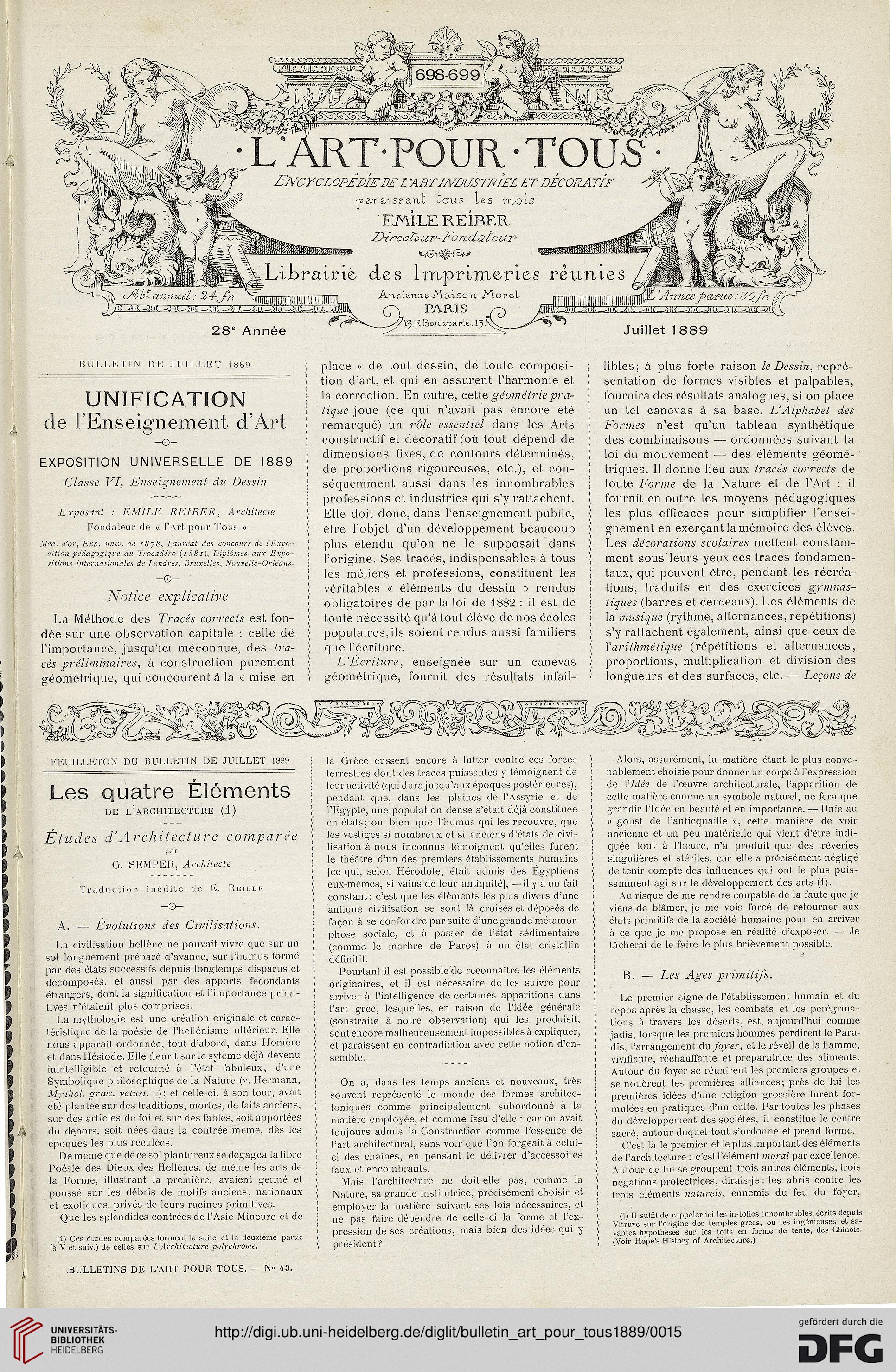cfil -annuel: 24
,Æjl -TiC-M-HU. _^M ^TTTrxuSl
L'ART-POUR-TOUS
ENCYCLOPEDIE DF L’ARTINDUSTRIEL ET DECORA T/F
aratssant to'us les m-ots
EMILE REiBER
IL ire etc ur-Eon da te ur
LiL raine des Imprimeries réunie
28e Année
ArvcienaejHaisou TAore/l
(P PARIS
'Ç.TlBoivaparte,
Juillet 1 889
BULLETIN DE JUILLET 1889
UNIFICATION
de l’Enseignement d’AiT
-o-
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Classe VI, Enseignement du Dessin
Exposant : ÉMILE REIBER, Architecte
Fondateur de « l’Art pour Tous »
Méd. d'or, Exp. univ. de 1878, Lauréat des concours de l'Expo-
sition pédagogique du Trocadéro (1881), Diplômes aux Expo-
sitions internationales de Londres, Bruxelles, Nouvelle-Orléans.
-o-
Notice explicative
La Méthode des Tracés corrects est fon-
dée sur une observation capitale : celle de
l’importance, jusqu’ici méconnue, des tra-
cés préliminaires, à construction purement
géométrique, qui concourent à la « mise en
place » de tout dessin, de toute composi-
tion d’art, et qui en assurent l’harmonie et
la correction. En outre, celle géométriepra-
j tique joue (ce qui n’avait pas encore été
; remarqué) un rôle essentiel dans les Arts
; constructif et décoratif (où tout dépend de
: dimensions fixes, de contours déterminés,
de proportions rigoureuses, etc.), et con-
ï séquemment aussi dans les innombrables
professions et industries qui s’y rattachent.
] Elle doit donc, dans l’enseignement public,
être l’objet d’un développement beaucoup
i plus étendu qu’on ne le supposait dans
1 l’origine. Ses tracés, indispensables à tous
! les métiers et professions, constituent les
! véritables « éléments du dessin » rendus
j obligatoires de par la loi de 1882 : il est de
| toute nécessité qu’à tout élève de nos écoles
! populaires,ils soient rendus aussi familiers
que l’écriture.
L’Ecriture, enseignée sur un canevas
, géométrique, fournit des résultats infail-
libles; à plus forte raison le Dessin, repré-
sentation de formes visibles et palpables,
fournira des résultats analogues, si on place
J un tel canevas à sa base. L’Alphabet des
\ Formes n’est qu’un tableau synthétique
j des combinaisons —■ ordonnées suivant la
loi du mouvement —- des éléments géomé-
triques. Il donne lieu aux tracés corrects de
j toute Forme de la Nature et de l’Art : il
! fournit en outre les moyens pédagogiques
i les plus efficaces pour simplifier l’ensei-
j gnement en exerçant la mémoire des élèves.
; Les décorations scolaires mettent constam-
! ment sous leurs yeux ces tracés fondamen-
j taux, qui peuvent être, pendant les récréa-
tions, traduits en des exercices gymnas-
| tiques (barres et cerceaux). Les éléments de
j la musique (rythme, alternances, répétitions)
j s’v rattachent également, ainsi que ceux de
Xarithmétique (répétitions et alternances,
j proportions, multiplication et division des
longueurs et des surfaces, etc. — Leçons de
FEUILLETON DU BULLETIN DE JUILLET 1889
Les quatre Éléments
de l’architecture (1)
Éludes d’Architecture comparée \
par
G. SEMPER, Architecte
Traduction inédite de E. Ruiber
-O-
A. •— Évolutions des Civilisations.
La civilisation hellène ne pouvait vivre que sur un \
sol longuement préparé d’avance, sur l’humus formé
par des états successifs depuis longtemps disparus et j
décomposés, et aussi par des apports fécondants j
étrangers, dont la signification et l’importance prirni-
tives n’étaient plus comprises. <
La mythologie est une création originale et carac- i
léristique de la poésie de l’hellénisme ultérieur. Elle (
nous apparaît ordonnée, tout d’abord, dans Homère j
et dans Hésiode. Elle fleurit sur le sytème déjà devenu
inintelligible et retourné à l’état fabuleux, d’une
Symbolique philosophique de la Nature (v. Hermann,
Mythol. grœc. vetust. n) ; et celle-ci, à son tour, avait j
été plantée sur des traditions, mortes, de faits anciens, \
sur des articles de foi et sur des fables, soit apportées >
du dehors, soit nées dans la contrée môme, dès les j
époques les plus reculées.
De même que dece sol plantureux se dégagea la libre \
Poésie des Dieux des Hellènes, de même les arts de
la Forme, illustrant la première, avaient germé et j
poussé sur les débris de motifs anciens, nationaux J
et exotiques, privés de leurs racines primitives.
Que les splendides contrées de l’Asie Mineure et de
(1) Ces études comparées forment la suite et la deuxième partie
(§ V et suiv.) de celles sur L’Architecture polychrome. \
la Grèce eussent encore à lutter contre ces forces
terrestres dont des traces puissantes y témoignent de
leur activité (qui dura jusqu’aux époques postérieures),
pendant que, dans les plaines de l’Assyrie et de
l’Egypte, une population dense s’était déjà constituée
en états; ou bien que l’humus qui les recouvre, que
les vestiges si nombreux et si anciens d’états de civi-
lisation à nous inconnus témoignent qu’elles furent
le théâtre d’un des premiers établissements humains
[ce qui, selon Hérodote, était admis des Égyptiens
eux-mêmes, si vains de leur antiquité], —il y a un fait
constant: c’est que les éléments les plus divers d’une
antique civilisation se sont là croisés et déposés de
façon à se confondre par suite d’une grande métamor-
phose sociale, et à passer de l’état sédimentaire
(comme le marbre de Paros) à un état cristallin
définitif.
Pourtant il est possible'de reconnaître les éléments
originaires, et il est nécessaire de les suivre pour
arriver à l’intelligence de certaines apparitions dans
l’art grec, lesquelles, en raison de l’idée générale
(soustraite à notre observation) qui les produisit,
sont encore malheureusement impossibles à expliquer,
et paraissent en contradiction avec cette notion d’en-
semble.
On a, dans les temps anciens et nouveaux, très
souvent représenté le monde des formes architec-
toniques comme principalement subordonné à la
matière employée, et comme issu d’elle : car on avait
toujours admis la Construction comme l'essence de
l’art architectural, sans voir que l’on forgeait à celui-
ci des chaînes, en pensant le délivrer d’accessoires
faux et encombrants.
Mais l’architecture ne doit-elle pas, comme la
Nature, sa grande institutrice, précisément choisir et
employer la matière suivant ses lois nécessaires, et
ne pas faire dépendre de celle-ci la forme et l’ex-
pression de ses créations, mais bien des idées qui y
président?
Alors, assurément, la matière étant le plus conve-
nablement choisie pour donner un corps à l’expression
de l’Idée de l’oeuvre architecturale, l’apparition de
cette matière comme un symbole naturel, ne fera que
grandir l’Idée en beauté et en importance. — Unie au
« goust de l’anticquaille », cette manière de voir
ancienne et un peu matérielle qui vient d’être indi-
quée tout à l’heure, n’a produit que des rêveries
singulières et stériles, car elle a précisément négligé
de tenir compte des influences qui ont le plus puis-
samment agi sur le développement des arts (1).
Au risque de me rendre coupable de la faute que je
viens de blâmer, je me vois forcé de retourner aux
états primitifs de la société humaine pour en arriver
à ce que je me propose en réalité d’exposer. — Je
tâcherai de le faire le plus brièvement possible.
B. — Les Ages primitifs.
Le premier signe de l’établissement humain et du
repos après la chasse, les combats et les pérégrina-
tions à travers les déserts, est, aujourd’hui comme
jadis, lorsque les premiers hommes perdirent le Para-
dis, l’arrangement du foyer, et le réveil de la flamme,
vivifiante, réchauffante et préparatrice des aliments.
Autour du foyer se réunirent les premiers groupes et
se nouèrent les premières alliances; près de lui les
premières idées d’une religion grossière furent for-
mulées en pratiques d’un culte. Par toutes les phases
du développement des sociétés, il constitue le centre
sacré, autour duquel tout s’ordonne et prend forme.
C’est, là le premier et le plus important des éléments
de l’architecture : c’est l’élément moral par excellence.
Autour de lui se groupent trois autres éléments, trois
négations protectrices, dirais-je : les abris contre les
trois éléments naturels, ennemis du feu du foyer,
(1) Il suffit de rappeler ici les in-folios innombrables, écrits depuis
Vitruve sur l’origine des temples grecs, ou les ingénieuses et sa-
vantes hypothèses sur les toits en forme de tente, des Chinois.
(Voir Hope’s History of Architecture.)
BULLETINS DE L’ART POUR TOUS. — N° 43.
,Æjl -TiC-M-HU. _^M ^TTTrxuSl
L'ART-POUR-TOUS
ENCYCLOPEDIE DF L’ARTINDUSTRIEL ET DECORA T/F
aratssant to'us les m-ots
EMILE REiBER
IL ire etc ur-Eon da te ur
LiL raine des Imprimeries réunie
28e Année
ArvcienaejHaisou TAore/l
(P PARIS
'Ç.TlBoivaparte,
Juillet 1 889
BULLETIN DE JUILLET 1889
UNIFICATION
de l’Enseignement d’AiT
-o-
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Classe VI, Enseignement du Dessin
Exposant : ÉMILE REIBER, Architecte
Fondateur de « l’Art pour Tous »
Méd. d'or, Exp. univ. de 1878, Lauréat des concours de l'Expo-
sition pédagogique du Trocadéro (1881), Diplômes aux Expo-
sitions internationales de Londres, Bruxelles, Nouvelle-Orléans.
-o-
Notice explicative
La Méthode des Tracés corrects est fon-
dée sur une observation capitale : celle de
l’importance, jusqu’ici méconnue, des tra-
cés préliminaires, à construction purement
géométrique, qui concourent à la « mise en
place » de tout dessin, de toute composi-
tion d’art, et qui en assurent l’harmonie et
la correction. En outre, celle géométriepra-
j tique joue (ce qui n’avait pas encore été
; remarqué) un rôle essentiel dans les Arts
; constructif et décoratif (où tout dépend de
: dimensions fixes, de contours déterminés,
de proportions rigoureuses, etc.), et con-
ï séquemment aussi dans les innombrables
professions et industries qui s’y rattachent.
] Elle doit donc, dans l’enseignement public,
être l’objet d’un développement beaucoup
i plus étendu qu’on ne le supposait dans
1 l’origine. Ses tracés, indispensables à tous
! les métiers et professions, constituent les
! véritables « éléments du dessin » rendus
j obligatoires de par la loi de 1882 : il est de
| toute nécessité qu’à tout élève de nos écoles
! populaires,ils soient rendus aussi familiers
que l’écriture.
L’Ecriture, enseignée sur un canevas
, géométrique, fournit des résultats infail-
libles; à plus forte raison le Dessin, repré-
sentation de formes visibles et palpables,
fournira des résultats analogues, si on place
J un tel canevas à sa base. L’Alphabet des
\ Formes n’est qu’un tableau synthétique
j des combinaisons —■ ordonnées suivant la
loi du mouvement —- des éléments géomé-
triques. Il donne lieu aux tracés corrects de
j toute Forme de la Nature et de l’Art : il
! fournit en outre les moyens pédagogiques
i les plus efficaces pour simplifier l’ensei-
j gnement en exerçant la mémoire des élèves.
; Les décorations scolaires mettent constam-
! ment sous leurs yeux ces tracés fondamen-
j taux, qui peuvent être, pendant les récréa-
tions, traduits en des exercices gymnas-
| tiques (barres et cerceaux). Les éléments de
j la musique (rythme, alternances, répétitions)
j s’v rattachent également, ainsi que ceux de
Xarithmétique (répétitions et alternances,
j proportions, multiplication et division des
longueurs et des surfaces, etc. — Leçons de
FEUILLETON DU BULLETIN DE JUILLET 1889
Les quatre Éléments
de l’architecture (1)
Éludes d’Architecture comparée \
par
G. SEMPER, Architecte
Traduction inédite de E. Ruiber
-O-
A. •— Évolutions des Civilisations.
La civilisation hellène ne pouvait vivre que sur un \
sol longuement préparé d’avance, sur l’humus formé
par des états successifs depuis longtemps disparus et j
décomposés, et aussi par des apports fécondants j
étrangers, dont la signification et l’importance prirni-
tives n’étaient plus comprises. <
La mythologie est une création originale et carac- i
léristique de la poésie de l’hellénisme ultérieur. Elle (
nous apparaît ordonnée, tout d’abord, dans Homère j
et dans Hésiode. Elle fleurit sur le sytème déjà devenu
inintelligible et retourné à l’état fabuleux, d’une
Symbolique philosophique de la Nature (v. Hermann,
Mythol. grœc. vetust. n) ; et celle-ci, à son tour, avait j
été plantée sur des traditions, mortes, de faits anciens, \
sur des articles de foi et sur des fables, soit apportées >
du dehors, soit nées dans la contrée môme, dès les j
époques les plus reculées.
De même que dece sol plantureux se dégagea la libre \
Poésie des Dieux des Hellènes, de même les arts de
la Forme, illustrant la première, avaient germé et j
poussé sur les débris de motifs anciens, nationaux J
et exotiques, privés de leurs racines primitives.
Que les splendides contrées de l’Asie Mineure et de
(1) Ces études comparées forment la suite et la deuxième partie
(§ V et suiv.) de celles sur L’Architecture polychrome. \
la Grèce eussent encore à lutter contre ces forces
terrestres dont des traces puissantes y témoignent de
leur activité (qui dura jusqu’aux époques postérieures),
pendant que, dans les plaines de l’Assyrie et de
l’Egypte, une population dense s’était déjà constituée
en états; ou bien que l’humus qui les recouvre, que
les vestiges si nombreux et si anciens d’états de civi-
lisation à nous inconnus témoignent qu’elles furent
le théâtre d’un des premiers établissements humains
[ce qui, selon Hérodote, était admis des Égyptiens
eux-mêmes, si vains de leur antiquité], —il y a un fait
constant: c’est que les éléments les plus divers d’une
antique civilisation se sont là croisés et déposés de
façon à se confondre par suite d’une grande métamor-
phose sociale, et à passer de l’état sédimentaire
(comme le marbre de Paros) à un état cristallin
définitif.
Pourtant il est possible'de reconnaître les éléments
originaires, et il est nécessaire de les suivre pour
arriver à l’intelligence de certaines apparitions dans
l’art grec, lesquelles, en raison de l’idée générale
(soustraite à notre observation) qui les produisit,
sont encore malheureusement impossibles à expliquer,
et paraissent en contradiction avec cette notion d’en-
semble.
On a, dans les temps anciens et nouveaux, très
souvent représenté le monde des formes architec-
toniques comme principalement subordonné à la
matière employée, et comme issu d’elle : car on avait
toujours admis la Construction comme l'essence de
l’art architectural, sans voir que l’on forgeait à celui-
ci des chaînes, en pensant le délivrer d’accessoires
faux et encombrants.
Mais l’architecture ne doit-elle pas, comme la
Nature, sa grande institutrice, précisément choisir et
employer la matière suivant ses lois nécessaires, et
ne pas faire dépendre de celle-ci la forme et l’ex-
pression de ses créations, mais bien des idées qui y
président?
Alors, assurément, la matière étant le plus conve-
nablement choisie pour donner un corps à l’expression
de l’Idée de l’oeuvre architecturale, l’apparition de
cette matière comme un symbole naturel, ne fera que
grandir l’Idée en beauté et en importance. — Unie au
« goust de l’anticquaille », cette manière de voir
ancienne et un peu matérielle qui vient d’être indi-
quée tout à l’heure, n’a produit que des rêveries
singulières et stériles, car elle a précisément négligé
de tenir compte des influences qui ont le plus puis-
samment agi sur le développement des arts (1).
Au risque de me rendre coupable de la faute que je
viens de blâmer, je me vois forcé de retourner aux
états primitifs de la société humaine pour en arriver
à ce que je me propose en réalité d’exposer. — Je
tâcherai de le faire le plus brièvement possible.
B. — Les Ages primitifs.
Le premier signe de l’établissement humain et du
repos après la chasse, les combats et les pérégrina-
tions à travers les déserts, est, aujourd’hui comme
jadis, lorsque les premiers hommes perdirent le Para-
dis, l’arrangement du foyer, et le réveil de la flamme,
vivifiante, réchauffante et préparatrice des aliments.
Autour du foyer se réunirent les premiers groupes et
se nouèrent les premières alliances; près de lui les
premières idées d’une religion grossière furent for-
mulées en pratiques d’un culte. Par toutes les phases
du développement des sociétés, il constitue le centre
sacré, autour duquel tout s’ordonne et prend forme.
C’est, là le premier et le plus important des éléments
de l’architecture : c’est l’élément moral par excellence.
Autour de lui se groupent trois autres éléments, trois
négations protectrices, dirais-je : les abris contre les
trois éléments naturels, ennemis du feu du foyer,
(1) Il suffit de rappeler ici les in-folios innombrables, écrits depuis
Vitruve sur l’origine des temples grecs, ou les ingénieuses et sa-
vantes hypothèses sur les toits en forme de tente, des Chinois.
(Voir Hope’s History of Architecture.)
BULLETINS DE L’ART POUR TOUS. — N° 43.