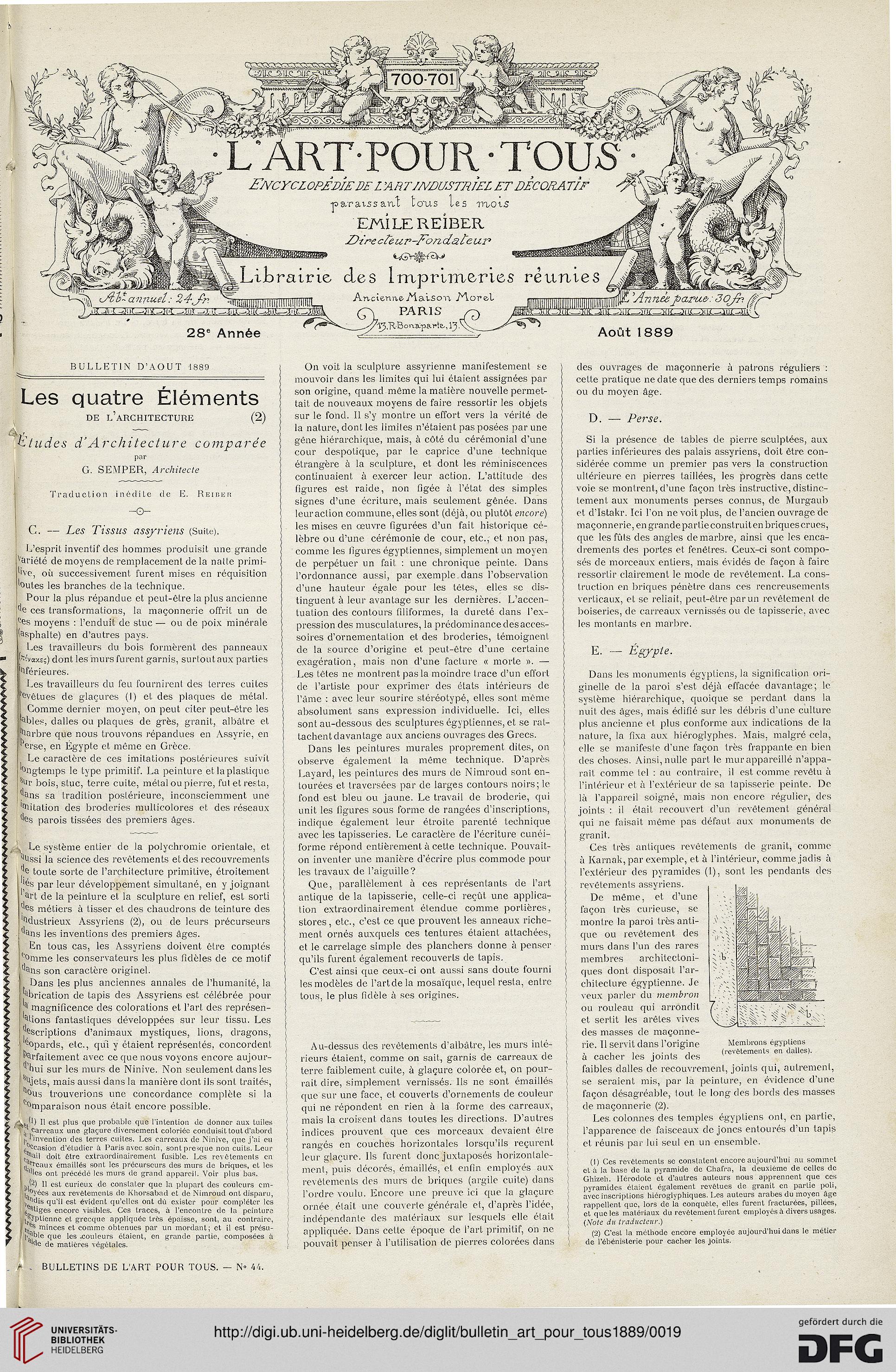4
n n rs»>
^ ^~ïlw§A ~
L ART POUR • TOUS . , .
Encyclopédie de lartindustriel et décoratif E'LX'Ln.
•jx>arat5s aixt to'us Le s itwhs
EMILE REIBER
Elire cEeur-Fon date ur
aLiL raine des Imprimeries retîntes
Arvcienae .Maison Alorel
PARIS yp,
'^.RBorva-parte., 13 XQ.
U
jix-ji i. -^ük:—htt-M
28e Année
r -.11 i.l~.i-j i ) r —-i < )i: —■•> ^ i 1
Août 1 889
BULLETIN D’AOUT 1889
Les quatre Éléments
de l’architecture (2)
L , .—
Eludes d’Architecture comparée
par
G. SESVIPER, Architecte
Traduction inédite de E. Reiiser
-O-
C. — Les Tissus assyriens (Suite).
L’esprit inventif des hommes produisit une grande
'ariété de moyens de remplacement de la natte primi-
tive, où successivement furent mises en réquisition
'Qutes les branches de la technique.
Pour la plus répandue et peut-être la plus ancienne
'le ces transformations, la maçonnerie offrit un de
j"es moyens : l’enduit de stuc — ou de poix minérale
(asphalte) en d’autres pays.
Les travailleurs du bois formèrent des panneaux
'■’ver/.c?) dont les murs furent garnis, surloutaux parties
aférieures.
Les travailleurs du feu fournirent des terres cuites
Nvêtues de glaçures (I) et des plaques de métal.
Comme dernier moyen, on peut citer peut-être les
ables, dalles ou plaques de grès, granit, albâtre et
Marbre que nous trouvons répandues en Assyrie, en
l’erse, en Égypte cl même en Grèce.
Le caractère de ces imitations postérieures suivit
longtemps le type primitif. La peinture et la plastique
sür bois, stuc, terre cuite, métal ou pierre, fut et resta,
'lans sa tradition postérieure, inconsciemment une
itation des broderies multicolores et des réseaux
'les parois tissées des premiers âges.
Le système entier de la polychromie orientale, et
Assi la science des revêtements et des recouvrements
'je toute sorte de l’architecture primitive, étroitement
j®s par leur développement simultané, en y joignant
art de la peinture et la sculpture en relief, est sorti
'les métiers à tisser et des chaudrons de teinture des
Alustrieux Assyriens (2), ou de leurs précurseurs
J'l'Uis les inventions des premiers âges,
j En tous cas, les Assyriens doivent cire comptés
' °nime les conservateurs les plus fidèles de ce mol if
fl
;uans son caractère originel.
Dans les plus anciennes annales de l’humanité, la
Imbrication de tapis des Assyriens est célébrée pour
m magnificence des colorations et l’art des représen-
tions fantastiques développées sur leur tissu. Les
Inscriptions d’animaux mystiques, lions, dragons,
'-Opards, etc., qui y étaient représentés, concordent
l'Srfaitement avec ce que nous voyons encore aujour-
d'hui sur les murs de Ninive. Non seulement dans les
^jets, mais aussi dans la manière dont ils sont traités,
Vis trouverions une concordance complète si la
Vnparaison nous était encore possible.
(1) Il est plus que probable que l’intention de donner aux tuiles
.carreaux une glaçure diversement coloriée conduisit tout d’abord
l> ‘invention des terres cuites. Les carreaux de Ninive, que j’ai eu
j ^Ccasion d’étudier à Paris avec soin, sont presque non cuits. Leur
çJJ'aU doit être extraordinairement fusible. Les revêtements en
Mreaux émaillés sont les précurseurs des murs de briques, et les
ont précédé les murs de grand appareil. Voir plus bas.
. Ja) Il est curieux do constater que la plupart des couleurs em-
t'°yées aux revêtements do Khorsabad et de Nimroud ont disparu,
("dis qu'il est évident qu’elles ont dù exister pour compléter les
^Higes encore visibles. Ces traces, à l’encontre de la peinture
^Aptienne et grecque appliquée très épaisse, sont, au contraire,
j sp minces et comme obtenues par un mordant; et il est présu-
i-.fiLt0 que les -couleurs étaient, en grande partie, composées à
'de de matières végétales.
•Bn
On voit la sculpture assyrienne manifestement se
\ mouvoir clans les limites qui lui étaient assignées par
j son origine, quand même la matière nouvelle permet-
I tait de nouveaux moyens de faire ressortir les objets
sur le fond. Il s’y montre un effort vers la vérité de
î la nature, dont les limites n’étaient pas posées par une
gêne hiérarchique, mais, à côté du cérémonial d’une
J cour despotique, par le caprice d’une technique
; étrangère à la sculpture, et dont les réminiscences
{ continuaient à exercer leur action. L’attitude des
figures est raide, non figée à l’état des simples
j signes d’une écriture, mais seulement gênée. Dans
leuraction commune, elles sont (déjà, ou plutôt encore)
les mises en œuvre figurées d’un fait historique cé-
j lèbre ou d’une cérémonie de cour, etc., cl non pas,
! comme les figures égyptiennes, simplement un moyen
de perpétuer un fail : une chronique peinte. Dans
\ l’ordonnance aussi, par exemple dans l’observation
j d'une hauteur égale pour les têtes, elles se dis-
1 tinguent à leur avantage sur les dernières. L’accen-
tuation des contours filiformes, la dureté dans l’ex-
J pression des musculatures, la prédominance desacces-
I soires d’ornementation et des broderies, témoignent
: de la source d’origine et peut-être d’une certaine
j exagération, mais non d’une facture « morte ». —
; Les têtes ne montrent pas la moindre trace d’un effort
j de l’artiste pour exprimer des états intérieurs de
'j l’âme : avec leur sourire stéréotypé, elles sont même
j absolument sans expression individuelle. Ici, elles
j sont au-dessous des sculptures égyptiennes, et se rat-
I tachent davantage aux anciens ouvrages des Grecs.
Dans les peintures murales proprement dites, on
observe également la même technique. D’après
Layard, les peintures des murs de Nimroud sont en-
tourées et traversées par de larges contours noirs; le
fond est bleu ou jaune. Le travail de broderie, qui
unit les figures sous forme de rangées d’inscriptions,
indique également leur étroite parenté technique
avec les tapisseries. Le caractère de l’écriture cunéi-
j forme répond entièrement à cette technique. Pouvait-
| on inventer une manière d’écrire plus commode pour
j les travaux de l’aiguille?
Que, parallèlement à ces représentants de l’art
‘ antique de la tapisserie, celle-ci reçût une applica-
j lion extraordinairement étendue comme portières,
j stores, etc., c’csl ce que prouvent les anneaux riche-
' ment ornés auxquels ces tentures étaient attachées,
! et le carrelage simple des planchers donne à penser
; qu’ils furent également recouverts de tapis.
C’est ainsi que ceux-ci ont aussi sans doute fourni
1 les modèles de l’artde la mosaïque, lequel resta, entre
tous, le plus fidèle à ses origines.
Au-dessus des revêtements d’albâtre, les murs inté-
rieurs étaient, comme on sait, garnis de carreaux de
terre faiblement cuile, à glaçure colorée et, on pour-
rait dire, simplement vernissés. Ils ne sont émaillés
que sur une face, et couverts d’ornements de couleur
qui ne répondent en rien à la forme des carreaux,
mais la croisent dans toutes les directions. D’autres
indices prouvent que ces morceaux devaient être
1 rangés en couches horizontales lorsqu’ils reçurent
leur glaçure. Us furent donc juxtaposés horizontale-
ment, puis décorés, émaillés, et enfin employés aux
revêtements des murs de briques (argile cuile) clans
l’ordre voulu. Encore une preuve ici que la glaçure
ornée était une couverte générale et, d’après l’idée,
indépendante des matériaux sur lesquels elle était
appliquée. Dans cette époque de l’art primitif, on ne
pouvait penser à l’utilisation de pierres colorées dans
des ouvrages de maçonnerie à patrons réguliers :
cette pratique ne date que des derniers temps romains
ou du moyen âge.
D. — Perse.
Si la présence de tables de pierre sculptées, aux
parties inférieures des palais assyriens, doit être con-
sidérée comme un premier pas vers la construction
ultérieure en pierres taillées, les progrès dans cette
voie se montrent, d’une façon très instructive, distinc-
tement aux monuments perses connus, de Murgaub
et d’Istakr. Ici l'on ne voit plus, de l’ancien ouvrage, de
maçonnerie, en grande partie construit en briques crues,
que les fuis des angles de marbre, ainsi que les enca-
drements des portes et fenêtres. Ceux-ci sont compo-
sés de morceaux entiers, niais évidés de façon à faire
ressortir clairement le mode de revêtement. La cons-
truction en briques pénètre dans ces rencreusemenls
verticaux, et se reliait, peut-être par un revêtement de
boiseries, de carreaux vernissés ou de tapisserie, avec
les monlants on marbre.
E. — Egypte.
Dans les monuments égyptiens, la signification ori-
ginelle de la paroi s’est déjà effacée davantage; le
système hiérarchique, quoique se perdant dans la
nuit des âges, mais édifié sur les débris d’une culture
plus ancienne et plus conforme aux indications de la
nature, la fixa aux hiéroglyphes. Mais, malgré cela,
elle se manifeste d’une façon très frappante en bien
des choses. Ainsi, nulle part le murappareillé n’appa-
raît comme toi : au contraire, il est comme revêtu à
l’intérieur et à l’extérieur de sa tapisserie peinte. De
là l’appareil soigné, mais non encore régulier, des
joints : il était recouvert d’un revêtement général
qui ne faisait même pas défaut aux monuments de
granit.
Ces très antiques revêtements de granit, comme
à Karnak, par exemple, et à l’intérieur, comme jadis à
l’extérieur des pyramides (1), sont les pendants des
revêtements assyriens.
De même, et d’une
façon très curieuse, se
montre la paroi très anti-
que ou revêtement des
murs clans l’un des rares
membres architectoni-
ques dont disposait l’ar-
chitecture égyptienne. Je
veux parler du membron
ou rouleau qui arrondit
et. sertit les arêtes vives
des masses de maçonne-
rie. Il servit dans l’origine
à cacher les joints des
Membrons égyptiens
(revêtements en dalles).
faibles dalles de recouvrement, joints qui, autrement,
se seraient mis, par la peinture, en évidence d’une
façon désagréable, font le long des bords des masses
de maçonnerie (2).
Les colonnes des temples égyptiens ont, en partie,
l’apparence de faisceaux de jones entourés d’un tapis
et réunis par lui seul en un ensemble.
(1) Ces revêtements se constatent encore aujourd’hui au sommet
et à ta base de la pyramide de Chafra, la deuxième de celles de
Ghizeh. Hérodote et d’autres auteurs nous apprennent que ces
pyramides étaient également revêtues de granit en partie poli,
avec inscriptions hiéroglyphiques. Les auteurs arabes du moyen âge
rappellent que, lors de la conquête, elles furent fracturées, pillées,
et que les matériaux du revêtement furent employés à divers usages.
(Note du traducteur.)
(2) C’est la méthode encore employée aujourd’hui dans le métier
de l’ébénisterie pour cacher les joints.
A BULLETINS DE L’ART POUR TOUS. — N» 44.