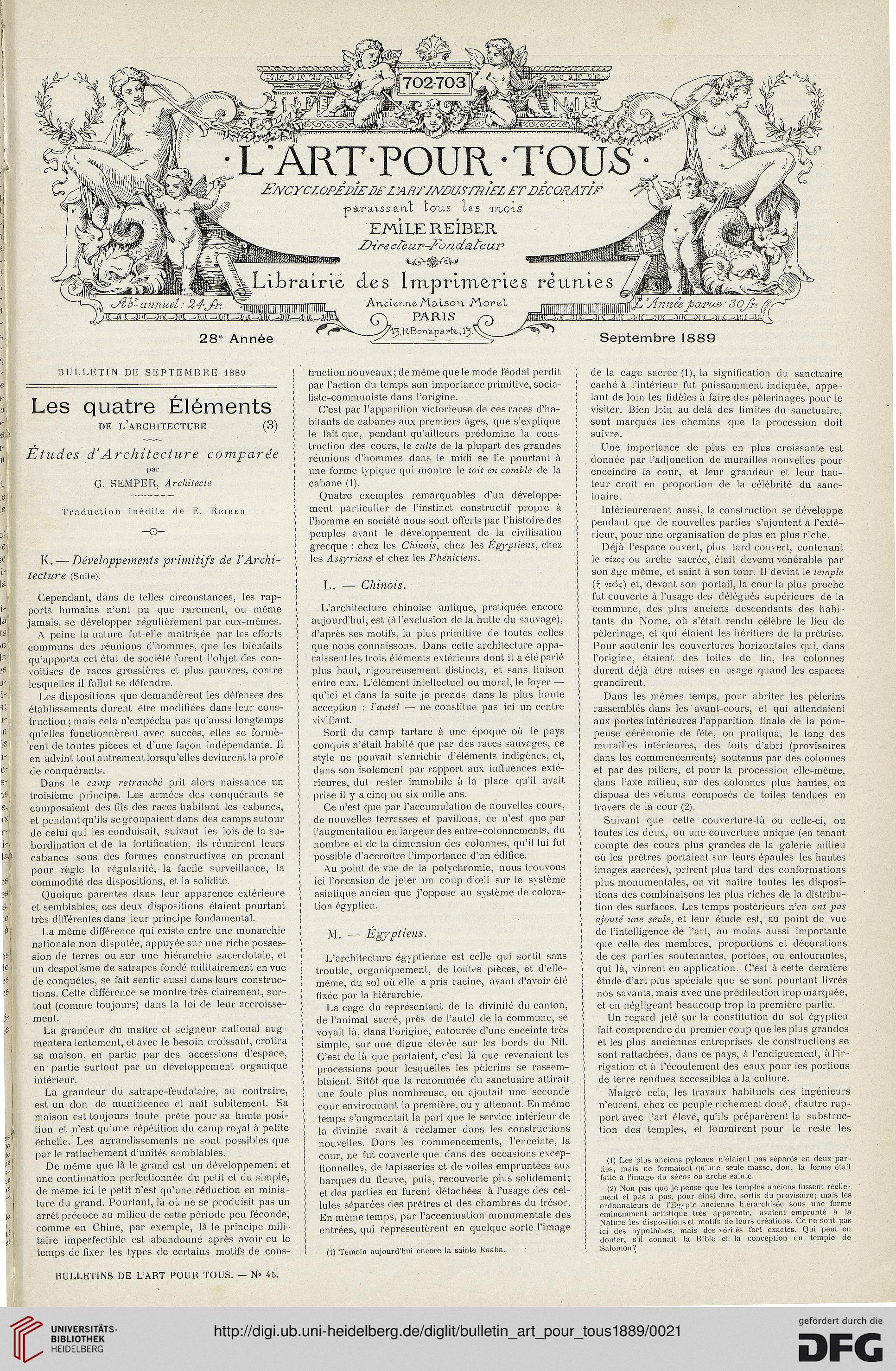ART'POUPv'l 'OU S
FNCrCL OPETÎERE L’A R T INDUSTRIEL ET DECORA T/E
t to'US l
28e Année
paraiss aru fcrus les mot s
EMILE REIBER
JDtrecteur’-Fond.a le u r
raine des Imprimeries réunie
An.cienn.e- -Mai-Scm Alore-l
PARIS jfo
'•Ç.RBoivApai’te, Xj
ji:—i-<—i.c—
Septembre 1889
BULLETIN DE SEPTEMBRE 1889
Les quatre Éléments
de l’architecture (3)
Etudes d‘Architecture comparée
par
G. SEMPER, Architecte
Traduction inédite de E. Reiber
K. — Développements primitifs de l’Archi-
tecture (Suite).
Cependant, dans de telles circonstances, les rap-
ports humains n’ont pu que rarement, ou même
jamais, se développer régulièrement par eux-mêmes.
A peine la nature lut-elle maîtrisée par les efforts
communs des réunions d’hommes, que les bienfaits
qu’apporta cet état de société furent l’objet des con-
voitises de races grossières et plus pauvres, contre
lesquelles il fallut se défendre.
Les dispositions que demandèrent les défenses des
établissements durent être modifiées dans leur cons-
truction ; mais cela n’empêcha pas qu’aussi longtemps
qu’elles fonctionnèrent avec succès, elles se formè-
rent de toutes pièces et d’une façon indépendante. 11
en advint tout autrement lorsqu’elles devinrent la proie
de conquérants.
Dans le camp retranché prit alors naissance un
troisième principe. Les armées des conquérants se
composaient des fils des races habitant les cabanes,
et pendant qu’ils se groupaient dans des camps autour
de celui qui les conduisait, suivant les lois de la su-
bordination et de la fortification, ils réunirent leurs
cabanes sous des formes constructives en prenant
pour règle la régularité, la facile surveillance, la
commodité des dispositions, et la solidité.
Quoique parentes dans leur apparence extérieure
et semblables, ces deux dispositions étaient pourtant
très différentes dans leur principe fondamental.
La même différence qui existe entre une monarchie
nationale non disputée, appuyée sur une riche posses-
sion de terres ou sur une hiérarchie sacerdotale, et
un despotisme de satrapes fondé militairement en vue
de conquêtes, se fait sentir aussi dans leurs construc-
tions. Cette différence se monlre très clairement, sur-
tout (comme toujours) dans la loi de leur accroisse-
ment.
La grandeur du maître et seigneur national aug-
mentera lentement, et avec le besoin croissant, croîtra
sa maison, en partie par des accessions d’espace,
en partie surtout par un développement organique
intérieur.
La grandeur du satrape-feudataire, au contraire,
est un don de munificence et naît subitement. Sa
maison est toujours toute prête pour sa haute posi-
tion et n’est qu’une répétition du camp royal à petite
échelle. Les agrandissements ne sont possibles que
par le rattachement d’unités semblables.
De même que là le grand est un développement et
une continuation perfectionnée du petit et du simple,
de même ici le petit n’est qu’une réduction en minia-
ture du grand. Pourtant, là où ne se produisit pas un
arrêt précoce au milieu de cette période peu féconde,
comme en Chine, par exemple, là le principe mili-
taire imperfectible est abandonné après avoir eu le
temps de fixer les types de certains motifs de cons-
truction nouveaux ; de même que le mode féodal perdit
par l’action du temps son importance primitive, socia-
liste-communiste dans l’origine.
C’est par l’apparition victorieuse de ces races d’ha-
bilants de cabanes aux premiers âges, que s’explique
le fait que, pendant qu’ailleurs prédomine la cons-
truction des cours, le culte de la plupart des grandes
réunions d’hommes dans le midi se lie pourtant à
une forme typique qui montre le toit en comble de la
cabane (1).
Quatre exemples remarquables d’un développe-
ment particulier de l’instinct constructif propre à
l’homme en société nous sont offerts par l’histoire des
peuples avant le développement de la civilisation
grecque : chez les Chinois, chez les Égyptiens, chez
les Assyriens et chez les Phéniciens.
L. — Chinois.
L’architecture chinoise antique, pratiquée encore
aujourd’hui, est (à l’exclusion delà hutte du sauvage),
d’après ses motifs, la plus primitive de toutes celles
que nous connaissons. Dans celle architecture appa-
raissent les trois éléments extérieurs dont il a été parlé
plus haut, rigoureusement distincts, et sans liaison
entre eux. L’élément intellectuel ou moral, le foyer —
qu’ici et dans la suite je prends dans la plus haute
acception : l’autel — ne constitue pas ici un centre
vivifiant.
Sorti du camp tartare à une époque où le pays
conquis n’était habité que par des races sauvages, ce
style ne pouvait s’enrichir d’éléments indigènes, et,
dans son isolement par rapport aux influences exté-
rieures, dut rester immobile à la place qu’il avait
prise il y a cinq ou six mille ans.
Ce n’est que par l’accumulation de nouvelles cours,
de nouvelles lerrasses et pavillons, ce n’est que par
l’augmentation en largeur des entre-colonnements, du
nombre et de la dimension des colonnes, qu’il lui fut
possible d’accroître l’importance d’un édifice.
Au point de vue de la polychromie, nous trouvons
ici l’occasion de jeler un coup d’œil sur le système
asiatique ancien que j’oppose au système de colora-
tion égyptien.
M. — Egyptiens.
L’architecture égyptienne est celle qui sortit sans
trouble, organiquement, de loules pièces, et d’elle-
même, du sol où elle a pris racine, avant d’avoir été
fixée par la hiérarchie.
La cage du représentant de la divinité du canton,
de l’animal sacré, près de l’autel de la commune, se
voyait là, dans l’origine, entourée d’une enceinte très
simple, sur une digue élevée sur les bords du Nil.
C’est de là que partaient, c’est là que revenaient les
processions pour lesquelles les pèlerins se rassem-
blaient. Sitôt que la renommée du sanctuaire attirait
une foule plus nombreuse, on ajoutait une seconde
cour environnant la première, ou y attenant. En même
temps s’augmentait la part que le service intérieur de
la divinité avait à réclamer dans les constructions
nouvelles. Dans les commencements, l’enceinte, la
cour, ne fut couverte que dans des occasions excep-
tionnelles, de tapisseries et de voiles empruntées aux
barques du fleuve, puis, recouverte plus solidement;
et des parties en furent détachées à l’usage des cel-
lules séparées des prêtres et des chambres du trésor.
En même temps, par l’accentuation monumentale des
entrées, qui représentèrent en quelque sorte l’image
(1) Témoin aujourd’hui encore la sainte Kaaba.
de la cage sacrée (1), la signification du sanctuaire
caché à l’intérieur fut puissamment indiquée, appe-
lant de loin les fidèles à faire des pèlerinages pour le
visiter. Bien loin au delà des limites du sanctuaire,
sont marqués les chemins que la procession doit
suivre.
Une importance de plus en plus croissante est
donnée par l’adjonction de murailles nouvelles pour
enceindre la cour, et leur grandeur et leur hau-
teur croît en proportion de la célébrité du sanc-
tuaire.
Intérieurement aussi, la construction se développe
pendant que de nouvelles parties s’ajoutent à l’exté-
rieur, pour une organisation de plus en plus riche.
Déjà l’espace ouvert, plus tard couvert, contenant
le iÉy.oi ou arche sacrée, était devenu vénérable par
son âge même, et saint à son tour, il devint le temple
(rj ve(ijç) et, devant son portail, la cour la plus proche
fut couverte à l'usage des délégués supérieurs de la
commune, des plus anciens descendants des habi-
tants du Nome, où s’était rendu célèbre le lieu de
pèlerinage, et qui étaient les héritiers de la prêtrise.
Pour soutenir les couvertures horizontales qui, dans
l’origine, étaient des toiles de lin, les colonnes
durent déjà être mises en usage quand les espaces
grandirent.
Dans les mêmes temps, pour abriter les pèlerins
rassemblés dans les avant-cours, et qui attendaient
aux portes intérieures l’apparition finale de la pom-
peuse cérémonie de fête, on pratiqua, le long des
murailles intérieures, des toits d’abri (provisoires
dans les commencements) soutenus par des colonnes
et par des piliers, et pour la procession elle-même,
dans l’axe milieu, sur des colonnes plus hautes, on
disposa des vélums composés de toiles tendues en
travers de la cour (2).
Suivant que cette couverture-là ou celle-ci, ou
foutes les deux, ou une couverture unique (en tenant
compte des cours plus grandes de la galerie milieu
où les prêtres portaient sur leurs épaules les hautes
images sacrées), prirent plus tard des conformations
plus monumentales, on vit naître toutes les disposi-
tions des combinaisons les plus riches de la distribu-
tion des surfaces. Les temps postérieurs n'en ont pas
ajouté une seule, et leur étude est, au point de vue
de l’intelligence de l’art, au moins aussi importante
que celle des membres, proportions et décorations
de ces parties soutenantes, portées, ou entourantes,
qui là, vinrent en application. C’est à celte dernière
étude d’art plus spéciale que se sont pourtant livrés
nos savants, mais avec une prédilection trop marquée,
et en négligeant beaucoup trop la première partie.
Un regard jeté sur la constitution du sol égyptien
fait comprendre du premier coup que les plus grandes
et les plus anciennes entreprises de constructions se
sont rattachées, dans ce pays, à l’endiguement, à l’ir-
rigation et à l’écoulement des eaux pour les portions
de terre rendues accessibles à la culture.
Malgré cela, les travaux habituels des ingénieurs
n’eurent, chez ce peuple richement doué, d’autre rap-
port avec l’art élevé, qu’ils préparèrent la substruc-
tion des temples, et fournirent pour le reste les
(1) Les plus anciens pylônes n’élaient pas séparés en deux par-
ues, mais ne formaient qu’une seule masse, donl la forme était
faite à l’image du sécos ou arche sainte.
(2) Non pas que je pense que les temples anciens fussent réelle-
ment et pas à pas. pour ainsi dire, sortis du provisoire; mais les
ordonnateurs de l’Égypte ancienne hiérarchisée sous une forme
éminemment artistique très apparente, avaient emprunté à la
Nature les dispositions et motifs de leurs créations. Ce ne sont pas
ici des hypothèses, mais des vérités fort exactes. Qui peut en
douter, s’il connaît la Bible et la conception du temple de
Salomon ?
BULLETINS DE L’ART POUR TOUS. — N» 45.
FNCrCL OPETÎERE L’A R T INDUSTRIEL ET DECORA T/E
t to'US l
28e Année
paraiss aru fcrus les mot s
EMILE REIBER
JDtrecteur’-Fond.a le u r
raine des Imprimeries réunie
An.cienn.e- -Mai-Scm Alore-l
PARIS jfo
'•Ç.RBoivApai’te, Xj
ji:—i-<—i.c—
Septembre 1889
BULLETIN DE SEPTEMBRE 1889
Les quatre Éléments
de l’architecture (3)
Etudes d‘Architecture comparée
par
G. SEMPER, Architecte
Traduction inédite de E. Reiber
K. — Développements primitifs de l’Archi-
tecture (Suite).
Cependant, dans de telles circonstances, les rap-
ports humains n’ont pu que rarement, ou même
jamais, se développer régulièrement par eux-mêmes.
A peine la nature lut-elle maîtrisée par les efforts
communs des réunions d’hommes, que les bienfaits
qu’apporta cet état de société furent l’objet des con-
voitises de races grossières et plus pauvres, contre
lesquelles il fallut se défendre.
Les dispositions que demandèrent les défenses des
établissements durent être modifiées dans leur cons-
truction ; mais cela n’empêcha pas qu’aussi longtemps
qu’elles fonctionnèrent avec succès, elles se formè-
rent de toutes pièces et d’une façon indépendante. 11
en advint tout autrement lorsqu’elles devinrent la proie
de conquérants.
Dans le camp retranché prit alors naissance un
troisième principe. Les armées des conquérants se
composaient des fils des races habitant les cabanes,
et pendant qu’ils se groupaient dans des camps autour
de celui qui les conduisait, suivant les lois de la su-
bordination et de la fortification, ils réunirent leurs
cabanes sous des formes constructives en prenant
pour règle la régularité, la facile surveillance, la
commodité des dispositions, et la solidité.
Quoique parentes dans leur apparence extérieure
et semblables, ces deux dispositions étaient pourtant
très différentes dans leur principe fondamental.
La même différence qui existe entre une monarchie
nationale non disputée, appuyée sur une riche posses-
sion de terres ou sur une hiérarchie sacerdotale, et
un despotisme de satrapes fondé militairement en vue
de conquêtes, se fait sentir aussi dans leurs construc-
tions. Cette différence se monlre très clairement, sur-
tout (comme toujours) dans la loi de leur accroisse-
ment.
La grandeur du maître et seigneur national aug-
mentera lentement, et avec le besoin croissant, croîtra
sa maison, en partie par des accessions d’espace,
en partie surtout par un développement organique
intérieur.
La grandeur du satrape-feudataire, au contraire,
est un don de munificence et naît subitement. Sa
maison est toujours toute prête pour sa haute posi-
tion et n’est qu’une répétition du camp royal à petite
échelle. Les agrandissements ne sont possibles que
par le rattachement d’unités semblables.
De même que là le grand est un développement et
une continuation perfectionnée du petit et du simple,
de même ici le petit n’est qu’une réduction en minia-
ture du grand. Pourtant, là où ne se produisit pas un
arrêt précoce au milieu de cette période peu féconde,
comme en Chine, par exemple, là le principe mili-
taire imperfectible est abandonné après avoir eu le
temps de fixer les types de certains motifs de cons-
truction nouveaux ; de même que le mode féodal perdit
par l’action du temps son importance primitive, socia-
liste-communiste dans l’origine.
C’est par l’apparition victorieuse de ces races d’ha-
bilants de cabanes aux premiers âges, que s’explique
le fait que, pendant qu’ailleurs prédomine la cons-
truction des cours, le culte de la plupart des grandes
réunions d’hommes dans le midi se lie pourtant à
une forme typique qui montre le toit en comble de la
cabane (1).
Quatre exemples remarquables d’un développe-
ment particulier de l’instinct constructif propre à
l’homme en société nous sont offerts par l’histoire des
peuples avant le développement de la civilisation
grecque : chez les Chinois, chez les Égyptiens, chez
les Assyriens et chez les Phéniciens.
L. — Chinois.
L’architecture chinoise antique, pratiquée encore
aujourd’hui, est (à l’exclusion delà hutte du sauvage),
d’après ses motifs, la plus primitive de toutes celles
que nous connaissons. Dans celle architecture appa-
raissent les trois éléments extérieurs dont il a été parlé
plus haut, rigoureusement distincts, et sans liaison
entre eux. L’élément intellectuel ou moral, le foyer —
qu’ici et dans la suite je prends dans la plus haute
acception : l’autel — ne constitue pas ici un centre
vivifiant.
Sorti du camp tartare à une époque où le pays
conquis n’était habité que par des races sauvages, ce
style ne pouvait s’enrichir d’éléments indigènes, et,
dans son isolement par rapport aux influences exté-
rieures, dut rester immobile à la place qu’il avait
prise il y a cinq ou six mille ans.
Ce n’est que par l’accumulation de nouvelles cours,
de nouvelles lerrasses et pavillons, ce n’est que par
l’augmentation en largeur des entre-colonnements, du
nombre et de la dimension des colonnes, qu’il lui fut
possible d’accroître l’importance d’un édifice.
Au point de vue de la polychromie, nous trouvons
ici l’occasion de jeler un coup d’œil sur le système
asiatique ancien que j’oppose au système de colora-
tion égyptien.
M. — Egyptiens.
L’architecture égyptienne est celle qui sortit sans
trouble, organiquement, de loules pièces, et d’elle-
même, du sol où elle a pris racine, avant d’avoir été
fixée par la hiérarchie.
La cage du représentant de la divinité du canton,
de l’animal sacré, près de l’autel de la commune, se
voyait là, dans l’origine, entourée d’une enceinte très
simple, sur une digue élevée sur les bords du Nil.
C’est de là que partaient, c’est là que revenaient les
processions pour lesquelles les pèlerins se rassem-
blaient. Sitôt que la renommée du sanctuaire attirait
une foule plus nombreuse, on ajoutait une seconde
cour environnant la première, ou y attenant. En même
temps s’augmentait la part que le service intérieur de
la divinité avait à réclamer dans les constructions
nouvelles. Dans les commencements, l’enceinte, la
cour, ne fut couverte que dans des occasions excep-
tionnelles, de tapisseries et de voiles empruntées aux
barques du fleuve, puis, recouverte plus solidement;
et des parties en furent détachées à l’usage des cel-
lules séparées des prêtres et des chambres du trésor.
En même temps, par l’accentuation monumentale des
entrées, qui représentèrent en quelque sorte l’image
(1) Témoin aujourd’hui encore la sainte Kaaba.
de la cage sacrée (1), la signification du sanctuaire
caché à l’intérieur fut puissamment indiquée, appe-
lant de loin les fidèles à faire des pèlerinages pour le
visiter. Bien loin au delà des limites du sanctuaire,
sont marqués les chemins que la procession doit
suivre.
Une importance de plus en plus croissante est
donnée par l’adjonction de murailles nouvelles pour
enceindre la cour, et leur grandeur et leur hau-
teur croît en proportion de la célébrité du sanc-
tuaire.
Intérieurement aussi, la construction se développe
pendant que de nouvelles parties s’ajoutent à l’exté-
rieur, pour une organisation de plus en plus riche.
Déjà l’espace ouvert, plus tard couvert, contenant
le iÉy.oi ou arche sacrée, était devenu vénérable par
son âge même, et saint à son tour, il devint le temple
(rj ve(ijç) et, devant son portail, la cour la plus proche
fut couverte à l'usage des délégués supérieurs de la
commune, des plus anciens descendants des habi-
tants du Nome, où s’était rendu célèbre le lieu de
pèlerinage, et qui étaient les héritiers de la prêtrise.
Pour soutenir les couvertures horizontales qui, dans
l’origine, étaient des toiles de lin, les colonnes
durent déjà être mises en usage quand les espaces
grandirent.
Dans les mêmes temps, pour abriter les pèlerins
rassemblés dans les avant-cours, et qui attendaient
aux portes intérieures l’apparition finale de la pom-
peuse cérémonie de fête, on pratiqua, le long des
murailles intérieures, des toits d’abri (provisoires
dans les commencements) soutenus par des colonnes
et par des piliers, et pour la procession elle-même,
dans l’axe milieu, sur des colonnes plus hautes, on
disposa des vélums composés de toiles tendues en
travers de la cour (2).
Suivant que cette couverture-là ou celle-ci, ou
foutes les deux, ou une couverture unique (en tenant
compte des cours plus grandes de la galerie milieu
où les prêtres portaient sur leurs épaules les hautes
images sacrées), prirent plus tard des conformations
plus monumentales, on vit naître toutes les disposi-
tions des combinaisons les plus riches de la distribu-
tion des surfaces. Les temps postérieurs n'en ont pas
ajouté une seule, et leur étude est, au point de vue
de l’intelligence de l’art, au moins aussi importante
que celle des membres, proportions et décorations
de ces parties soutenantes, portées, ou entourantes,
qui là, vinrent en application. C’est à celte dernière
étude d’art plus spéciale que se sont pourtant livrés
nos savants, mais avec une prédilection trop marquée,
et en négligeant beaucoup trop la première partie.
Un regard jeté sur la constitution du sol égyptien
fait comprendre du premier coup que les plus grandes
et les plus anciennes entreprises de constructions se
sont rattachées, dans ce pays, à l’endiguement, à l’ir-
rigation et à l’écoulement des eaux pour les portions
de terre rendues accessibles à la culture.
Malgré cela, les travaux habituels des ingénieurs
n’eurent, chez ce peuple richement doué, d’autre rap-
port avec l’art élevé, qu’ils préparèrent la substruc-
tion des temples, et fournirent pour le reste les
(1) Les plus anciens pylônes n’élaient pas séparés en deux par-
ues, mais ne formaient qu’une seule masse, donl la forme était
faite à l’image du sécos ou arche sainte.
(2) Non pas que je pense que les temples anciens fussent réelle-
ment et pas à pas. pour ainsi dire, sortis du provisoire; mais les
ordonnateurs de l’Égypte ancienne hiérarchisée sous une forme
éminemment artistique très apparente, avaient emprunté à la
Nature les dispositions et motifs de leurs créations. Ce ne sont pas
ici des hypothèses, mais des vérités fort exactes. Qui peut en
douter, s’il connaît la Bible et la conception du temple de
Salomon ?
BULLETINS DE L’ART POUR TOUS. — N» 45.