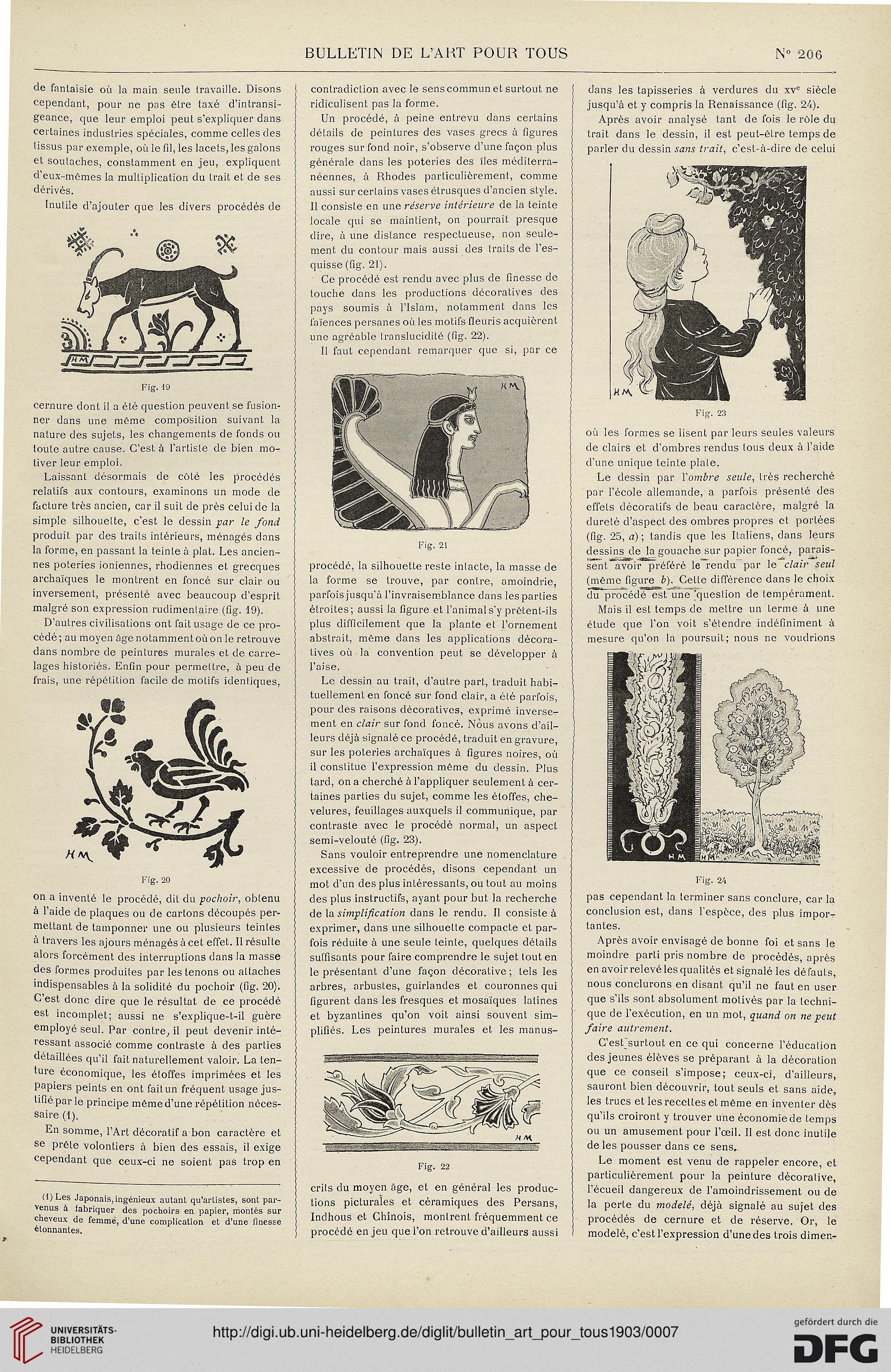BULLETIN DE L'A HT POUR TOUS
N° 206
de fnnlaisie où la main seule travaille. Disons contradiction avec le sens commun et surtout ne ! dans les tapisseries à verdures du xvc siècle
cependant, pour ne pas être taxé d'intransi- ridiculisent pas la forme. jusqu'à et y compris la Renaissance (fig. 24)
geance, que leur emploi peut s'expliquer dans Un procédé, à peine entrevu dans certains Après avoir analysé tant de fois le rôle du
certaines industries spéciales, comme celles des détails de peintures des vases grecs à figures Irait dans le dessin, il est peut-être temps de
tissus par exemple, où le fil, les lacets, les galons j rouges sur fond noir, s'observe d'une façon plus J parler du dessin sans trait, c'est-à-dire de celui
et soutaches, constamment en jeu, expliquent générale dans les poteries des iles médilerra-
d eux-mêmes la multiplication du trait et de ses néennes, à Rhodes particulièrement, comme
dérivés. aussi sur certains vases étrusques d'ancien style.
Inutile d'ajouter que les divers procédés de j II consiste en une réserve intérieure de la teinte
locale qui se maintient, on pourrait presque
dire, à une distance respectueuse, non seule-
ment du contour mais aussi des Irails de l'es-
quisse (fig. 21).
Ce procédé est rendu avec plus de finesse de
touche dans les productions décoratives des
pays soumis à l'Islam, notamment clans les
faïences persanes où les motifs fleuris acquièrent
une agréable Iranslucidité (fig. 22).
Il faut cependant remarquer que si, par ce
Fis. 19
Fig. 23
abstrait, môme dans les applications décora- j mesure qu'on la poursuit; nous ne voudrions
tives où la convention peut se développer à
cernure dont il a été question peuvent se fusion-
ner dans une même composition suivant la
nature des sujets, les changements de fonds ou J SI V I^P ^ j ou Ies formés se lisent par leurs seules valeurs
toute autre cause. C'est à l'artiste de bien mo- S?\ \. /M Ml f-> I de clairs et d'ombres rendus tous deux à l'aide
tiver leur emploi. Hp^\\ x^, jM |f I ! d'une unique teinte plate.
Laissant désormais de côté les procédés j 5«É&K\ Mffliïïir:::\ -"s ^essm Par ^om^re seule, très recherché
relatifs aux contours, examinons un mode de ÉRa^Jv *(~ \ par l'école allemande, a parfois présenté des
facture très ancien, car il suit de près celui de la frSÊ 5»>\ \ V I I effets décoratifs de beau caractère, malgré la
simple silhouette, c'est le dessiner le fond NO§ W^Ê^^^1^L.^L_ ^ ^ dureté d'aspect des ombres propres et portées
produit par des traits intérieurs, ménagés dans . (fig- 25, a); tandis que les Italiens, dans leurs
la forme, en passant la teinte à plat. Les ancien- 'S'21 ; dessirmcle la gouache sur papier foncé, parais-
nes poteries ioniennes, rhodiennes et grecques procédé, la silhouette reste inlacte, la masse de sent avoir préféré le rendu par le clair seul
archaïques le montrent en foncé sur clair ou la forme se trouve, par contre, amoindrie, (même figure b). Cette différence dans le choix
inversement, présenté avec beaucoup d'esprit parfois jusqu'à l'invraisemblance dans les parties du procédé est une question de tempérament
malgré son. expression rudimenfaire (fig. 19). étroites ; aussi la figure et l'animal s'y prêtent-ils Mais il est temps de mettre un terme à une
D'autres civilisations ont fait usage de ce pro- j plus difficilement que la plante et l'ornement j étude que l'on voit s'étendre indéfiniment à
cédé; au moyen âge notamment où on le retrouve
dans nombre de peintures murales et de carre-
lages historiés. Enfin pour permettre, à peu de ! l'aise.
frais, une répétition facile de motifs identiques, Le dessin au trait, d'autre part, traduit habi
tuellementen foncé sur fond clair, a été parfois,
pour des raisons décoratives, exprimé inverse-
ment en clair sur fond foncé. Nous avons d'ail-
leurs déjà signalé ce procédé, traduit en gravure,
sur les poteries archaïques à figures noires, où
il constitue l'expression même du dessin. Plus
tard, on a cherché à l'appliquer seulement à cer-
taines parties du sujet, comme les étoffes, che-
velures, feuillages auxquels il communique, par
contraste avec le procédé normal, un aspect
semi-velouté (fig. 23).
Sans vouloir entreprendre une nomenclature
excessive de procédés, disons cependant un
1- ig. 20 mot d'un des plus intéressants, ou tout au moins < Fig. 24
on a inventé le procédé, dit du pochoir, obtenu des plus instructifs, ayant pour but la recherche \ Pas cependant la terminer sans conclure, car la
à l'aide de plaques ou de cartons découpés per- de la simplification dans le rendu. Il consiste à ! conclusion est, dans l'espèce, des plus impor-
metlant de tamponner une ou plusieurs teintes j exprimer, dans une silhouette compacte et par- tantes.
fois réduite à une seule Leinle, quelques détails Après avoir envisagé de bonne foi et sans le
suffisants pour faire comprendre le sujet tout en moindre parti pris nombre de procédés, après
le présentant d'une façon décorative ; tels les en avoir relevé les qualités et signalé les défauts,
arbres, arbustes, guirlandes et couronnes qui nous conclurons en disant qu'il ne faut en user
figurent dans les fresques et mosaïques latines ' que s'ils sont absolument motivés par la lechni-
et byzantines qu'on voit ainsi souvent sim- ; que de l'exécution, en un mot, quand on ne peut
employé seul. Par contre, il peut devenir inté- j plifiés. Les peintures murales et les manus- j faire autrement.
ressant associé comme contraste à des parties
détaillées qu'il fait naturellement valoir. La ten-
à travers les ajours ménagés à cet effet. Il résulte
alors forcément des interruptions clans la masse
des formes produites par les tenons ou attaches
indispensables à la solidité du pochoir (fig. 20).
C'est donc dire que le résultat de ce procédé
est incomplet; aussi ne s'explique-t-il guère
ture économique, les étoffes imprimées et les
papiers peints en ont fait un fréquent usage jus-
tifié par le principe même d'une répétition néces-
saire (1).
En somme, l'Art décoratif a bon caractère et
se prèle volontiers à bien des essais, il exige
cependant que ceux-ci ne soient pas trop en
(l)Les Japonais,ingénieux autant qu'artistes, sont par-
venus à fabriquer des pochoirs en papier, montés sur
cheveux de femme, d'une complication et d'une finesse
étonnantes.
C'est'surlout en ce qui concerne l'éducalion
^^^.^^w^^^vc^>i^, ■,.-.■-■„ :..■■■ j des jeunes élèves se préparant à la décoration
que ce conseil s'impose; ceux-ci, d'ailleurs,
sauront bien découvrir, tout seuls et sans aide,
les trucs et les recettes et même en inventer dès
qu'ils croiront y trouver une économie de temps
ou un amusement pour l'oeil. Il est donc inutile
de les pousser dans ce sens.
Le moment est venu de rappeler encore, et
particulièrement pour la peinture décorative,
crils du moyen âge, et en général les produc- j l'écueil dangereux de l'amoindrissement ou de
M Al
Fig. 22
tions picturales et céramiques des Persans,
Indhous et Chinois, montrent fréquemment ce
procédé en jeu que l'on retrouve d'ailleurs aussi
la perte du modelé, déjà signalé au sujet des
procédés de cernure et de réserve. Or, le
modelé, c'est l'expression d'une des trois dimen-
N° 206
de fnnlaisie où la main seule travaille. Disons contradiction avec le sens commun et surtout ne ! dans les tapisseries à verdures du xvc siècle
cependant, pour ne pas être taxé d'intransi- ridiculisent pas la forme. jusqu'à et y compris la Renaissance (fig. 24)
geance, que leur emploi peut s'expliquer dans Un procédé, à peine entrevu dans certains Après avoir analysé tant de fois le rôle du
certaines industries spéciales, comme celles des détails de peintures des vases grecs à figures Irait dans le dessin, il est peut-être temps de
tissus par exemple, où le fil, les lacets, les galons j rouges sur fond noir, s'observe d'une façon plus J parler du dessin sans trait, c'est-à-dire de celui
et soutaches, constamment en jeu, expliquent générale dans les poteries des iles médilerra-
d eux-mêmes la multiplication du trait et de ses néennes, à Rhodes particulièrement, comme
dérivés. aussi sur certains vases étrusques d'ancien style.
Inutile d'ajouter que les divers procédés de j II consiste en une réserve intérieure de la teinte
locale qui se maintient, on pourrait presque
dire, à une distance respectueuse, non seule-
ment du contour mais aussi des Irails de l'es-
quisse (fig. 21).
Ce procédé est rendu avec plus de finesse de
touche dans les productions décoratives des
pays soumis à l'Islam, notamment clans les
faïences persanes où les motifs fleuris acquièrent
une agréable Iranslucidité (fig. 22).
Il faut cependant remarquer que si, par ce
Fis. 19
Fig. 23
abstrait, môme dans les applications décora- j mesure qu'on la poursuit; nous ne voudrions
tives où la convention peut se développer à
cernure dont il a été question peuvent se fusion-
ner dans une même composition suivant la
nature des sujets, les changements de fonds ou J SI V I^P ^ j ou Ies formés se lisent par leurs seules valeurs
toute autre cause. C'est à l'artiste de bien mo- S?\ \. /M Ml f-> I de clairs et d'ombres rendus tous deux à l'aide
tiver leur emploi. Hp^\\ x^, jM |f I ! d'une unique teinte plate.
Laissant désormais de côté les procédés j 5«É&K\ Mffliïïir:::\ -"s ^essm Par ^om^re seule, très recherché
relatifs aux contours, examinons un mode de ÉRa^Jv *(~ \ par l'école allemande, a parfois présenté des
facture très ancien, car il suit de près celui de la frSÊ 5»>\ \ V I I effets décoratifs de beau caractère, malgré la
simple silhouette, c'est le dessiner le fond NO§ W^Ê^^^1^L.^L_ ^ ^ dureté d'aspect des ombres propres et portées
produit par des traits intérieurs, ménagés dans . (fig- 25, a); tandis que les Italiens, dans leurs
la forme, en passant la teinte à plat. Les ancien- 'S'21 ; dessirmcle la gouache sur papier foncé, parais-
nes poteries ioniennes, rhodiennes et grecques procédé, la silhouette reste inlacte, la masse de sent avoir préféré le rendu par le clair seul
archaïques le montrent en foncé sur clair ou la forme se trouve, par contre, amoindrie, (même figure b). Cette différence dans le choix
inversement, présenté avec beaucoup d'esprit parfois jusqu'à l'invraisemblance dans les parties du procédé est une question de tempérament
malgré son. expression rudimenfaire (fig. 19). étroites ; aussi la figure et l'animal s'y prêtent-ils Mais il est temps de mettre un terme à une
D'autres civilisations ont fait usage de ce pro- j plus difficilement que la plante et l'ornement j étude que l'on voit s'étendre indéfiniment à
cédé; au moyen âge notamment où on le retrouve
dans nombre de peintures murales et de carre-
lages historiés. Enfin pour permettre, à peu de ! l'aise.
frais, une répétition facile de motifs identiques, Le dessin au trait, d'autre part, traduit habi
tuellementen foncé sur fond clair, a été parfois,
pour des raisons décoratives, exprimé inverse-
ment en clair sur fond foncé. Nous avons d'ail-
leurs déjà signalé ce procédé, traduit en gravure,
sur les poteries archaïques à figures noires, où
il constitue l'expression même du dessin. Plus
tard, on a cherché à l'appliquer seulement à cer-
taines parties du sujet, comme les étoffes, che-
velures, feuillages auxquels il communique, par
contraste avec le procédé normal, un aspect
semi-velouté (fig. 23).
Sans vouloir entreprendre une nomenclature
excessive de procédés, disons cependant un
1- ig. 20 mot d'un des plus intéressants, ou tout au moins < Fig. 24
on a inventé le procédé, dit du pochoir, obtenu des plus instructifs, ayant pour but la recherche \ Pas cependant la terminer sans conclure, car la
à l'aide de plaques ou de cartons découpés per- de la simplification dans le rendu. Il consiste à ! conclusion est, dans l'espèce, des plus impor-
metlant de tamponner une ou plusieurs teintes j exprimer, dans une silhouette compacte et par- tantes.
fois réduite à une seule Leinle, quelques détails Après avoir envisagé de bonne foi et sans le
suffisants pour faire comprendre le sujet tout en moindre parti pris nombre de procédés, après
le présentant d'une façon décorative ; tels les en avoir relevé les qualités et signalé les défauts,
arbres, arbustes, guirlandes et couronnes qui nous conclurons en disant qu'il ne faut en user
figurent dans les fresques et mosaïques latines ' que s'ils sont absolument motivés par la lechni-
et byzantines qu'on voit ainsi souvent sim- ; que de l'exécution, en un mot, quand on ne peut
employé seul. Par contre, il peut devenir inté- j plifiés. Les peintures murales et les manus- j faire autrement.
ressant associé comme contraste à des parties
détaillées qu'il fait naturellement valoir. La ten-
à travers les ajours ménagés à cet effet. Il résulte
alors forcément des interruptions clans la masse
des formes produites par les tenons ou attaches
indispensables à la solidité du pochoir (fig. 20).
C'est donc dire que le résultat de ce procédé
est incomplet; aussi ne s'explique-t-il guère
ture économique, les étoffes imprimées et les
papiers peints en ont fait un fréquent usage jus-
tifié par le principe même d'une répétition néces-
saire (1).
En somme, l'Art décoratif a bon caractère et
se prèle volontiers à bien des essais, il exige
cependant que ceux-ci ne soient pas trop en
(l)Les Japonais,ingénieux autant qu'artistes, sont par-
venus à fabriquer des pochoirs en papier, montés sur
cheveux de femme, d'une complication et d'une finesse
étonnantes.
C'est'surlout en ce qui concerne l'éducalion
^^^.^^w^^^vc^>i^, ■,.-.■-■„ :..■■■ j des jeunes élèves se préparant à la décoration
que ce conseil s'impose; ceux-ci, d'ailleurs,
sauront bien découvrir, tout seuls et sans aide,
les trucs et les recettes et même en inventer dès
qu'ils croiront y trouver une économie de temps
ou un amusement pour l'oeil. Il est donc inutile
de les pousser dans ce sens.
Le moment est venu de rappeler encore, et
particulièrement pour la peinture décorative,
crils du moyen âge, et en général les produc- j l'écueil dangereux de l'amoindrissement ou de
M Al
Fig. 22
tions picturales et céramiques des Persans,
Indhous et Chinois, montrent fréquemment ce
procédé en jeu que l'on retrouve d'ailleurs aussi
la perte du modelé, déjà signalé au sujet des
procédés de cernure et de réserve. Or, le
modelé, c'est l'expression d'une des trois dimen-