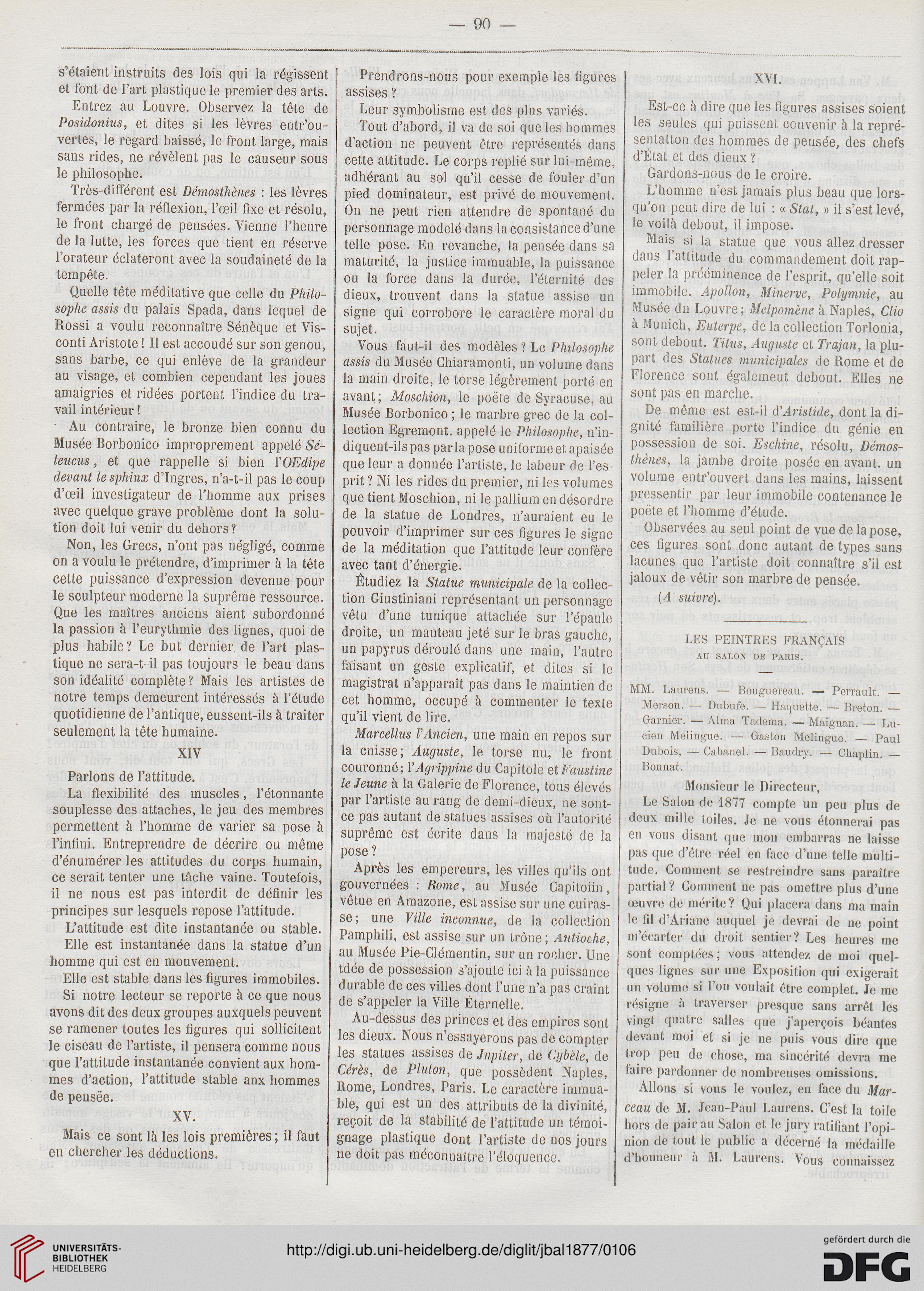— 90 —
s’étaient instruits des lois qui la régissent
et font de l’art plastique le premier des arts.
Entrez au Louvre. Observez la tête de
Posidonius, et dites si les lèvres entrou-
vertes, le regard baissé, le front large, mais
sans rides, ne révèlent pas le causeur sous
le philosophe.
Très-différent est Démosthènes : les lèvres
fermées par la réflexion, l’œil fixe et résolu,
le front chargé de pensées. Vienne l’heure
de la lutte, les forces que tient en réserve
l’orateur éclateront avec la soudaineté de la
tempête.
Quelle tête méditative que celle du Philo-
sophe assis du palais Spada, dans lequel de
Rossi a voulu reconnaître Sénèque et Vis-
conti Aristote ! Il est accoudé sur son genou,
sans barbe, ce qui enlève de la grandeur
au visage, et combien cependant les joues
amaigries et ridées portent l’indice du tra-
vail intérieur !
Au contraire, le bronze bien connu du
Musée Borbonico improprement appelé Sé-
leucus, et que rappelle si bien YOEdipe
devant le sphinx d’Ingres, n’a-t-il pas le coup
d’œil investigateur de l’homme aux prises
avec quelque grave problème dont la solu-
tion doit lui venir du dehors?
Non, les Grecs, n’ont pas négligé, comme
on a voulu le prétendre, d’imprimer à la tête
cette puissance d’expression devenue pour
le sculpteur moderne la suprême ressource.
Que les maîtres anciens aient subordonné
la passion à l’eurythmie des lignes, quoi de
plus habile? Le but dernier.de l’art plas-
tique ne sera-t il pas toujours le beau dans
son idéalité complète ? Mais les artistes de
notre temps demeurent intéressés à l’étude
quotidienne de l’antique, eussent-ils à traiter
seulement la tête humaine.
XIV
Parlons de l’attitude.
La flexibilité des muscles, l’étonnante
souplesse des attaches, le jeu des membres
permettent à l’homme de varier sa pose à
l’infini. Entreprendre de décrire ou même
d’énumérer les attitudes du corps humain,
ce serait tenter une tâche vaine. Toutefois,
il ne nous est pas interdit de définir les
principes sur lesquels repose l’attitude.
L’attitude est dite instantanée ou stable.
Elle est instantanée dans la statue d’un
homme qui est en mouvement.
Elle est stable dans les figures immobiles.
Si notre lecteur se reporte à ce que nous
avons dit des deux groupes auxquels peuvent
se ramener toutes les figures qui sollicitent
le ciseau de l’artiste, il pensera comme nous
que l’attitude instantanée convient aux hom-
mes d’action, l’attitude stable anx hommes
de pensée.
XV.
Mais ce sont là les lois premières ; il faut
en chercher les déductions.
Prendrons-nous pour exemple les figures
assises ?
Leur symbolisme est des plus variés.
Tout d’abord, il va de soi que les hommes
d’action ne peuvent être représentés dans
cette attitude. Le corps replié sur lui-même,
adhérant au sol qu’il cesse de fouler d’un
pied dominateur, est privé de mouvement.
On ne peut rien attendre de spontané du
personnage modelé dans la consistance d’une
telle pose. En revanche, la pensée dans sa
maturité, la justice immuable, la puissance
ou la force dans la durée, l’éternité des
dieux, trouvent dans la statue assise un
signe qui corrobore le caractère moral du
sujet.
Vous faut-il des modèles ? Le Philosophe
assis du Musée Chiaramonti, un volume dans
la main droite, le torse légèrement porté en
avant; Moschion, le poète de Syracuse, au
Musée Borbonico ; le marbre grec de la col-
lection Egremont. appelé le Philosophe, n’in-
diquent-ils pas parla pose uniforme et apaisée
que leur a donnée l’artiste, le labeur de l’es-
prit ? Ni les rides du premier, ni les volumes
que tient Moschion, ni le pallium en désordre
de la statue de Londres, n’auraient eu le
pouvoir d’imprimer sur ces figures le signe
de la méditation que l’attitude leur confère
avec tant d’énergie.
Étudiez la Statue municipale de la collec-
tion Giustiniani représentant un personnage
vêtu d’une tunique attachée sur l’épaule
droite, un manteau jeté sur le bras gauche,
un papyrus déroulé dans une main, l’autre
faisant un geste explicatif, et dites si le
magistrat n’apparaît pas dans le maintien de
cet homme, occupé à commenter le texte
qu’il vient de lire.
Marcellus l'Ancien, une main en repos sur
la cnisse; Auguste, le torse nu, le front
couronné; Y Agrippine du Capitole et Faustine
le Jeune à la Galerie de Florence, tous élevés
par l’artiste au rang de demi-dieux, ne sont-
ce pas autant de statues assises où l’autorité
suprême est écrite dans la majesté de la
pose ?
Après les empereurs, les villes qu’ils ont
gouvernées : Rome, au Musée Capitoiin,
vêtue en Amazone, est assise sur une cuiras-
se; une Ville inconnue, de la collection
Pamphili, est assise sur un trône; Antioche,
au Musée Pie-Clémentin, sur un rocher. Une
tdée de possession s’ajoute ici à la puissance
durable de ces villes dont l’une n’a pas craint
de s’appeler la Ville Éternelle.
Au-dessus des princes et des empires sont
les dieux. Nous n’essayerons pas de compter
les statues assises de Jupiter, de Cybèle, de
Cérès, de Pluton, que possèdent Naples,
Rome, Londres, Paris. Le caractère immua-
ble, qui est un des attributs de la divinité,
reçoit de la stabilité de l’attitude un témoi-
gnage plastique dont l’artiste de nos jours
ne doit pas méconnaître l'éloquence.
XVI.
Est-ce à dire que les figures assises soient
les seules qui puissent convenir à la repré-
sentation des hommes de peusée, des chefs
d’État et des dieux ?
Gardons-nous de le croire.
L’homme n’est jamais plus beau que lors-
qu’on peut dire de lui : « Stal, » il s’est levé,
le voilà debout, il impose.
Mais si la statue que vous allez dresser
dans l’attitude du commandement doit rap-
peler la prééminence de l’esprit, qu’elle soit
immobile. Apollon, Minerve, Polymnie, au
Musée dn Louvre; Melpomène à Naples, Clio
à Munich, Euterpe, de la collection Torlonia,
sont debout. Titus, Auguste et Trajan, la plu-
part des Statues municipales de Rome et de
Florence sont égalemeut debout. Elles ne
sont pas en marche.
De même est est-il d'Aristide, dont la di-
gnité familière porte l’indice du génie en
possession de soi. Eschine, résolu, Démos-
thènes, la jambe droite posée en avant, un
volume entr’ouvert dans les mains, laissent
pressentir par leur immobile contenance le
poète et l’homme d’étude.
Observées au seul point de vue de la pose,
ces figures sont donc autant de types sans
lacunes que l’artiste doit connaître s’il est
jaloux de vêtir son marbre de pensée.
(4 suivre).
LES PEINTRES FRANÇAIS
AU SALON DE PARIS.
MM. Laurens. — Bouguereau. — Perrault. —
Merson. — Dubufe. — Haquette. — Breton. —
Garnier. — Alma Tadema. — Maignan. — Lu-
cien Meiingue. — Gaston Melingue. — Paul
Dubois, — Cabanel. — Baudry. — Chaplin. —
Bonnat.
Monsieur le Directeur,
Le Salon de 1877 compte un peu plus de
deux mille toiles. Je ne vous étonnerai pas
en vous disant que mon embarras ne laisse
pas que d’être réel en face d’une telle multi-
tude. Comment se restreindre sans paraître
partial? Comment ne pas omettre plus d’une
œuvre de mérite? Qui placera dans ma main
le fil d’Ariane auquel je devrai de ne point
m’écarter du droit sentier? Les heures me
sont comptées ; vous attendez de moi quel-
ques lignes sur une Exposilion qui exigerait
un volume si l’on voulait être complet. Je me
résigne à traverser presque sans arrêt les
vingt quatre salles que j’aperçois béantes
devant moi et si je ne puis vous dire que
trop peu de chose, ma sincérité devra me
faire pardonner de nombreuses omissions.
Allons si vous le voulez, en face du Mar-
ceau de M. Jean-Paul Laurens. C’est la toile
hors de pair au Salon et le jury ratifiant l’opi-
nion de tout le public a décerné la médaille
d’honneur à M. Laurens. Vous connaissez
s’étaient instruits des lois qui la régissent
et font de l’art plastique le premier des arts.
Entrez au Louvre. Observez la tête de
Posidonius, et dites si les lèvres entrou-
vertes, le regard baissé, le front large, mais
sans rides, ne révèlent pas le causeur sous
le philosophe.
Très-différent est Démosthènes : les lèvres
fermées par la réflexion, l’œil fixe et résolu,
le front chargé de pensées. Vienne l’heure
de la lutte, les forces que tient en réserve
l’orateur éclateront avec la soudaineté de la
tempête.
Quelle tête méditative que celle du Philo-
sophe assis du palais Spada, dans lequel de
Rossi a voulu reconnaître Sénèque et Vis-
conti Aristote ! Il est accoudé sur son genou,
sans barbe, ce qui enlève de la grandeur
au visage, et combien cependant les joues
amaigries et ridées portent l’indice du tra-
vail intérieur !
Au contraire, le bronze bien connu du
Musée Borbonico improprement appelé Sé-
leucus, et que rappelle si bien YOEdipe
devant le sphinx d’Ingres, n’a-t-il pas le coup
d’œil investigateur de l’homme aux prises
avec quelque grave problème dont la solu-
tion doit lui venir du dehors?
Non, les Grecs, n’ont pas négligé, comme
on a voulu le prétendre, d’imprimer à la tête
cette puissance d’expression devenue pour
le sculpteur moderne la suprême ressource.
Que les maîtres anciens aient subordonné
la passion à l’eurythmie des lignes, quoi de
plus habile? Le but dernier.de l’art plas-
tique ne sera-t il pas toujours le beau dans
son idéalité complète ? Mais les artistes de
notre temps demeurent intéressés à l’étude
quotidienne de l’antique, eussent-ils à traiter
seulement la tête humaine.
XIV
Parlons de l’attitude.
La flexibilité des muscles, l’étonnante
souplesse des attaches, le jeu des membres
permettent à l’homme de varier sa pose à
l’infini. Entreprendre de décrire ou même
d’énumérer les attitudes du corps humain,
ce serait tenter une tâche vaine. Toutefois,
il ne nous est pas interdit de définir les
principes sur lesquels repose l’attitude.
L’attitude est dite instantanée ou stable.
Elle est instantanée dans la statue d’un
homme qui est en mouvement.
Elle est stable dans les figures immobiles.
Si notre lecteur se reporte à ce que nous
avons dit des deux groupes auxquels peuvent
se ramener toutes les figures qui sollicitent
le ciseau de l’artiste, il pensera comme nous
que l’attitude instantanée convient aux hom-
mes d’action, l’attitude stable anx hommes
de pensée.
XV.
Mais ce sont là les lois premières ; il faut
en chercher les déductions.
Prendrons-nous pour exemple les figures
assises ?
Leur symbolisme est des plus variés.
Tout d’abord, il va de soi que les hommes
d’action ne peuvent être représentés dans
cette attitude. Le corps replié sur lui-même,
adhérant au sol qu’il cesse de fouler d’un
pied dominateur, est privé de mouvement.
On ne peut rien attendre de spontané du
personnage modelé dans la consistance d’une
telle pose. En revanche, la pensée dans sa
maturité, la justice immuable, la puissance
ou la force dans la durée, l’éternité des
dieux, trouvent dans la statue assise un
signe qui corrobore le caractère moral du
sujet.
Vous faut-il des modèles ? Le Philosophe
assis du Musée Chiaramonti, un volume dans
la main droite, le torse légèrement porté en
avant; Moschion, le poète de Syracuse, au
Musée Borbonico ; le marbre grec de la col-
lection Egremont. appelé le Philosophe, n’in-
diquent-ils pas parla pose uniforme et apaisée
que leur a donnée l’artiste, le labeur de l’es-
prit ? Ni les rides du premier, ni les volumes
que tient Moschion, ni le pallium en désordre
de la statue de Londres, n’auraient eu le
pouvoir d’imprimer sur ces figures le signe
de la méditation que l’attitude leur confère
avec tant d’énergie.
Étudiez la Statue municipale de la collec-
tion Giustiniani représentant un personnage
vêtu d’une tunique attachée sur l’épaule
droite, un manteau jeté sur le bras gauche,
un papyrus déroulé dans une main, l’autre
faisant un geste explicatif, et dites si le
magistrat n’apparaît pas dans le maintien de
cet homme, occupé à commenter le texte
qu’il vient de lire.
Marcellus l'Ancien, une main en repos sur
la cnisse; Auguste, le torse nu, le front
couronné; Y Agrippine du Capitole et Faustine
le Jeune à la Galerie de Florence, tous élevés
par l’artiste au rang de demi-dieux, ne sont-
ce pas autant de statues assises où l’autorité
suprême est écrite dans la majesté de la
pose ?
Après les empereurs, les villes qu’ils ont
gouvernées : Rome, au Musée Capitoiin,
vêtue en Amazone, est assise sur une cuiras-
se; une Ville inconnue, de la collection
Pamphili, est assise sur un trône; Antioche,
au Musée Pie-Clémentin, sur un rocher. Une
tdée de possession s’ajoute ici à la puissance
durable de ces villes dont l’une n’a pas craint
de s’appeler la Ville Éternelle.
Au-dessus des princes et des empires sont
les dieux. Nous n’essayerons pas de compter
les statues assises de Jupiter, de Cybèle, de
Cérès, de Pluton, que possèdent Naples,
Rome, Londres, Paris. Le caractère immua-
ble, qui est un des attributs de la divinité,
reçoit de la stabilité de l’attitude un témoi-
gnage plastique dont l’artiste de nos jours
ne doit pas méconnaître l'éloquence.
XVI.
Est-ce à dire que les figures assises soient
les seules qui puissent convenir à la repré-
sentation des hommes de peusée, des chefs
d’État et des dieux ?
Gardons-nous de le croire.
L’homme n’est jamais plus beau que lors-
qu’on peut dire de lui : « Stal, » il s’est levé,
le voilà debout, il impose.
Mais si la statue que vous allez dresser
dans l’attitude du commandement doit rap-
peler la prééminence de l’esprit, qu’elle soit
immobile. Apollon, Minerve, Polymnie, au
Musée dn Louvre; Melpomène à Naples, Clio
à Munich, Euterpe, de la collection Torlonia,
sont debout. Titus, Auguste et Trajan, la plu-
part des Statues municipales de Rome et de
Florence sont égalemeut debout. Elles ne
sont pas en marche.
De même est est-il d'Aristide, dont la di-
gnité familière porte l’indice du génie en
possession de soi. Eschine, résolu, Démos-
thènes, la jambe droite posée en avant, un
volume entr’ouvert dans les mains, laissent
pressentir par leur immobile contenance le
poète et l’homme d’étude.
Observées au seul point de vue de la pose,
ces figures sont donc autant de types sans
lacunes que l’artiste doit connaître s’il est
jaloux de vêtir son marbre de pensée.
(4 suivre).
LES PEINTRES FRANÇAIS
AU SALON DE PARIS.
MM. Laurens. — Bouguereau. — Perrault. —
Merson. — Dubufe. — Haquette. — Breton. —
Garnier. — Alma Tadema. — Maignan. — Lu-
cien Meiingue. — Gaston Melingue. — Paul
Dubois, — Cabanel. — Baudry. — Chaplin. —
Bonnat.
Monsieur le Directeur,
Le Salon de 1877 compte un peu plus de
deux mille toiles. Je ne vous étonnerai pas
en vous disant que mon embarras ne laisse
pas que d’être réel en face d’une telle multi-
tude. Comment se restreindre sans paraître
partial? Comment ne pas omettre plus d’une
œuvre de mérite? Qui placera dans ma main
le fil d’Ariane auquel je devrai de ne point
m’écarter du droit sentier? Les heures me
sont comptées ; vous attendez de moi quel-
ques lignes sur une Exposilion qui exigerait
un volume si l’on voulait être complet. Je me
résigne à traverser presque sans arrêt les
vingt quatre salles que j’aperçois béantes
devant moi et si je ne puis vous dire que
trop peu de chose, ma sincérité devra me
faire pardonner de nombreuses omissions.
Allons si vous le voulez, en face du Mar-
ceau de M. Jean-Paul Laurens. C’est la toile
hors de pair au Salon et le jury ratifiant l’opi-
nion de tout le public a décerné la médaille
d’honneur à M. Laurens. Vous connaissez