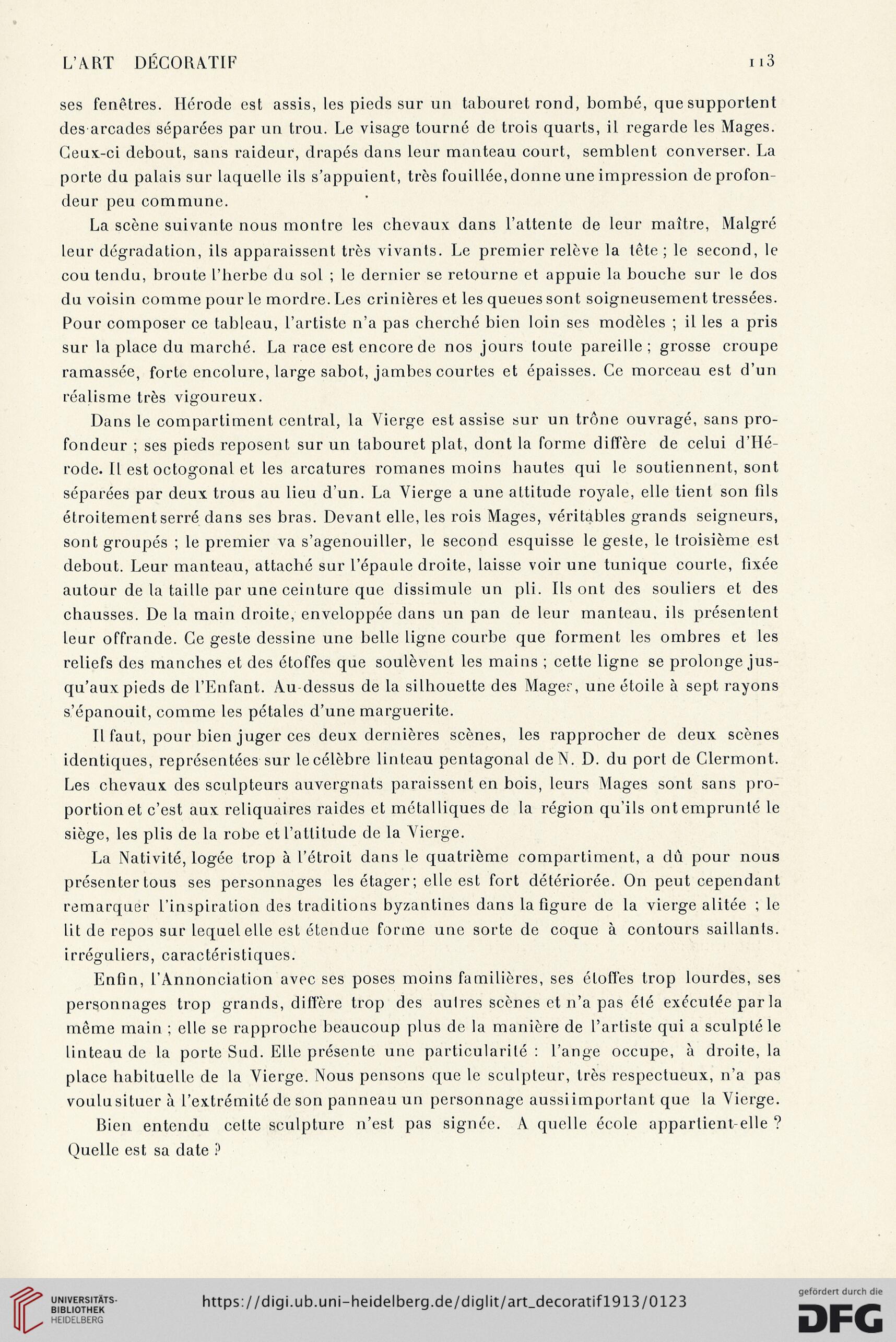L’ART DÉCORATIF
113
ses fenêtres. Hérode est assis, les pieds sur un tabouret rond, bombé, que supportent
des arcades séparées par un trou. Le visage tourné de trois quarts, il regarde les Mages.
Ceux-ci debout, sans raideur, drapés dans leur manteau court, semblent converser. La
porte du palais sur laquelle ils s’appuient, très fouillée, donne une impression de profon-
deur peu commune.
La scène suivante nous montre les chevaux dans l’attente de leur maître, Malgré
leur dégradation, ils apparaissent très vivants. Le premier relève la tête ; le second, le
cou tendu, broute l’herbe du sol ; le dernier se retourne et appuie la bouche sur le dos
du voisin comme pour le mordre. Les crinières et les queues sont soigneusement tressées.
Pour composer ce tableau, l’artiste n’a pas cherché bien loin ses modèles ; il les a pris
sur la place du marché. La race est encore de nos jours toute pareille ; grosse croupe
ramassée, forte encolure, large sabot, jambes courtes et épaisses. Ce morceau est d’un
réalisme très vigoureux.
Dans le compartiment central, la Vierge est assise sur un trône ouvragé, sans pro-
fondeur ; ses pieds reposent sur un tabouret plat, dont la forme diffère de celui d’Hé-
rode. Il est octogonal et les arcatures romanes moins hautes qui le soutiennent, sont
séparées par deux trous au lieu d’un. La Vierge a une altitude royale, elle tient son fils
étroitement serré dans ses bras. Devant elle, les rois Mages, véritables grands seigneurs,
sont groupés ; le premier va s’agenouiller, le second esquisse le geste, le troisième est
debout. Leur manteau, attaché sur l’épaule droite, laisse voir une tunique courte, fixée
autour de la taille par une ceinture que dissimule un pli. Ils ont des souliers et des
chausses. De la main droite, enveloppée dans un pan de leur manteau, ils présentent
leur offrande. Ce geste dessine une belle ligne courbe que forment les ombres et les
reliefs des manches et des étoffes que soulèvent les mains ; cette ligne se prolonge jus-
qu’aux pieds de l’Enfant. Au-dessus de la silhouette des Mages, une étoile à sept rayons
s’épanouit, comme les pétales d’une marguerite.
Il faut, pour bien juger ces deux dernières scènes, les rapprocher de deux scènes
identiques, représentées sur le célèbre linteau pentagonal de N. D. du port de Clermont.
Les chevaux des sculpteurs auvergnats paraissent en bois, leurs Mages sont sans pro-
portion et c’est aux reliquaires raides et métalliques de la région qu’ils ont emprunté le
siège, les plis de la robe et l’attitude de la Vierge.
La Nativité, logée trop à l’étroit dans le quatrième compartiment, a dû pour nous
présenter tous ses personnages les étager; elle est fort détériorée. On peut cependant
remarquer l’inspiration des traditions byzantines dans la figure de la vierge alitée ; le
lit de repos sur lequel elle est étendue forme une sorte de coque à contours saillants,
irréguliers, caractéristiques.
Enfin, l’Annonciation avec ses poses moins familières, ses étoffes trop lourdes, ses
personnages trop grands, diffère trop des autres scènes et n’a pas été exécutée par la
même main ; elle se rapproche beaucoup plus de la manière de l’artiste qui a sculpté le
linteau de la porte Sud. Elle présente une particularité: l’ange occupe, à droite, la
place habituelle de la Vierge. Nous pensons que le sculpteur, très respectueux, n’a pas
voulu situer à l’extrémité de son panneau un personnage aussi important que la Vierge.
Bien entendu celte sculpture n’est pas signée. A quelle école appartient elle ?
Quelle est sa date ?
113
ses fenêtres. Hérode est assis, les pieds sur un tabouret rond, bombé, que supportent
des arcades séparées par un trou. Le visage tourné de trois quarts, il regarde les Mages.
Ceux-ci debout, sans raideur, drapés dans leur manteau court, semblent converser. La
porte du palais sur laquelle ils s’appuient, très fouillée, donne une impression de profon-
deur peu commune.
La scène suivante nous montre les chevaux dans l’attente de leur maître, Malgré
leur dégradation, ils apparaissent très vivants. Le premier relève la tête ; le second, le
cou tendu, broute l’herbe du sol ; le dernier se retourne et appuie la bouche sur le dos
du voisin comme pour le mordre. Les crinières et les queues sont soigneusement tressées.
Pour composer ce tableau, l’artiste n’a pas cherché bien loin ses modèles ; il les a pris
sur la place du marché. La race est encore de nos jours toute pareille ; grosse croupe
ramassée, forte encolure, large sabot, jambes courtes et épaisses. Ce morceau est d’un
réalisme très vigoureux.
Dans le compartiment central, la Vierge est assise sur un trône ouvragé, sans pro-
fondeur ; ses pieds reposent sur un tabouret plat, dont la forme diffère de celui d’Hé-
rode. Il est octogonal et les arcatures romanes moins hautes qui le soutiennent, sont
séparées par deux trous au lieu d’un. La Vierge a une altitude royale, elle tient son fils
étroitement serré dans ses bras. Devant elle, les rois Mages, véritables grands seigneurs,
sont groupés ; le premier va s’agenouiller, le second esquisse le geste, le troisième est
debout. Leur manteau, attaché sur l’épaule droite, laisse voir une tunique courte, fixée
autour de la taille par une ceinture que dissimule un pli. Ils ont des souliers et des
chausses. De la main droite, enveloppée dans un pan de leur manteau, ils présentent
leur offrande. Ce geste dessine une belle ligne courbe que forment les ombres et les
reliefs des manches et des étoffes que soulèvent les mains ; cette ligne se prolonge jus-
qu’aux pieds de l’Enfant. Au-dessus de la silhouette des Mages, une étoile à sept rayons
s’épanouit, comme les pétales d’une marguerite.
Il faut, pour bien juger ces deux dernières scènes, les rapprocher de deux scènes
identiques, représentées sur le célèbre linteau pentagonal de N. D. du port de Clermont.
Les chevaux des sculpteurs auvergnats paraissent en bois, leurs Mages sont sans pro-
portion et c’est aux reliquaires raides et métalliques de la région qu’ils ont emprunté le
siège, les plis de la robe et l’attitude de la Vierge.
La Nativité, logée trop à l’étroit dans le quatrième compartiment, a dû pour nous
présenter tous ses personnages les étager; elle est fort détériorée. On peut cependant
remarquer l’inspiration des traditions byzantines dans la figure de la vierge alitée ; le
lit de repos sur lequel elle est étendue forme une sorte de coque à contours saillants,
irréguliers, caractéristiques.
Enfin, l’Annonciation avec ses poses moins familières, ses étoffes trop lourdes, ses
personnages trop grands, diffère trop des autres scènes et n’a pas été exécutée par la
même main ; elle se rapproche beaucoup plus de la manière de l’artiste qui a sculpté le
linteau de la porte Sud. Elle présente une particularité: l’ange occupe, à droite, la
place habituelle de la Vierge. Nous pensons que le sculpteur, très respectueux, n’a pas
voulu situer à l’extrémité de son panneau un personnage aussi important que la Vierge.
Bien entendu celte sculpture n’est pas signée. A quelle école appartient elle ?
Quelle est sa date ?