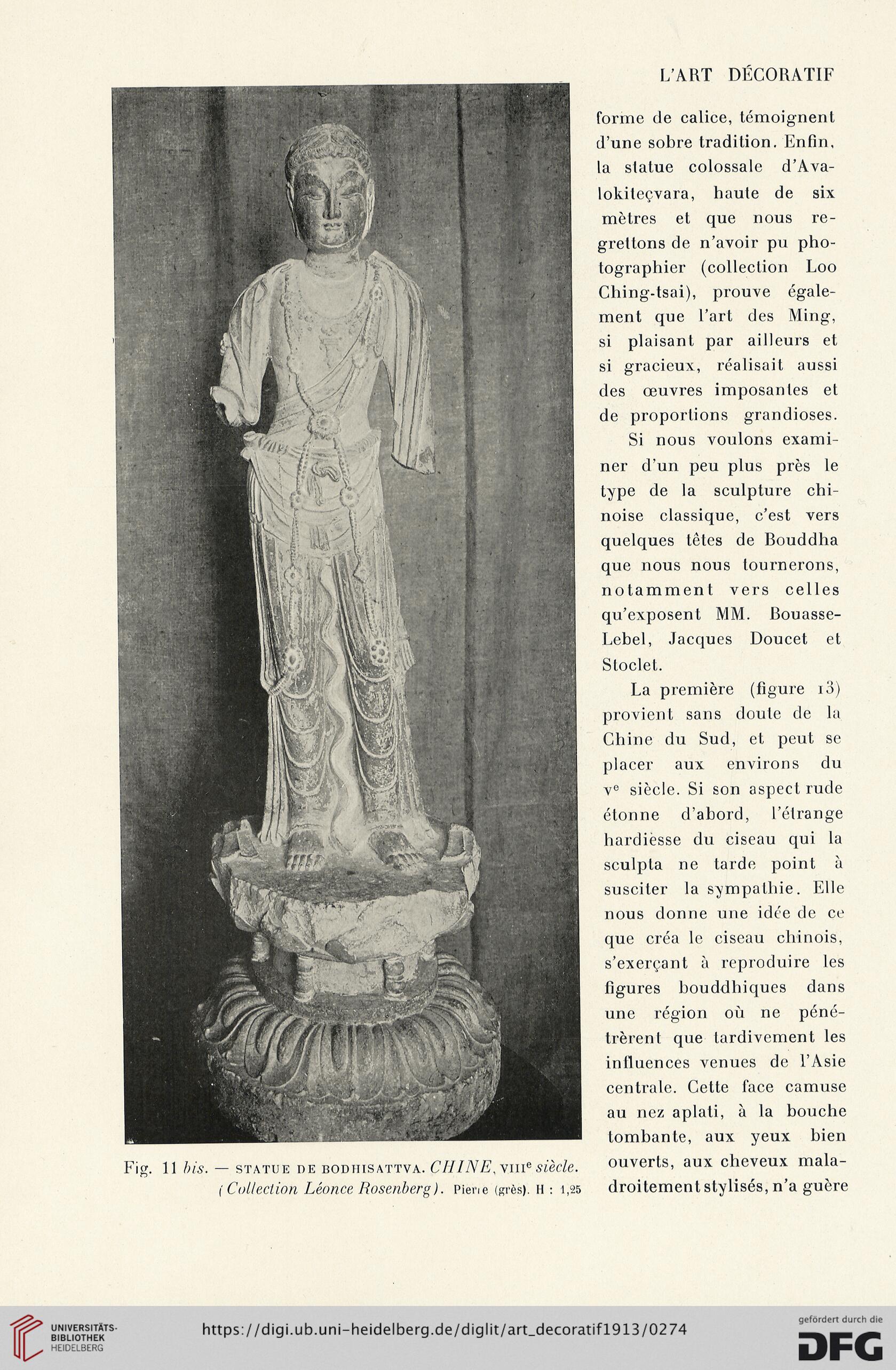L’ART DÉCORATIF
Fig. 11 bis. — STATUE DE BODIIISATTVA. CHINE.VIIIe siècle.
(Collection Léonce Rosenberg). Piene (grès). H : 1,25
forme de calice, témoignent
d’une sobre tradition. Enfin,
la statue colossale d’Ava-
lokiteçvara, haute de six
mètres et que nous re-
grettons de n’avoir pu pho-
tographier (collection Loo
Ching-tsai), prouve égale-
ment que l’art des Ming,
si plaisant par ailleurs et
si gracieux, réalisait aussi
des œuvres imposantes et
de proportions grandioses.
Si nous voulons exami-
ner d’un peu plus près le
type de la sculpture chi-
noise classique, c’est vers
quelques têtes de Bouddha
que nous nous tournerons,
notamment vers celles
qu’exposent MM. Bouasse-
Lebel, Jacques Doucet et
Stoclet.
La première (figure i3)
provient sans doute de la
Chine du Sud, et peut se
placer aux environs du
ve siècle. Si son aspect rude
étonne d’abord, l’étrange
hardiesse du ciseau qui la
sculpta ne larde point à
susciter la sympathie. Elle
nous donne une idée de ce
que créa le ciseau chinois,
s’exerçant à reproduire les
figures bouddhiques dans
une région où ne péné-
trèrent que tardivement les
influences venues de l’Asie
centrale. Cette face camuse
au nez aplati, à la bouche
tombante, aux yeux bien
ouverts, aux cheveux mala-
droitement stylisés, n’a guère
Fig. 11 bis. — STATUE DE BODIIISATTVA. CHINE.VIIIe siècle.
(Collection Léonce Rosenberg). Piene (grès). H : 1,25
forme de calice, témoignent
d’une sobre tradition. Enfin,
la statue colossale d’Ava-
lokiteçvara, haute de six
mètres et que nous re-
grettons de n’avoir pu pho-
tographier (collection Loo
Ching-tsai), prouve égale-
ment que l’art des Ming,
si plaisant par ailleurs et
si gracieux, réalisait aussi
des œuvres imposantes et
de proportions grandioses.
Si nous voulons exami-
ner d’un peu plus près le
type de la sculpture chi-
noise classique, c’est vers
quelques têtes de Bouddha
que nous nous tournerons,
notamment vers celles
qu’exposent MM. Bouasse-
Lebel, Jacques Doucet et
Stoclet.
La première (figure i3)
provient sans doute de la
Chine du Sud, et peut se
placer aux environs du
ve siècle. Si son aspect rude
étonne d’abord, l’étrange
hardiesse du ciseau qui la
sculpta ne larde point à
susciter la sympathie. Elle
nous donne une idée de ce
que créa le ciseau chinois,
s’exerçant à reproduire les
figures bouddhiques dans
une région où ne péné-
trèrent que tardivement les
influences venues de l’Asie
centrale. Cette face camuse
au nez aplati, à la bouche
tombante, aux yeux bien
ouverts, aux cheveux mala-
droitement stylisés, n’a guère