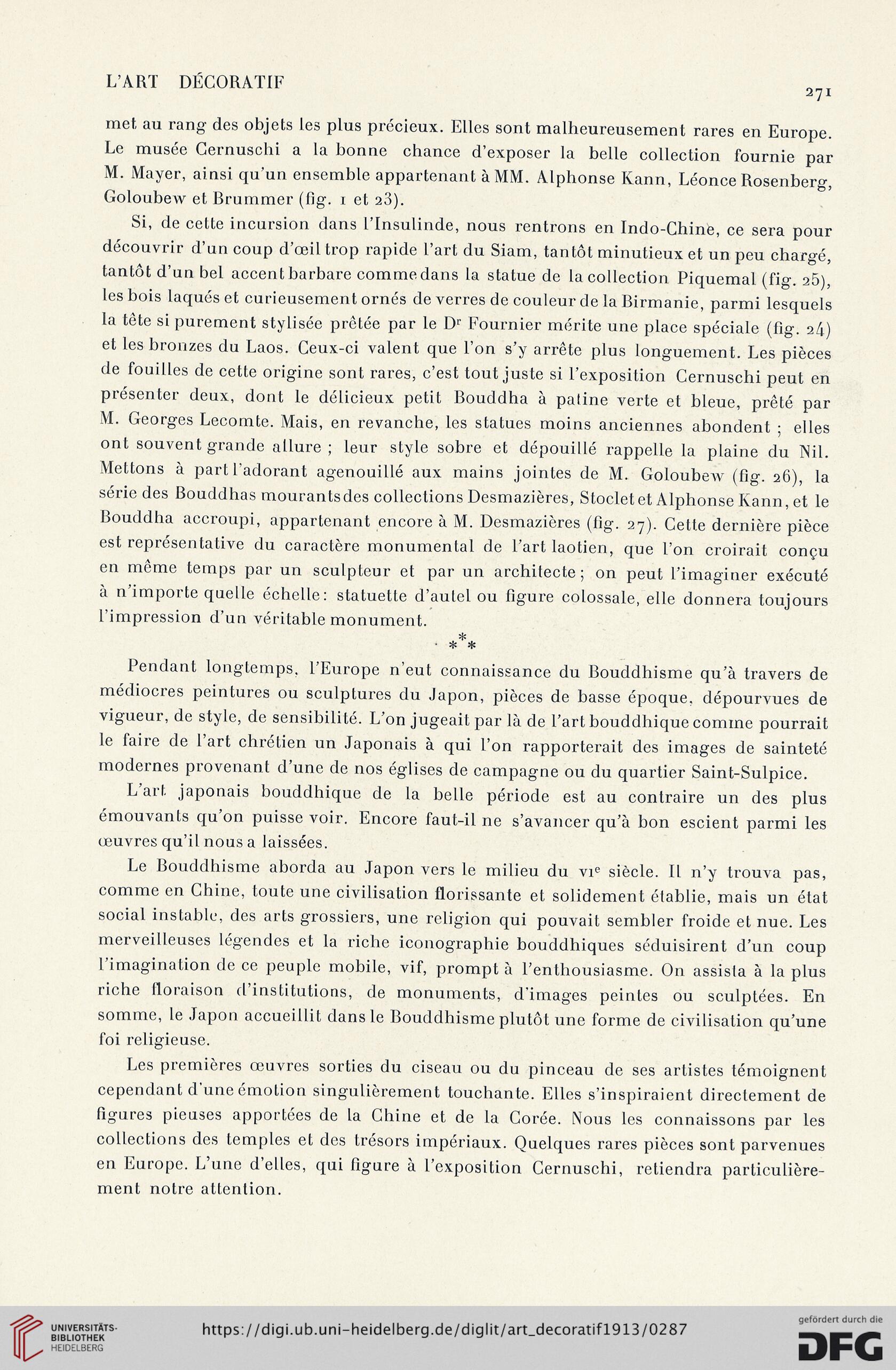L’ART DÉCORATIF
271
met au rang des objets Les plus précieux. Elles sont malheureusement rares en Europe.
Le musée Cernuschi a la bonne chance d’exposer la belle collection fournie par
M. Mayer, ainsi qu’un ensemble appartenant à MM. Alphonse Kann, Léonce Rosenberg,
Goloubew et Brummer (fig. 1 et 23).
Si, de cette incursion dans l’Insulinde, nous rentrons en Indo-Chine, ce sera pour
découvrir d’un coup d’œil trop rapide l’art du Siam, tantôt minutieux et un peu chargé,
tantôt d’un bel accent barbare comme dans la statue de la collection Piquemal (fig. 25),
les bois laqués et curieusement ornés de verres de couleur de la Birmanie, parmi lesquels
la tête si purement stylisée prêtée par le Dr Fournier mérite une place spéciale (fig. 2à)
et les bronzes du Laos. Ceux-ci valent que l’on s’y arrête plus longuement. Les pièces
de fouilles de cette origine sont rares, c’est tout juste si l’exposition Cernuschi peut en
présenter deux, dont le délicieux petit Bouddha à patine verte et bleue, prêté par
M. Georges Lecomte. Mais, en revanche, les statues moins anciennes abondent ; elles
ont souvent grande allure ; leur style sobre et dépouillé rappelle la plaine du Nil.
Mettons à part l’adorant agenouillé aux mains jointes de M. Goloubew (fig. 26), la
série des Bouddhas mourantsdes collections Desmazières, Stocletet Alphonse Kann, et le
Bouddha accroupi, appartenant encore à M. Desmazières (fig. 27). Cette dernière pièce
est représentative du caractère monumental de l’art laotien, que l’on croirait conçu
en même temps par un sculpteur et par un architecte; on peut l’imaginer exécuté
à n’importe quelle échelle: statuette d’autel ou figure colossale, elle donnera toujours
l’impression d’un véritable monument.
*
■ * *
Pendant longtemps, l’Europe n’eut connaissance du Bouddhisme qu’à travers de
médiocres peintures ou sculptures du Japon, pièces de basse époque, dépourvues de
vigueur, de style, de sensibilité. L’on jugeait par là de l’art bouddhique comme pourrait
le faire de l’art chrétien un Japonais à qui l’on rapporterait des images de sainteté
modernes provenant d’une de nos églises de campagne ou du quartier Saint-Sulpice.
L’art japonais bouddhique de la belle période est au contraire un des plus
émouvants qu’on puisse voir. Encore faut-il ne s’avancer qu’à bon escient parmi les
œuvres qu’il nous a laissées.
Le Bouddhisme aborda au Japon vers le milieu du vie siècle. Il n’y trouva pas,
comme en Chine, toute une civilisation florissante et solidement établie, mais un état
social instable, des arts grossiers, une religion qui pouvait sembler froide et nue. Les
merveilleuses légendes et la riche iconographie bouddhiques séduisirent d’un coup
l’imagination de ce peuple mobile, vif, prompt à l’enthousiasme. On assista à la plus
riche floraison d’institutions, de monuments, d'images peintes ou sculptées. En
somme, le Japon accueillit dans le Bouddhisme plutôt une forme de civilisation qu’une
foi religieuse.
Les premières œuvres sorties du ciseau ou du pinceau de ses artistes témoignent
cependant d'une émotion singulièrement touchante. Elles s’inspiraient directement de
figures pieuses apportées de la Chine et de la Corée. Nous les connaissons par les
collections des temples et des trésors impériaux. Quelques rares pièces sont parvenues
en Europe. L’une d’elles, qui figure à l’exposition Cernuschi, retiendra particulière-
ment notre attention.
271
met au rang des objets Les plus précieux. Elles sont malheureusement rares en Europe.
Le musée Cernuschi a la bonne chance d’exposer la belle collection fournie par
M. Mayer, ainsi qu’un ensemble appartenant à MM. Alphonse Kann, Léonce Rosenberg,
Goloubew et Brummer (fig. 1 et 23).
Si, de cette incursion dans l’Insulinde, nous rentrons en Indo-Chine, ce sera pour
découvrir d’un coup d’œil trop rapide l’art du Siam, tantôt minutieux et un peu chargé,
tantôt d’un bel accent barbare comme dans la statue de la collection Piquemal (fig. 25),
les bois laqués et curieusement ornés de verres de couleur de la Birmanie, parmi lesquels
la tête si purement stylisée prêtée par le Dr Fournier mérite une place spéciale (fig. 2à)
et les bronzes du Laos. Ceux-ci valent que l’on s’y arrête plus longuement. Les pièces
de fouilles de cette origine sont rares, c’est tout juste si l’exposition Cernuschi peut en
présenter deux, dont le délicieux petit Bouddha à patine verte et bleue, prêté par
M. Georges Lecomte. Mais, en revanche, les statues moins anciennes abondent ; elles
ont souvent grande allure ; leur style sobre et dépouillé rappelle la plaine du Nil.
Mettons à part l’adorant agenouillé aux mains jointes de M. Goloubew (fig. 26), la
série des Bouddhas mourantsdes collections Desmazières, Stocletet Alphonse Kann, et le
Bouddha accroupi, appartenant encore à M. Desmazières (fig. 27). Cette dernière pièce
est représentative du caractère monumental de l’art laotien, que l’on croirait conçu
en même temps par un sculpteur et par un architecte; on peut l’imaginer exécuté
à n’importe quelle échelle: statuette d’autel ou figure colossale, elle donnera toujours
l’impression d’un véritable monument.
*
■ * *
Pendant longtemps, l’Europe n’eut connaissance du Bouddhisme qu’à travers de
médiocres peintures ou sculptures du Japon, pièces de basse époque, dépourvues de
vigueur, de style, de sensibilité. L’on jugeait par là de l’art bouddhique comme pourrait
le faire de l’art chrétien un Japonais à qui l’on rapporterait des images de sainteté
modernes provenant d’une de nos églises de campagne ou du quartier Saint-Sulpice.
L’art japonais bouddhique de la belle période est au contraire un des plus
émouvants qu’on puisse voir. Encore faut-il ne s’avancer qu’à bon escient parmi les
œuvres qu’il nous a laissées.
Le Bouddhisme aborda au Japon vers le milieu du vie siècle. Il n’y trouva pas,
comme en Chine, toute une civilisation florissante et solidement établie, mais un état
social instable, des arts grossiers, une religion qui pouvait sembler froide et nue. Les
merveilleuses légendes et la riche iconographie bouddhiques séduisirent d’un coup
l’imagination de ce peuple mobile, vif, prompt à l’enthousiasme. On assista à la plus
riche floraison d’institutions, de monuments, d'images peintes ou sculptées. En
somme, le Japon accueillit dans le Bouddhisme plutôt une forme de civilisation qu’une
foi religieuse.
Les premières œuvres sorties du ciseau ou du pinceau de ses artistes témoignent
cependant d'une émotion singulièrement touchante. Elles s’inspiraient directement de
figures pieuses apportées de la Chine et de la Corée. Nous les connaissons par les
collections des temples et des trésors impériaux. Quelques rares pièces sont parvenues
en Europe. L’une d’elles, qui figure à l’exposition Cernuschi, retiendra particulière-
ment notre attention.