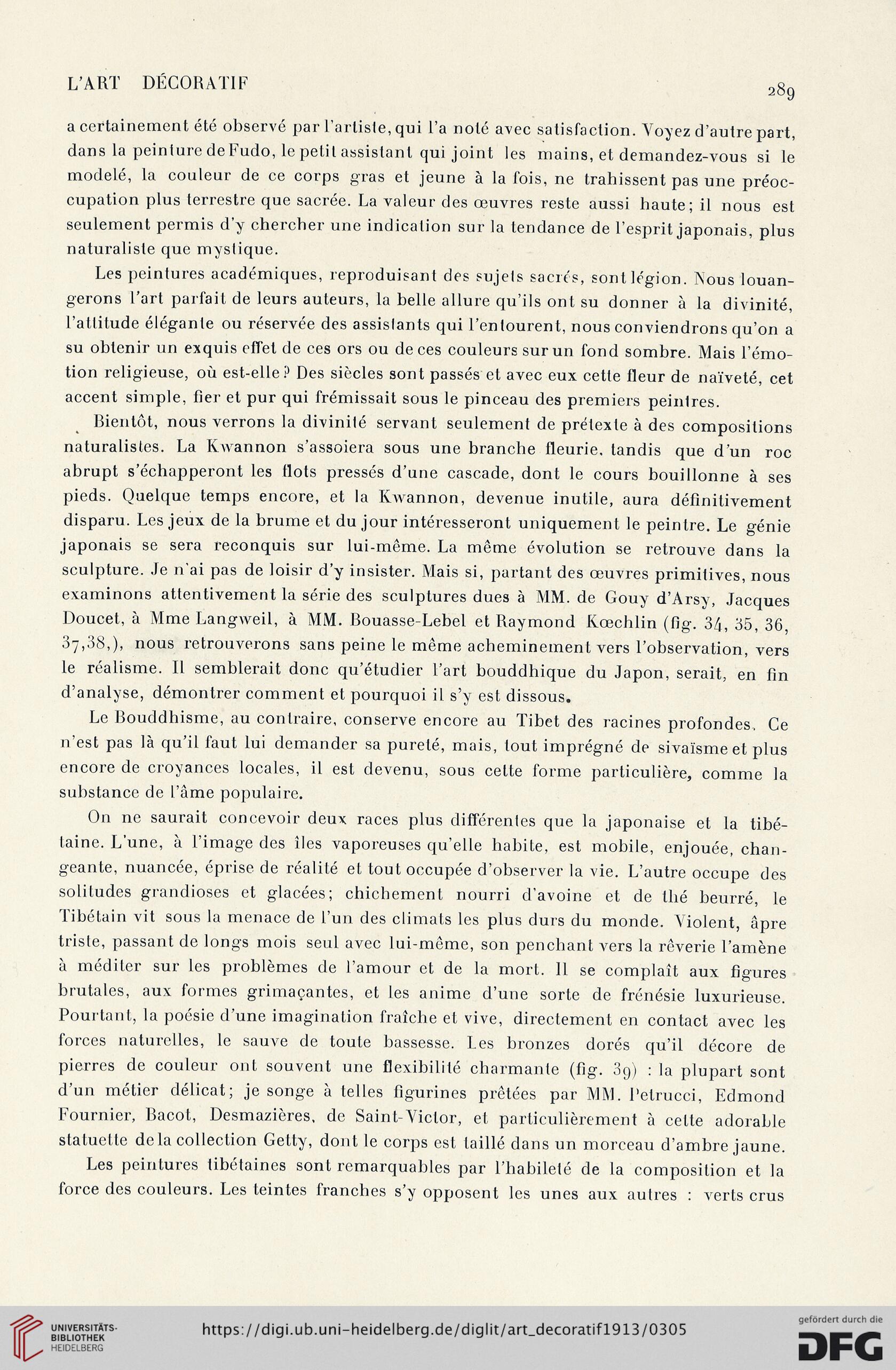L’ART DÉCORATIF
289
a certainement été observé par l’artiste, qui l’a noté avec satisfaction. Voyez d’autre part,
dans la peinture deFudo, le petit assistant qui joint les mains, et demandez-vous si le
modelé, la couleur de ce corps gras et jeune à la fois, ne trahissent pas une préoc-
cupation plus terrestre que sacrée. La valeur des œuvres reste aussi haute; il nous est
seulement permis d’y chercher une indication sur la tendance de l’esprit japonais, plus
naturaliste que mystique.
Les peintures académiques, reproduisant des sujets sacrés, sont légion. Vous louan-
gerons l’art parfait de leurs auteurs, la belle allure qu’ils ont su donner à la divinité,
l’altitude élégante ou réservée des assistants qui l’entourent, nous conviendrons qu’on a
su obtenir un exquis effet de ces ors ou de ces couleurs sur un fond sombre. Mais l’émo-
tion religieuse, où est-elle P Des siècles sont passés et avec eux cette fleur de naïveté, cet
accent simple, fier et pur qui frémissait sous le pinceau des premiers peintres.
Bientôt, nous verrons la divinité servant seulement de prétexte à des compositions
naturalistes. La Kwannon s’assoiera sous une branche fleurie, tandis que d’un roc
abrupt s’échapperont les flots pressés d’une cascade, dont le cours bouillonne à ses
pieds. Quelque temps encore, et la Kwannon, devenue inutile, aura définitivement
disparu. Les jeux de la brume et du jour intéresseront uniquement le peintre. Le génie
japonais se sera reconquis sur lui-même. La même évolution se retrouve dans la
sculpture, .le n’ai pas de loisir d’y insister. Mais si, partant des œuvres primitives, nous
examinons attentivement la série des sculptures dues à MM. de Gouy d’Arsy, Jacques
Doucet, à Mme Langweil, à MM. Bouasse-Lebel et Raymond Kœchlin (fig. 34, 35, 36,
37,38,), nous retrouverons sans peine le même acheminement vers l’observation, vers
le réalisme. Il semblerait donc qu’étudier l’art bouddhique du Japon, serait, en fin
d’analyse, démontrer comment et pourquoi il s’y est dissous.
Le Bouddhisme, au contraire, conserve encore au Tibet des racines profondes. Ce
n’est pas là qu’il faut lui demander sa pureté, mais, tout imprégné de sivaïsme et plus
encore de croyances locales, il est devenu, sous celte forme particulière, comme la
substance de l’âme populaire.
On ne saurait concevoir deux races plus différentes que la japonaise et la tibé-
taine. L’une, à l’image des îles vaporeuses qu’elle habile, est mobile, enjouée, chan-
geante, nuancée, éprise de réalité et tout occupée d’observer la vie. L’autre occupe des
solitudes grandioses et glacées; chichement nourri d’avoine et de thé beurré, le
Tibétain vit sous la menace de l’un des climats les plus durs du monde. Violent, âpre
triste, passant de longs mois seul avec lui-même, son penchant vers la rêverie l’amène
à méditer sur les problèmes de l’amour et de la mort. 11 se complaît aux figures
brutales, aux formes grimaçantes, et Les anime d’une sorte de frénésie luxurieuse.
Pourtant, la poésie d’une imagination fraîche et vive, directement en contact avec les
forces naturelles, le sauve de toute bassesse. Les bronzes dorés qu’il décore de
pierres de couleur ont souvent une flexibilité charmante (fig. 3g) : la plupart sont
d’un métier délicat; je songe à telles figurines prêtées par MM. Pétrucci, Edmond
Fournier, Bacot, Desmazières, de Saint-Victor, et particulièrement à celte adorable
statuette delà collection Getty, dont le corps est taillé dans un morceau d’ambre jaune.
Les peintures tibétaines sont remarquables par l’habileté de la composition et la
force des couleurs. Les teintes franches s’y opposent les unes aux autres : verts crus
289
a certainement été observé par l’artiste, qui l’a noté avec satisfaction. Voyez d’autre part,
dans la peinture deFudo, le petit assistant qui joint les mains, et demandez-vous si le
modelé, la couleur de ce corps gras et jeune à la fois, ne trahissent pas une préoc-
cupation plus terrestre que sacrée. La valeur des œuvres reste aussi haute; il nous est
seulement permis d’y chercher une indication sur la tendance de l’esprit japonais, plus
naturaliste que mystique.
Les peintures académiques, reproduisant des sujets sacrés, sont légion. Vous louan-
gerons l’art parfait de leurs auteurs, la belle allure qu’ils ont su donner à la divinité,
l’altitude élégante ou réservée des assistants qui l’entourent, nous conviendrons qu’on a
su obtenir un exquis effet de ces ors ou de ces couleurs sur un fond sombre. Mais l’émo-
tion religieuse, où est-elle P Des siècles sont passés et avec eux cette fleur de naïveté, cet
accent simple, fier et pur qui frémissait sous le pinceau des premiers peintres.
Bientôt, nous verrons la divinité servant seulement de prétexte à des compositions
naturalistes. La Kwannon s’assoiera sous une branche fleurie, tandis que d’un roc
abrupt s’échapperont les flots pressés d’une cascade, dont le cours bouillonne à ses
pieds. Quelque temps encore, et la Kwannon, devenue inutile, aura définitivement
disparu. Les jeux de la brume et du jour intéresseront uniquement le peintre. Le génie
japonais se sera reconquis sur lui-même. La même évolution se retrouve dans la
sculpture, .le n’ai pas de loisir d’y insister. Mais si, partant des œuvres primitives, nous
examinons attentivement la série des sculptures dues à MM. de Gouy d’Arsy, Jacques
Doucet, à Mme Langweil, à MM. Bouasse-Lebel et Raymond Kœchlin (fig. 34, 35, 36,
37,38,), nous retrouverons sans peine le même acheminement vers l’observation, vers
le réalisme. Il semblerait donc qu’étudier l’art bouddhique du Japon, serait, en fin
d’analyse, démontrer comment et pourquoi il s’y est dissous.
Le Bouddhisme, au contraire, conserve encore au Tibet des racines profondes. Ce
n’est pas là qu’il faut lui demander sa pureté, mais, tout imprégné de sivaïsme et plus
encore de croyances locales, il est devenu, sous celte forme particulière, comme la
substance de l’âme populaire.
On ne saurait concevoir deux races plus différentes que la japonaise et la tibé-
taine. L’une, à l’image des îles vaporeuses qu’elle habile, est mobile, enjouée, chan-
geante, nuancée, éprise de réalité et tout occupée d’observer la vie. L’autre occupe des
solitudes grandioses et glacées; chichement nourri d’avoine et de thé beurré, le
Tibétain vit sous la menace de l’un des climats les plus durs du monde. Violent, âpre
triste, passant de longs mois seul avec lui-même, son penchant vers la rêverie l’amène
à méditer sur les problèmes de l’amour et de la mort. 11 se complaît aux figures
brutales, aux formes grimaçantes, et Les anime d’une sorte de frénésie luxurieuse.
Pourtant, la poésie d’une imagination fraîche et vive, directement en contact avec les
forces naturelles, le sauve de toute bassesse. Les bronzes dorés qu’il décore de
pierres de couleur ont souvent une flexibilité charmante (fig. 3g) : la plupart sont
d’un métier délicat; je songe à telles figurines prêtées par MM. Pétrucci, Edmond
Fournier, Bacot, Desmazières, de Saint-Victor, et particulièrement à celte adorable
statuette delà collection Getty, dont le corps est taillé dans un morceau d’ambre jaune.
Les peintures tibétaines sont remarquables par l’habileté de la composition et la
force des couleurs. Les teintes franches s’y opposent les unes aux autres : verts crus