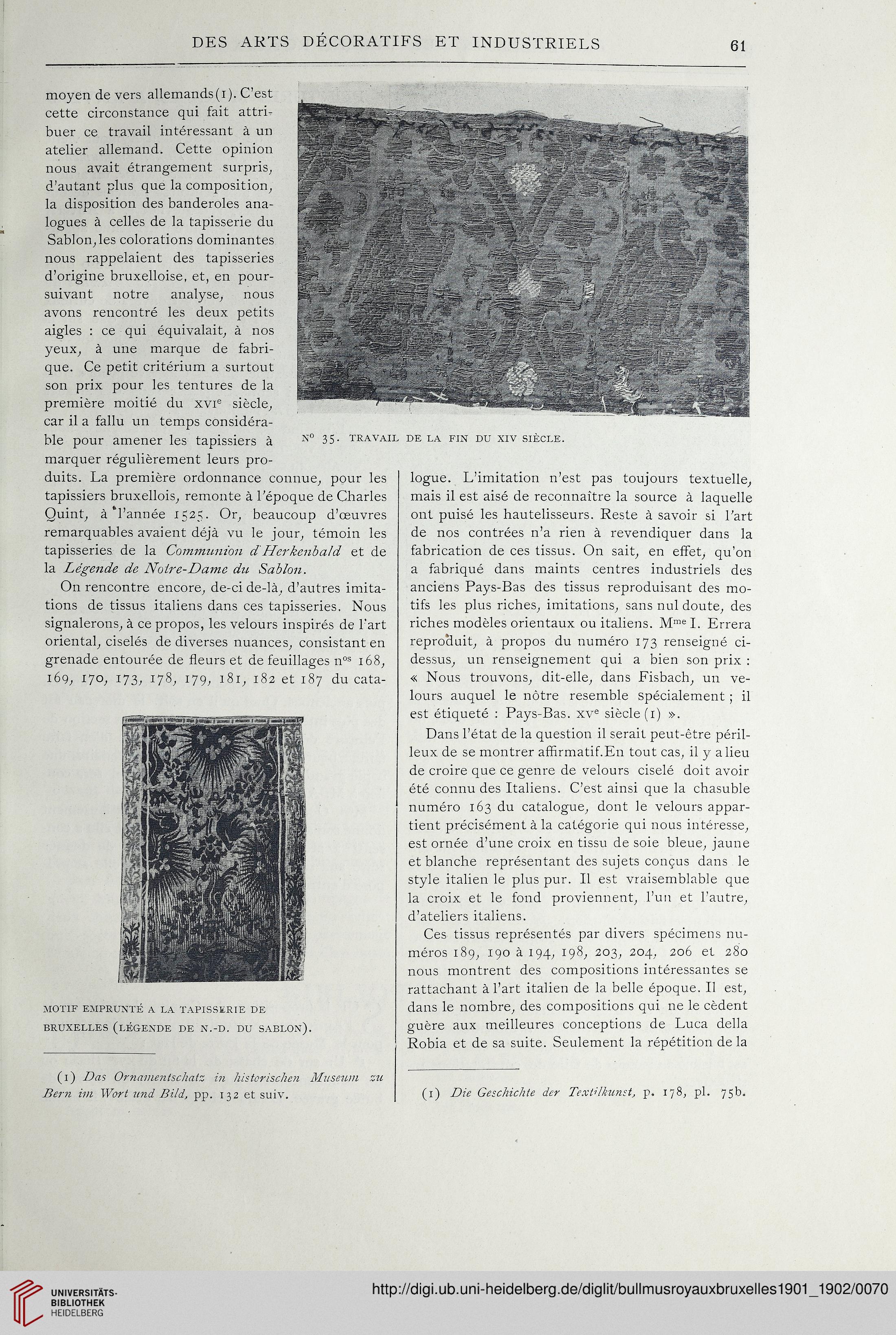DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS
61
moyen de vers allemands(i). C’est
cette circonstance qui fait attri-
buer ce travail intéressant à un
atelier allemand. Cette opinion
nous avait étrangement surpris,
d’autant plus que la composition,
la disposition des banderoles ana-
logues à celles de la tapisserie du
Sablon, les colorations dominantes
nous rappelaient des tapisseries
d’origine bruxelloise, et, en pour-
suivant notre analyse, nous
avons rencontré les deux petits
aigles : ce qui équivalait, à nos
yeux, à une marque de fabri-
que. Ce petit critérium a surtout
son prix pour les tentures de la
première moitié du xvie siècle,
car il a fallu un temps considéra-
ble pour amener les tapissiers à
marquer régulièrement leurs pro-
duits. La première ordonnance connue, pour les
tapissiers bruxellois, remonte à l’époque de Charles
Quint, à Tannée 1525- Or, beaucoup d’œuvres
remarquables avaient déjà vu le jour, témoin les
tapisseries de la Communion d Herkenbald et de
la Légende de Noire-Dame du Sablon.
On rencontre encore, de-ci de-là, d’autres imita-
tions de tissus italiens dans ces tapisseries. Nous
signalerons, à ce propos, les velours inspirés de l'art
oriental, ciselés de diverses nuances, consistant en
grenade entourée de fleurs et de feuillages nos 168,
169, 170, 173, 178, 179, 181, 182 et 187 du cata-
MOTIF EMPRUNTÉ A LA TAPISSERIE DE
BRUXELLES (LÉGENDE DE N.-D. DU SABLON).
(1) Das Ornamentschatz in historischen Muséum zu
Berzi im Wort und Bild, pp. 132 et suiv.
DE LA FIN DU XIV SIÈCLE.
logue. L’imitation n’est pas toujours textuelle,
mais il est aisé de reconnaître la source à laquelle
ont puisé les hautelisseurs. Reste à savoir si l’art
de nos contrées n’a rien à revendiquer dans la
fabrication de ces tissus. On sait, en effet, qu’on
a fabriqué dans maints centres industriels des
anciens Pays-Bas des tissus reproduisant des mo-
tifs les plus riches, imitations, sans nul doute, des
riches modèles orientaux ou italiens. MmeI. Errera
reproduit, à propos du numéro 173 renseigné ci-
dessus, un renseignement qui a bien son prix :
« Nous trouvons, dit-elle, dans Fisbach, un ve-
lours auquel le nôtre resemble spécialement ; il
est étiqueté : Pays-Bas. xve siècle (1) ».
Dans l’état de la question il serait peut-être péril-
leux de se montrer affirmatif.En tout cas, il y a lieu
de croire que ce genre de velours ciselé doit avoir
été connu des Italiens. C’est ainsi que la chasuble
numéro 163 du catalogue, dont le velours appar-
tient précisément à la catégorie qui nous intéresse,
est ornée d’une croix en tissu de soie bleue, jaune
et blanche représentant des sujets conçus dans le
style italien le plus pur. Il est vraisemblable que
la croix et le fond proviennent, l’un et l’autre,
d’ateliers italiens.
Ces tissus représentés par divers spécimens nu-
méros 189, 190 à 194, 198, 203, 204, 206 et 280
nous montrent des compositions intéressantes se
rattachant à l’art italien de la belle époque. Il est,
dans le nombre, des compositions qui ne le cèdent
guère aux meilleures conceptions de Luca délia
Robia et de sa suite. Seulement la répétition de la
N° 35. TRAVAIL
(1) Die Geschichte der Texdlkunst, p. 178, pl. 75b.
61
moyen de vers allemands(i). C’est
cette circonstance qui fait attri-
buer ce travail intéressant à un
atelier allemand. Cette opinion
nous avait étrangement surpris,
d’autant plus que la composition,
la disposition des banderoles ana-
logues à celles de la tapisserie du
Sablon, les colorations dominantes
nous rappelaient des tapisseries
d’origine bruxelloise, et, en pour-
suivant notre analyse, nous
avons rencontré les deux petits
aigles : ce qui équivalait, à nos
yeux, à une marque de fabri-
que. Ce petit critérium a surtout
son prix pour les tentures de la
première moitié du xvie siècle,
car il a fallu un temps considéra-
ble pour amener les tapissiers à
marquer régulièrement leurs pro-
duits. La première ordonnance connue, pour les
tapissiers bruxellois, remonte à l’époque de Charles
Quint, à Tannée 1525- Or, beaucoup d’œuvres
remarquables avaient déjà vu le jour, témoin les
tapisseries de la Communion d Herkenbald et de
la Légende de Noire-Dame du Sablon.
On rencontre encore, de-ci de-là, d’autres imita-
tions de tissus italiens dans ces tapisseries. Nous
signalerons, à ce propos, les velours inspirés de l'art
oriental, ciselés de diverses nuances, consistant en
grenade entourée de fleurs et de feuillages nos 168,
169, 170, 173, 178, 179, 181, 182 et 187 du cata-
MOTIF EMPRUNTÉ A LA TAPISSERIE DE
BRUXELLES (LÉGENDE DE N.-D. DU SABLON).
(1) Das Ornamentschatz in historischen Muséum zu
Berzi im Wort und Bild, pp. 132 et suiv.
DE LA FIN DU XIV SIÈCLE.
logue. L’imitation n’est pas toujours textuelle,
mais il est aisé de reconnaître la source à laquelle
ont puisé les hautelisseurs. Reste à savoir si l’art
de nos contrées n’a rien à revendiquer dans la
fabrication de ces tissus. On sait, en effet, qu’on
a fabriqué dans maints centres industriels des
anciens Pays-Bas des tissus reproduisant des mo-
tifs les plus riches, imitations, sans nul doute, des
riches modèles orientaux ou italiens. MmeI. Errera
reproduit, à propos du numéro 173 renseigné ci-
dessus, un renseignement qui a bien son prix :
« Nous trouvons, dit-elle, dans Fisbach, un ve-
lours auquel le nôtre resemble spécialement ; il
est étiqueté : Pays-Bas. xve siècle (1) ».
Dans l’état de la question il serait peut-être péril-
leux de se montrer affirmatif.En tout cas, il y a lieu
de croire que ce genre de velours ciselé doit avoir
été connu des Italiens. C’est ainsi que la chasuble
numéro 163 du catalogue, dont le velours appar-
tient précisément à la catégorie qui nous intéresse,
est ornée d’une croix en tissu de soie bleue, jaune
et blanche représentant des sujets conçus dans le
style italien le plus pur. Il est vraisemblable que
la croix et le fond proviennent, l’un et l’autre,
d’ateliers italiens.
Ces tissus représentés par divers spécimens nu-
méros 189, 190 à 194, 198, 203, 204, 206 et 280
nous montrent des compositions intéressantes se
rattachant à l’art italien de la belle époque. Il est,
dans le nombre, des compositions qui ne le cèdent
guère aux meilleures conceptions de Luca délia
Robia et de sa suite. Seulement la répétition de la
N° 35. TRAVAIL
(1) Die Geschichte der Texdlkunst, p. 178, pl. 75b.