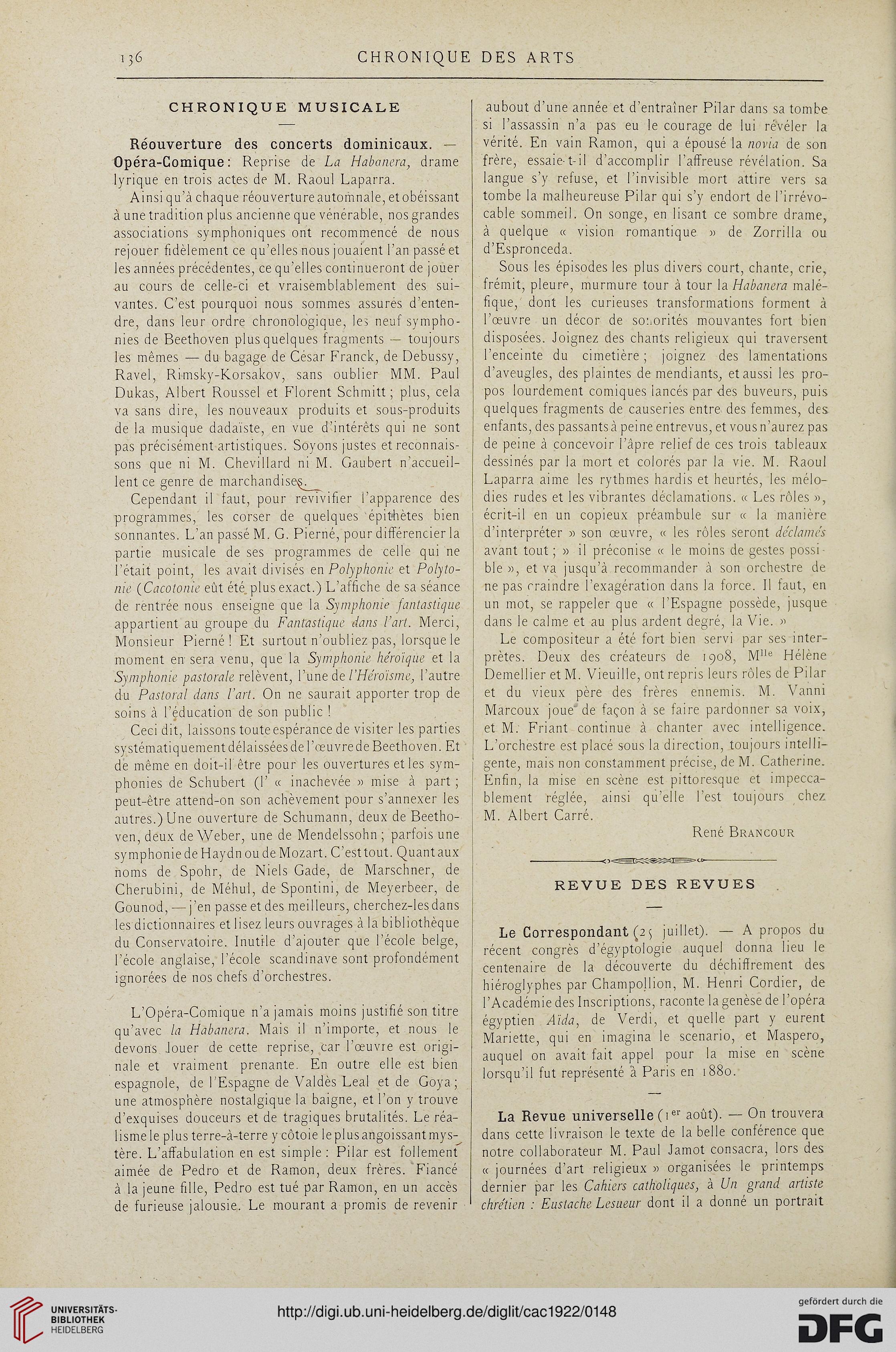'36
CHRONIQUE DES ARTS
CHRONIQUE MUSICALE
Réouverture des concerts dominicaux. —
Opéra-Comique : Reprise de La Habanera, drame
lyrique en trois actes de M. Raoul Laparra.
Ainsi qu’à chaque réouverture automnale, etobéissant
à une tradition plus ancienne que vénérable, nos grandes
associations symphoniques ont recommencé de nous
rejouer fidèlement ce qu’elles nous jouaient l’an passé et
les années précédentes, ce qu’elles continueront de jouer
au cours de celle-ci et vraisemblablement des sui-
vantes. C’est pourquoi nous sommes assurés d’enten-
dre, dans leur ordre chronologique, les neuf sympho-
nies de Beethoven plus quelques fragments — toujours
les mêmes — du bagage de César Franck, de Debussy,
Ravel, Rimsky-Korsakov, sans oublier MM. Paul
Dukas, Albert Roussel et Florent Schmitt ; plus, cela
va sans dire, les nouveaux produits et sous-produits
de la musique dadaïste, en vue d’intérêts qui ne sont
pas précisément artistiques. Soyons justes et reconnais-
sons que ni M. Chevillard ni M. Gaubert n’accueil-
lent ce genre de marchandise^.
Cependant il faut, pour revivifier l’apparence des
programmes, les corser de quelques 'épithètes bien
sonnantes. L’an passé M. G. Pierné, pour différencier la
partie musicale de ses programmes de celle qui ne
l’était point, les avait divisés en Polyphonie et Polyto-
nie (Cacotonie eût été. plus exact.) L’affiche de sa séance
de rentrée nous enseigne que la Symphonie fantastique
appartient au groupe du Fantastique dans l’art. Merci,
Monsieur Pierné! Et surtout n’oubliez pas, lorsque le
moment en-sera venu, que la Symphonie héroïque et la
Symphonie pastorale relèvent, l’une de l’Héroïsme, l’autre
du Pastoral dans l’art. On ne saurait apporter trop de
soins à l’éducation de son public !
Ceci dit, laissons toute espérance de visiter les parties
systématiquementdélaisséesdel’œuvredeBeethoven. Et
de même en doit-if être pour les ouvertures et les sym-
phonies de Schubert (F « inachevée » mise à part ;
peut-être attend-on son achèvement pour s’annexer les
autres.) Une ouverture de Schumann, deux de Beetho-
ven, deux de Weber, une de Mendelssohn ; parfois une
symphoniedeHaydnoudeMozart. C’esttout. Quantaux
noms de Spohr, de Niels Gade, de Marschner, de
Cherubini, de Méhul, de Spontini, de Meyerbeer, de
Gounod, — j’en passe et des meilleurs, cherchez-lesdans
les dictionnaires et lisez leurs ouvrages à la bibliothèque
du Conservatoire. Inutile d’ajouter que l’école belge,
l’école anglaise, l’école Scandinave sont profondément
ignorées de nos chefs d’orchestres.
L’Opéra-Comique n’a jamais moins justifié son titre
qu’avec la Habanera. Mais il n’importe, et nous le
devons Jouer de cette reprise, car l’œuvre est origi-
nale et vraiment prenante. En outre elle est bien
espagnole, de l’Espagne de Valdès Leal et de Goya;
une atmosphère nostalgique la baigne, et l’on y trouve
d’exquises douceurs et de tragiques brutalités. Le réa-
lisme le plus terre-à-terre y côtoie le plus angoissant mys-
tère. L’affabulation en est simple: Pilar est follement
aimée de Pedro et de Ramon, deux frères. Fiancé
à la jeune fille, Pedro est tué par Ramon, en un accès
de furieuse jalousie. Le mourant a promis de revenir
aubout d’une année et d’entraîner Pilar dans sa tombe
si l’assassin n’a pas eu le courage de lui révéler la
vérité. En vain Ramon, qui a épousé la novia de son
frère, essaie-1-il d’accomplir l’affreuse révélation. Sa
langue s’y refuse, et l’invisible mort attire vers sa
tombe la malheureuse Pilar qui s’y endort de l’irrévo-
cable sommeil. On songe, en lisant ce sombre drame,
à quelque « vision romantique » de Zorrilia ou
d’Espronceda.
Sous les épisodes les plus divers court, chante, crie,
frémit, pleure, murmure tour à tour la Habanera malé-
fique, dont les curieuses transformations forment à
l’œuvre un décor de sonorités mouvantes fort bien
disposées. Joignez des chants religieux qui traversent
l’enceinte du cimetière; joignez des lamentations
d’aveugles, des plaintes de mendiants, et aussi les pro-
pos lourdement comiques lancés par des buveurs, puis
quelques fragments de causeries entre des femmes, des
enfants, des passants à peine entrevus, et vous n’aurez pas
de peine à concevoir l’âpre relief de ces trois tableaux
dessinés par la mort et colorés par la vie. M. Raoul
Laparra aime les rythmes hardis et heurtés, les mélo-
dies rudes et les vibrantes déclamations. « Les rôles »,
écrit-il en un copieux préambule sur « la manière
d’interpréter » son œuvre, « les rôles seront déclamés
avant tout ; » il préconise « le moins de gestes possi-
ble », et va jusqu’à recommander à son orchestre de
ne pas craindre l’exagération dans la force. Il faut, en
un mot, se rappeler que « l’Espagne possède, jusque
dans le calme et au plus ardent degré, la Vie. »
Le compositeur a été fort bien servi par ses inter-
prètes. Deux des créateurs de 1908, MUe Hélène
Demellier et M. Vieuille, ont repris leurs rôles de Pilar
et du vieux père des frères ennemis. M. Vanni
Marcoux joue' de façon à se faire pardonner sa voix,
et M. Friant continue à chanter avec intelligence.
L’orchestre est placé sous la direction, toujours intelli-
gente, mais non constamment précise, de M. Catherine.
Enfin, la mise en scène est pittoresque et impecca-
blement réglée, ainsi qu’elle l’est toujours chez
M. Albert Carré.
René Brancour
REVUE DES REVUES
Le Correspondant (2 5 juillet). — A propos du
récent congrès d’égyptologie auquel donna lieu le
centenaire de la découverte du déchiffrement des
hiéroglyphes par Champollion, M. Henri Cordier, de
l’Académie des Inscriptions, raconte la genèse de l’opéra
égyptien Aida, de Verdi, et quelle part y eurent
Mariette, qui en imagina le scénario, et Maspero,
auquel on avait fait appel pour la mise en scène
lorsqu’il fut représenté à Paris en 1880.
La Revue universelle (ier août). — On trouvera
dans cette livraison le texte de la belle conférence que
notre collaborateur M. Paul Jamot consacra, lors des
« journées d’art religieux » organisées le printemps
dernier par les Cahiers catholiques, à Un grand artiste
chrétien : Eustache Lesueur dont il a donné un portrait
CHRONIQUE DES ARTS
CHRONIQUE MUSICALE
Réouverture des concerts dominicaux. —
Opéra-Comique : Reprise de La Habanera, drame
lyrique en trois actes de M. Raoul Laparra.
Ainsi qu’à chaque réouverture automnale, etobéissant
à une tradition plus ancienne que vénérable, nos grandes
associations symphoniques ont recommencé de nous
rejouer fidèlement ce qu’elles nous jouaient l’an passé et
les années précédentes, ce qu’elles continueront de jouer
au cours de celle-ci et vraisemblablement des sui-
vantes. C’est pourquoi nous sommes assurés d’enten-
dre, dans leur ordre chronologique, les neuf sympho-
nies de Beethoven plus quelques fragments — toujours
les mêmes — du bagage de César Franck, de Debussy,
Ravel, Rimsky-Korsakov, sans oublier MM. Paul
Dukas, Albert Roussel et Florent Schmitt ; plus, cela
va sans dire, les nouveaux produits et sous-produits
de la musique dadaïste, en vue d’intérêts qui ne sont
pas précisément artistiques. Soyons justes et reconnais-
sons que ni M. Chevillard ni M. Gaubert n’accueil-
lent ce genre de marchandise^.
Cependant il faut, pour revivifier l’apparence des
programmes, les corser de quelques 'épithètes bien
sonnantes. L’an passé M. G. Pierné, pour différencier la
partie musicale de ses programmes de celle qui ne
l’était point, les avait divisés en Polyphonie et Polyto-
nie (Cacotonie eût été. plus exact.) L’affiche de sa séance
de rentrée nous enseigne que la Symphonie fantastique
appartient au groupe du Fantastique dans l’art. Merci,
Monsieur Pierné! Et surtout n’oubliez pas, lorsque le
moment en-sera venu, que la Symphonie héroïque et la
Symphonie pastorale relèvent, l’une de l’Héroïsme, l’autre
du Pastoral dans l’art. On ne saurait apporter trop de
soins à l’éducation de son public !
Ceci dit, laissons toute espérance de visiter les parties
systématiquementdélaisséesdel’œuvredeBeethoven. Et
de même en doit-if être pour les ouvertures et les sym-
phonies de Schubert (F « inachevée » mise à part ;
peut-être attend-on son achèvement pour s’annexer les
autres.) Une ouverture de Schumann, deux de Beetho-
ven, deux de Weber, une de Mendelssohn ; parfois une
symphoniedeHaydnoudeMozart. C’esttout. Quantaux
noms de Spohr, de Niels Gade, de Marschner, de
Cherubini, de Méhul, de Spontini, de Meyerbeer, de
Gounod, — j’en passe et des meilleurs, cherchez-lesdans
les dictionnaires et lisez leurs ouvrages à la bibliothèque
du Conservatoire. Inutile d’ajouter que l’école belge,
l’école anglaise, l’école Scandinave sont profondément
ignorées de nos chefs d’orchestres.
L’Opéra-Comique n’a jamais moins justifié son titre
qu’avec la Habanera. Mais il n’importe, et nous le
devons Jouer de cette reprise, car l’œuvre est origi-
nale et vraiment prenante. En outre elle est bien
espagnole, de l’Espagne de Valdès Leal et de Goya;
une atmosphère nostalgique la baigne, et l’on y trouve
d’exquises douceurs et de tragiques brutalités. Le réa-
lisme le plus terre-à-terre y côtoie le plus angoissant mys-
tère. L’affabulation en est simple: Pilar est follement
aimée de Pedro et de Ramon, deux frères. Fiancé
à la jeune fille, Pedro est tué par Ramon, en un accès
de furieuse jalousie. Le mourant a promis de revenir
aubout d’une année et d’entraîner Pilar dans sa tombe
si l’assassin n’a pas eu le courage de lui révéler la
vérité. En vain Ramon, qui a épousé la novia de son
frère, essaie-1-il d’accomplir l’affreuse révélation. Sa
langue s’y refuse, et l’invisible mort attire vers sa
tombe la malheureuse Pilar qui s’y endort de l’irrévo-
cable sommeil. On songe, en lisant ce sombre drame,
à quelque « vision romantique » de Zorrilia ou
d’Espronceda.
Sous les épisodes les plus divers court, chante, crie,
frémit, pleure, murmure tour à tour la Habanera malé-
fique, dont les curieuses transformations forment à
l’œuvre un décor de sonorités mouvantes fort bien
disposées. Joignez des chants religieux qui traversent
l’enceinte du cimetière; joignez des lamentations
d’aveugles, des plaintes de mendiants, et aussi les pro-
pos lourdement comiques lancés par des buveurs, puis
quelques fragments de causeries entre des femmes, des
enfants, des passants à peine entrevus, et vous n’aurez pas
de peine à concevoir l’âpre relief de ces trois tableaux
dessinés par la mort et colorés par la vie. M. Raoul
Laparra aime les rythmes hardis et heurtés, les mélo-
dies rudes et les vibrantes déclamations. « Les rôles »,
écrit-il en un copieux préambule sur « la manière
d’interpréter » son œuvre, « les rôles seront déclamés
avant tout ; » il préconise « le moins de gestes possi-
ble », et va jusqu’à recommander à son orchestre de
ne pas craindre l’exagération dans la force. Il faut, en
un mot, se rappeler que « l’Espagne possède, jusque
dans le calme et au plus ardent degré, la Vie. »
Le compositeur a été fort bien servi par ses inter-
prètes. Deux des créateurs de 1908, MUe Hélène
Demellier et M. Vieuille, ont repris leurs rôles de Pilar
et du vieux père des frères ennemis. M. Vanni
Marcoux joue' de façon à se faire pardonner sa voix,
et M. Friant continue à chanter avec intelligence.
L’orchestre est placé sous la direction, toujours intelli-
gente, mais non constamment précise, de M. Catherine.
Enfin, la mise en scène est pittoresque et impecca-
blement réglée, ainsi qu’elle l’est toujours chez
M. Albert Carré.
René Brancour
REVUE DES REVUES
Le Correspondant (2 5 juillet). — A propos du
récent congrès d’égyptologie auquel donna lieu le
centenaire de la découverte du déchiffrement des
hiéroglyphes par Champollion, M. Henri Cordier, de
l’Académie des Inscriptions, raconte la genèse de l’opéra
égyptien Aida, de Verdi, et quelle part y eurent
Mariette, qui en imagina le scénario, et Maspero,
auquel on avait fait appel pour la mise en scène
lorsqu’il fut représenté à Paris en 1880.
La Revue universelle (ier août). — On trouvera
dans cette livraison le texte de la belle conférence que
notre collaborateur M. Paul Jamot consacra, lors des
« journées d’art religieux » organisées le printemps
dernier par les Cahiers catholiques, à Un grand artiste
chrétien : Eustache Lesueur dont il a donné un portrait