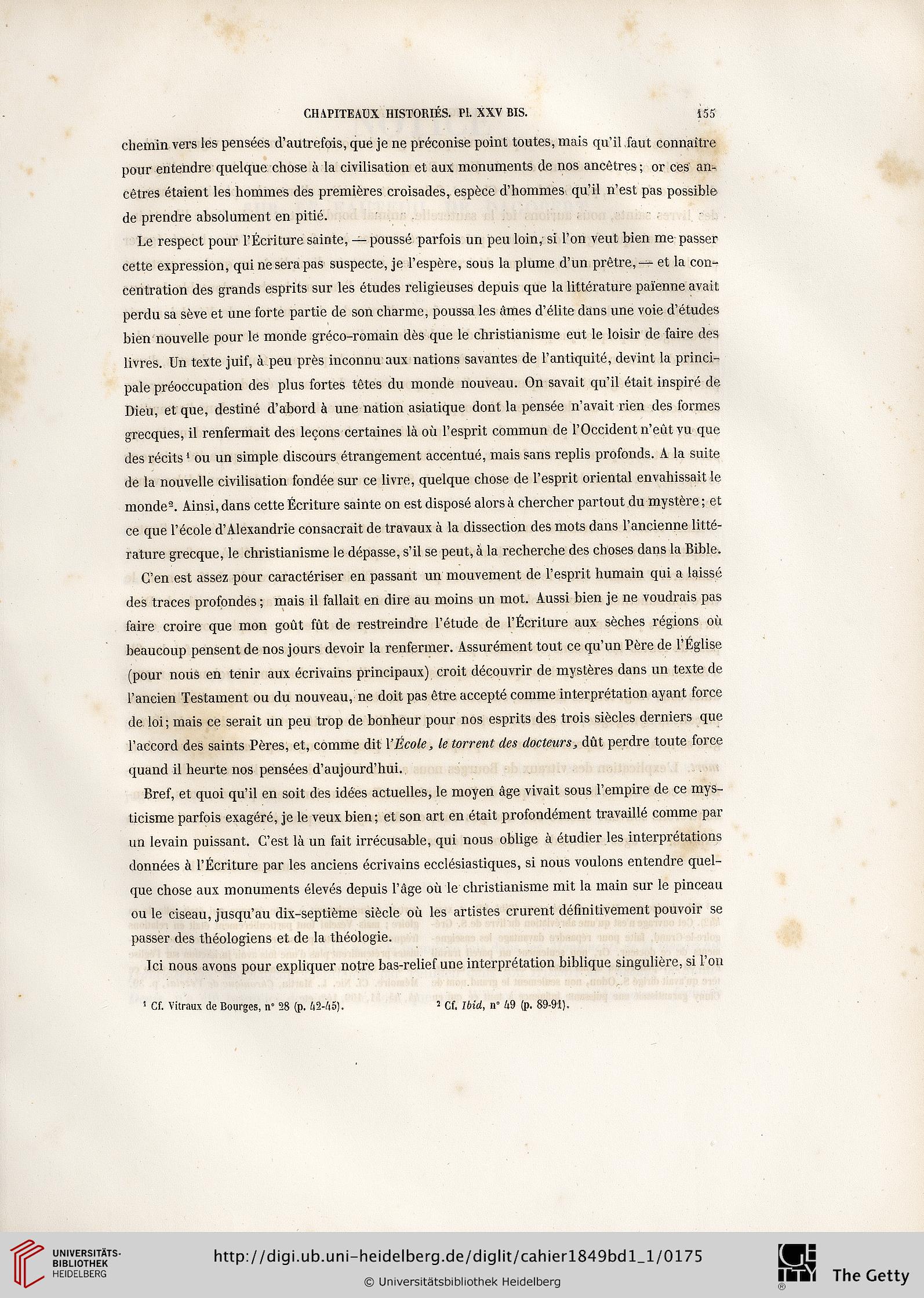CHAPITEAUX HISTORIÉS. PL XXV BIS.
155
chemin vers les pensées d'autrefois, que je ne préconise point toutes, mais qu'ii faut connaître
pour entendre quelque chose à la civilisation et aux monuments de nos ancêtres ; or ces an-
cêtres étaient les hommes des premières croisades, espèce d'hommes qu'il n'est pas possible
de prendre absolument en pitié.
Le respect pour l'Écriture sainte, —poussé parfois un peu loin, si l'on veut bien me passer
cette expression, qui ne sera pas suspecte, je l'espère, sous la plume d'un prêtre,— et la con-
centration des grands esprits sur les études religieuses depuis que la littérature païenne avait
perdu sa sève et une forte partie de son charme, poussa les Ames d'élite dans une voie d'études
bien nouvelle pour le monde gréco-romain dès que le christianisme eut le loisir de faire des
livres. Un texte juif, à peu près inconnu aux nations savantes de l'antiquité, devint la princi-
pale préoccupation des plus fortes têtes du monde nouveau. On savait qu'il était inspiré de
Dieu, et que, destiné d'abord à une nation asiatique dont la pensée n'avait rien des formes
grecques, il renfermait des leçons certaines là où l'esprit commun de l'Occident n'eût vu que
des récits * ou un simple discours étrangement accentué, mais sans replis profonds. A la suite
de la nouvelle civilisation fondée sur ce livre, quelque chose de l'esprit oriental envahissait le
mondes Ainsi, dans cette Écriture sainte on est disposé alors à chercher partout du mystère ; et
ce que l'école d'Alexandrie consacrait de travaux à la dissection des mots dans l'ancienne litté-
rature grecque, le christianisme le dépasse, s'il se peut, à la recherche des choses dans la Bible.
C'en est assez pour caractériser en passant un mouvement de l'esprit humain qui a laissé
des traces profondes ; mais il fallait en dire au moins un mot. Aussi bien je ne voudrais pas
faire croire que mon goût fût de restreindre l'étude de l'Écriture aux sèches régions où
beaucoup pensent de nos jours devoir la renfermer. Assurément tout ce qu'un Père de l'Église
(pour nous en tenir aux écrivains principaux) croit découvrir de mystères dans un texte de
l'ancien Testament ou du nouveau, ne doit pas être accepté comme interprétation ayant force
de loi; mais ce serait un peu trop de bonheur pour nos esprits des trois siècles derniers que
l'accord des saints Pères, et, comme dit ^ dût perdre toute force
quand il heurte nos pensées d'aujourd'hui.
Bref, et quoi qu'il en soit des idées actuelles, le moyen Age vivait sous l'empire de ce mys-
ticisme parfois exagéré, je le veux bien; et son art en était profondément travaillé comme par
on levain puissant. C'est là un fait irrécusable, qui nous oblige à étudier les interprétations
données à l'Écriture par les anciens écrivains ecclésiastiques, si nous voulons entendre quel-
que chose aux monuments élevés depuis l'Age où le christianisme mit la main sur le pinceau
ou le ciseau, jusqu'au dix-septième siècle où les artistes crurent définitivement pouvoir se
passer des théologiens et de la théologie.
Ici nous avons pour expliquer notre bas-relief une interprétation biblique singulière, si l'on
* Cf. Vitraux de Bourges, n° 38 (p. 52-55).
' Cf. lAAà n° 59 (p. 89-91),
155
chemin vers les pensées d'autrefois, que je ne préconise point toutes, mais qu'ii faut connaître
pour entendre quelque chose à la civilisation et aux monuments de nos ancêtres ; or ces an-
cêtres étaient les hommes des premières croisades, espèce d'hommes qu'il n'est pas possible
de prendre absolument en pitié.
Le respect pour l'Écriture sainte, —poussé parfois un peu loin, si l'on veut bien me passer
cette expression, qui ne sera pas suspecte, je l'espère, sous la plume d'un prêtre,— et la con-
centration des grands esprits sur les études religieuses depuis que la littérature païenne avait
perdu sa sève et une forte partie de son charme, poussa les Ames d'élite dans une voie d'études
bien nouvelle pour le monde gréco-romain dès que le christianisme eut le loisir de faire des
livres. Un texte juif, à peu près inconnu aux nations savantes de l'antiquité, devint la princi-
pale préoccupation des plus fortes têtes du monde nouveau. On savait qu'il était inspiré de
Dieu, et que, destiné d'abord à une nation asiatique dont la pensée n'avait rien des formes
grecques, il renfermait des leçons certaines là où l'esprit commun de l'Occident n'eût vu que
des récits * ou un simple discours étrangement accentué, mais sans replis profonds. A la suite
de la nouvelle civilisation fondée sur ce livre, quelque chose de l'esprit oriental envahissait le
mondes Ainsi, dans cette Écriture sainte on est disposé alors à chercher partout du mystère ; et
ce que l'école d'Alexandrie consacrait de travaux à la dissection des mots dans l'ancienne litté-
rature grecque, le christianisme le dépasse, s'il se peut, à la recherche des choses dans la Bible.
C'en est assez pour caractériser en passant un mouvement de l'esprit humain qui a laissé
des traces profondes ; mais il fallait en dire au moins un mot. Aussi bien je ne voudrais pas
faire croire que mon goût fût de restreindre l'étude de l'Écriture aux sèches régions où
beaucoup pensent de nos jours devoir la renfermer. Assurément tout ce qu'un Père de l'Église
(pour nous en tenir aux écrivains principaux) croit découvrir de mystères dans un texte de
l'ancien Testament ou du nouveau, ne doit pas être accepté comme interprétation ayant force
de loi; mais ce serait un peu trop de bonheur pour nos esprits des trois siècles derniers que
l'accord des saints Pères, et, comme dit ^ dût perdre toute force
quand il heurte nos pensées d'aujourd'hui.
Bref, et quoi qu'il en soit des idées actuelles, le moyen Age vivait sous l'empire de ce mys-
ticisme parfois exagéré, je le veux bien; et son art en était profondément travaillé comme par
on levain puissant. C'est là un fait irrécusable, qui nous oblige à étudier les interprétations
données à l'Écriture par les anciens écrivains ecclésiastiques, si nous voulons entendre quel-
que chose aux monuments élevés depuis l'Age où le christianisme mit la main sur le pinceau
ou le ciseau, jusqu'au dix-septième siècle où les artistes crurent définitivement pouvoir se
passer des théologiens et de la théologie.
Ici nous avons pour expliquer notre bas-relief une interprétation biblique singulière, si l'on
* Cf. Vitraux de Bourges, n° 38 (p. 52-55).
' Cf. lAAà n° 59 (p. 89-91),