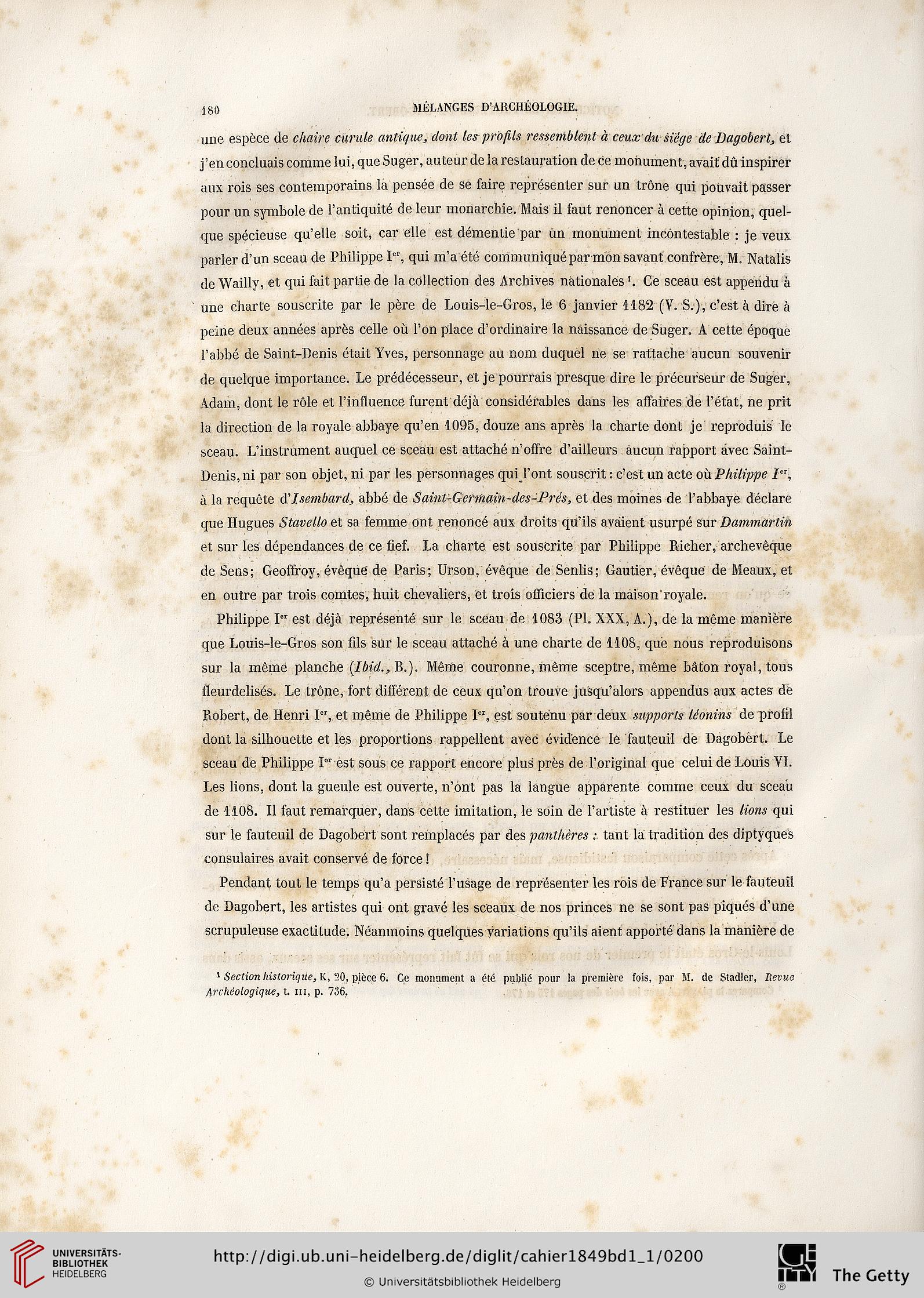ISO
MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.
une espèce de c/A/ôr <r/oaf /ry pre/^/.s' à rraa? &/ .s'A^r & /fa^oèrrA et
j'en concluais comme lui, que Suger, auteur de la restauration de ce monument, avait dû inspirer
aux rois ses contemporains la pensée de se faire représenter sur un trône qui pouvait passer
pour un symbole de l'antiquité de leur monarchie. Mais il faut renoncer à cette opinion, quel-
que spécieuse qu'elle soit, car elle est démentie par un monument incontestable : je veux
parler d'un sceau de Philippe I", qui m'a été communiqué par mon savant confrère, M. Natalis
de Wailly, et qui fait partie de la collection des Archives nationales *. Ce sceau est appendu à
une charte souscrite par le père de Louis-le-Gros, le 6 janvier 1182 (V. S.), c'est à dire à
peine deux années après celle où l'on place d'ordinaire la naissance de Suger. A cette époque
l'abbé de Saint-Denis était Yves, personnage au nom duquel ne se rattache aucun souvenir
de quelque importance. Le prédécesseur, et je pourrais presque dire le précurseur de Suger,
Adam, dont le rôle et l'influence furent déjà considérables dans les affaires de l'état, ne prit
la direction de la royale abbaye qu'en 1095, douze ans après la charte dont je reproduis le
sceau. L'instrument auquel ce sceau est attaché n'offre d'ailleurs aucun rapport avec Saint-
Denis, ni par son objet, ni par les personnages qui l'ont souscrit : c'est un acte oùPM^/jc L",
à la requête d'Lyrm^r^ abbé de et des moines de l'abbaye déclare
que Hugues et sa femme ont renoncé aux droits qu'ils avaient usurpé sur
et sur les dépendances de ce fief. La charte est souscrite par Philippe Richer, archevêque
de Sens; Geoffroy, évêque de Paris; Urson, évêque de Senlis; Gautier, évêque de Meaux, et
en outre par trois comtes, huit chevaliers, et trois officiers de la maison royale.
Philippe 1^ est déjà représenté sur le sceau de 1083 (PI. XXX, A.), de la même manière
que Louis-le-Gros son fils sur le sceau attaché à une charte de 1108, que nous reproduisons
sur la même planche (7àf&,B.). Même couronne, même sceptre, même bâton royal, tous
fleurdelisés. Le trône, fort différent de ceux qu'on trouve jusqu'alors appendus aux actes de
Robert, de Henri P\ et même de Philippe P% est soutenu par deux de profil
dont la silhouette et les proportions rappellent avec évidence le fauteuil de Dagobert. Le
sceau de Philippe P" est sous ce rapport encore plus près de l'original que celui de Louis VI.
Les lions, dont la gueule est ouverte, n'ont pas la langue apparente comme ceux du sceau
de 1108. Il faut remarquer, dans cette imitation, le soin de l'artiste à restituer les qui
sur le fauteuil de Dagobert sont remplacés par des ; tant la tradition des diptyques
consulaires avait conservé de force !
Pendant tout le temps qu'a persisté l'usage de représenter les rois de France sur le fauteuil
de Dagobert, les artistes qui ont gravé les sceaux de nos princes ne se sont pas piqués d'une
scrupuleuse exactitude. Néanmoins quelques variations qu'ils aient apporté dans la manière de
i K, 50, pièce 6. Ce monument a été publié pour ta première fois, par M. de Stadier, EerMu
t. in, p. 736,
MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.
une espèce de c/A/ôr <r/oaf /ry pre/^/.s' à rraa? &/ .s'A^r & /fa^oèrrA et
j'en concluais comme lui, que Suger, auteur de la restauration de ce monument, avait dû inspirer
aux rois ses contemporains la pensée de se faire représenter sur un trône qui pouvait passer
pour un symbole de l'antiquité de leur monarchie. Mais il faut renoncer à cette opinion, quel-
que spécieuse qu'elle soit, car elle est démentie par un monument incontestable : je veux
parler d'un sceau de Philippe I", qui m'a été communiqué par mon savant confrère, M. Natalis
de Wailly, et qui fait partie de la collection des Archives nationales *. Ce sceau est appendu à
une charte souscrite par le père de Louis-le-Gros, le 6 janvier 1182 (V. S.), c'est à dire à
peine deux années après celle où l'on place d'ordinaire la naissance de Suger. A cette époque
l'abbé de Saint-Denis était Yves, personnage au nom duquel ne se rattache aucun souvenir
de quelque importance. Le prédécesseur, et je pourrais presque dire le précurseur de Suger,
Adam, dont le rôle et l'influence furent déjà considérables dans les affaires de l'état, ne prit
la direction de la royale abbaye qu'en 1095, douze ans après la charte dont je reproduis le
sceau. L'instrument auquel ce sceau est attaché n'offre d'ailleurs aucun rapport avec Saint-
Denis, ni par son objet, ni par les personnages qui l'ont souscrit : c'est un acte oùPM^/jc L",
à la requête d'Lyrm^r^ abbé de et des moines de l'abbaye déclare
que Hugues et sa femme ont renoncé aux droits qu'ils avaient usurpé sur
et sur les dépendances de ce fief. La charte est souscrite par Philippe Richer, archevêque
de Sens; Geoffroy, évêque de Paris; Urson, évêque de Senlis; Gautier, évêque de Meaux, et
en outre par trois comtes, huit chevaliers, et trois officiers de la maison royale.
Philippe 1^ est déjà représenté sur le sceau de 1083 (PI. XXX, A.), de la même manière
que Louis-le-Gros son fils sur le sceau attaché à une charte de 1108, que nous reproduisons
sur la même planche (7àf&,B.). Même couronne, même sceptre, même bâton royal, tous
fleurdelisés. Le trône, fort différent de ceux qu'on trouve jusqu'alors appendus aux actes de
Robert, de Henri P\ et même de Philippe P% est soutenu par deux de profil
dont la silhouette et les proportions rappellent avec évidence le fauteuil de Dagobert. Le
sceau de Philippe P" est sous ce rapport encore plus près de l'original que celui de Louis VI.
Les lions, dont la gueule est ouverte, n'ont pas la langue apparente comme ceux du sceau
de 1108. Il faut remarquer, dans cette imitation, le soin de l'artiste à restituer les qui
sur le fauteuil de Dagobert sont remplacés par des ; tant la tradition des diptyques
consulaires avait conservé de force !
Pendant tout le temps qu'a persisté l'usage de représenter les rois de France sur le fauteuil
de Dagobert, les artistes qui ont gravé les sceaux de nos princes ne se sont pas piqués d'une
scrupuleuse exactitude. Néanmoins quelques variations qu'ils aient apporté dans la manière de
i K, 50, pièce 6. Ce monument a été publié pour ta première fois, par M. de Stadier, EerMu
t. in, p. 736,