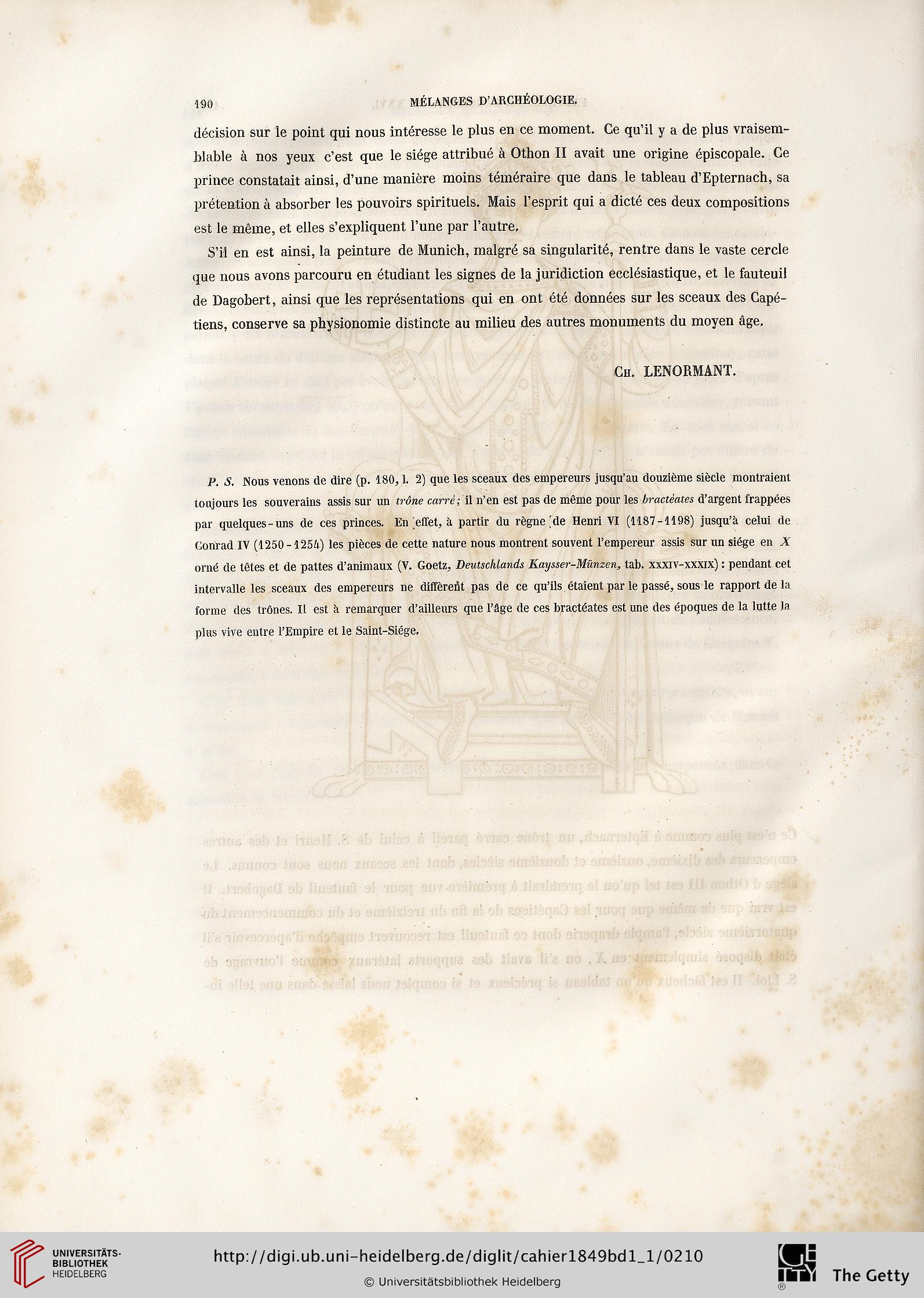190
MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.
décision sur îe point qui nous intéresse le plus en ce moment. Ce qu'il y a de plus vraisem-
blable à nos yeux c'est que le siège attribué à Othon II avait une origine épiscopale. Ce
prince constatait ainsi, d'une manière moins téméraire que dans le tableau d'Epternach, sa
prétention à absorber les pouvoirs spirituels. Mais l'esprit qui a dicté ces deux compositions
est le même, et elles s'expliquent l'une par l'autre.
S'il en est ainsi, la peinture de Munich, malgré sa singularité, rentre dans le vaste cercle
que nous avons parcouru en étudiant les signes de la juridiction ecclésiastique, et le fauteuil
de Dagobert, ainsi que les représentations qui en ont été données sur les sceaux des Capé-
tiens, conserve sa physionomie distincte au milieu des autres monuments du moyen âge.
CH. LENORMANT.
P. A. Nous venons de dire (p. 180,1. 2) que les sceaux des empereurs jusqu'au douzième siècle montraient
toujours les souverains assis sur un ooac carre; il n'en est pas de même pour les âractcaîM d'argent frappées
par quelques-uns de ces princes. En eiîet, à partir du règne de Henri VI (1187-1198) jusqu'à celui de
Gonrad IV (1250-125A) les pièces de cette nature nous montrent souvent l'empereur assis sur un siège en Æ
orné de têtes et de pattes d'animaux (V. Goetz, Dca^cA/aa& Ray^^e?-Nanzea, tab. xxxiv-xxxix) : pendant cet
intervalle les sceaux des empereurs ne ditfèreât pas de ce qu'ils étaient par le passé, sous le rapport de la
forme des trônes. Il est à remarquer d'ailleurs que l'âge de ces bractéates est une des époques de la lutte la
plus vive entre l'Empire et le Saint-Siège.
MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.
décision sur îe point qui nous intéresse le plus en ce moment. Ce qu'il y a de plus vraisem-
blable à nos yeux c'est que le siège attribué à Othon II avait une origine épiscopale. Ce
prince constatait ainsi, d'une manière moins téméraire que dans le tableau d'Epternach, sa
prétention à absorber les pouvoirs spirituels. Mais l'esprit qui a dicté ces deux compositions
est le même, et elles s'expliquent l'une par l'autre.
S'il en est ainsi, la peinture de Munich, malgré sa singularité, rentre dans le vaste cercle
que nous avons parcouru en étudiant les signes de la juridiction ecclésiastique, et le fauteuil
de Dagobert, ainsi que les représentations qui en ont été données sur les sceaux des Capé-
tiens, conserve sa physionomie distincte au milieu des autres monuments du moyen âge.
CH. LENORMANT.
P. A. Nous venons de dire (p. 180,1. 2) que les sceaux des empereurs jusqu'au douzième siècle montraient
toujours les souverains assis sur un ooac carre; il n'en est pas de même pour les âractcaîM d'argent frappées
par quelques-uns de ces princes. En eiîet, à partir du règne de Henri VI (1187-1198) jusqu'à celui de
Gonrad IV (1250-125A) les pièces de cette nature nous montrent souvent l'empereur assis sur un siège en Æ
orné de têtes et de pattes d'animaux (V. Goetz, Dca^cA/aa& Ray^^e?-Nanzea, tab. xxxiv-xxxix) : pendant cet
intervalle les sceaux des empereurs ne ditfèreât pas de ce qu'ils étaient par le passé, sous le rapport de la
forme des trônes. Il est à remarquer d'ailleurs que l'âge de ces bractéates est une des époques de la lutte la
plus vive entre l'Empire et le Saint-Siège.