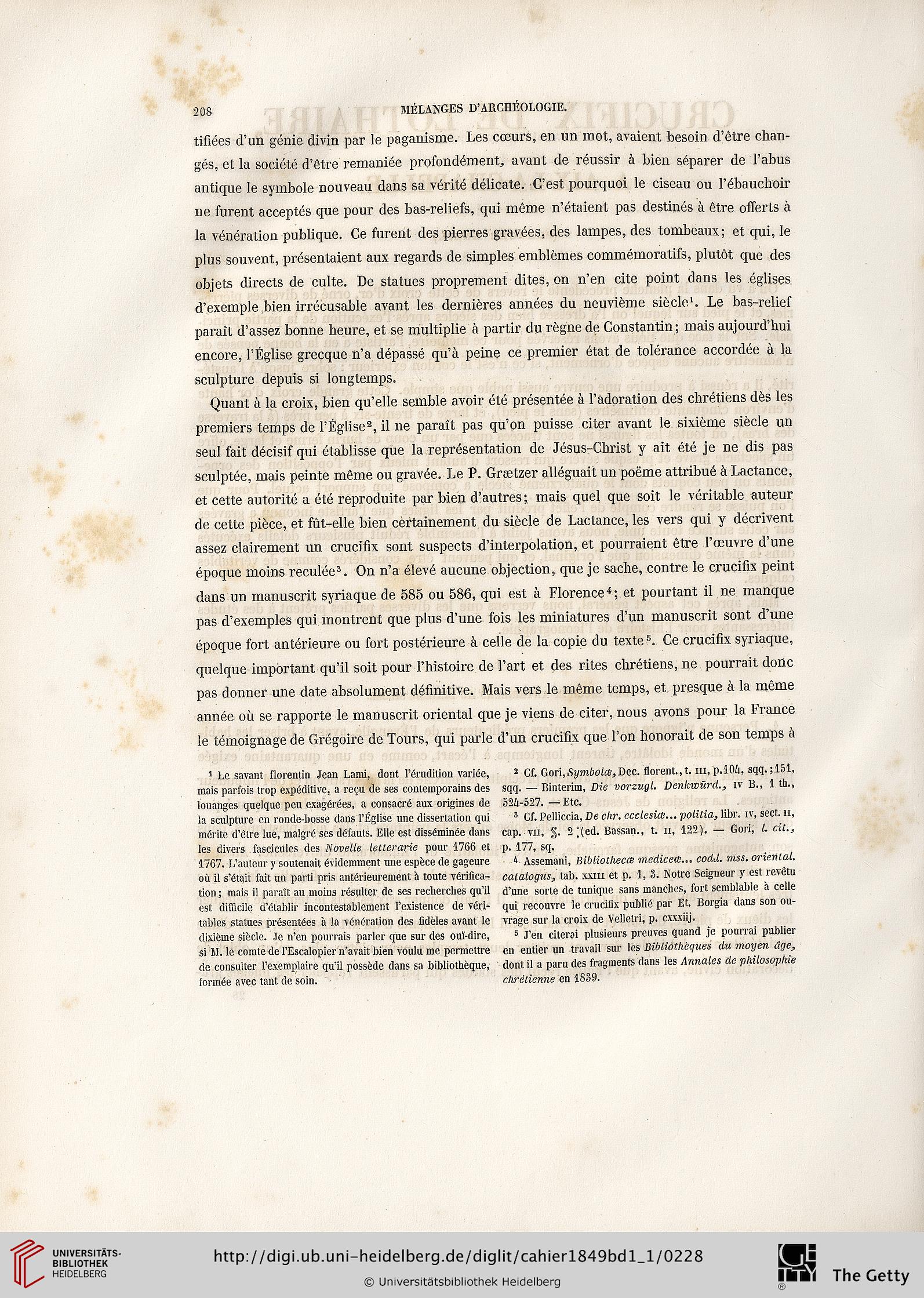208
MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.
tifiëes d'un génie divin par le paganisme. Les cœurs, en un mot, avaient besoin d'être chan-
gés, et la société d'être remaniée profondément, avant de réussir à bien séparer de l'abus
antique le symbole nouveau dans sa vérité délicate. C'est pourquoi le ciseau ou l'ébauchoir
ne furent acceptés que pour des bas-reliefs, qui même n'étaient pas destinés à être offerts à
la vénération publique. Ce furent des pierres gravées, des lampes, des tombeaux; et qui, le
plus souvent, présentaient aux regards de simples emblèmes commémoratifs, plutôt que des
objets directs de culte. De statues proprement dites, on n'en cite point dans les églises
d'exemple bien irrécusable avant les dernières années du neuvième siècle b Le bas-relief
paraît d'assez bonne heure, et se multiplie à partir du règne de Constantin; mais aujourd'hui
encore, l'Église grecque n'a dépassé qu'à peine ce premier état de tolérance accordée à la
sculpture depuis si longtemps.
Quant à la croix, bien qu'elle semble avoir été présentée à l'adoration des chrétiens dès les
premiers temps de l'Église s, il ne paraît pas qu'on puisse citer avant le sixième siècle un
seul fait décisif qui établisse que la représentation de Jésus-Christ y ait été je ne dis pas
sculptée, mais peinte même ou gravée. Le P. Grætzer alléguait un poème attribué à Lactance,
et cette autorité a été reproduite par bien d'autres; mais quel que soit le véritable auteur
de cette pièce, et fût-elle bien certainement du siècle de Lactance, les vers qui y décrivent
assez clairement un crucifix sont suspects d'interpolation, et pourraient être l'œuvre d'une
époque moins reculée^. On n'a élevé aucune objection, que je sache, contre le crucifix peint
dans un manuscrit syriaque de 585 ou 586, qui est à Florence ^ ; et pourtant il ne manque
pas d'exemples qui montrent que plus d'une fois les miniatures d'un manuscrit sont d'une
époque fort antérieure ou fort postérieure à celle de la copie du textes Ce crucifix syriaque,
quelque important qu'il soit pour l'histoire de l'art et des rites chrétiens, ne pourrait donc
pas donner une date absolument définitive. Mais vers le même temps, et presque à la même
année où se rapporte le manuscrit oriental que je viens de citer, nous avons pour la France
le témoignage de Grégoire de Tours, qui parle
i Le savant florentin Jean Lami, dont l'érudition variée,
mais parfois trop expéditive, a reçu de ses contemporains des
louanges quelque peu exagérées, a consacré aux origines de
la sculpture en ronde-bosse dans l'Église une dissertation qui
mérite d'ctre lue, malgré ses défauts. Elle est disséminée dans
les divers fascicules des Aovede ieMerarie pour 1766 et
1767. L'auteur y soutenait évidemment une espèce de gageure
où il s'était fait un parti pris antérieurement à toute vérifica-
tion ; mais il paraît au moins résulter de ses recherches qu'il
est diiïicilc d'établir incontestablement l'existence de véri-
tables statues présentées à la vénération des fidèles avant le
dixième siècle. Je n'en pourrais parler que sur des ouï-dire,
si M. le comte de l'Escalopicr n'avait bien voulu me permettre
de consulter l'exemplaire qu'il possède dans sa bibliothèque,
formée avec tant de soin.
d'un crucifix que l'on honorait de son temps à
s Cf. Gori, <$y?n&oit%, Dec. florent., t. m, p.lOù, sqq.;151,
sqq. — Binterim, Die vor^ayi. Denfcwârd., iv B., 1 th.,
52Ù-527. — Etc.
s Cf. Pelliccia, De cdr. ecciesâa... poiiiia, libr. tv, sect. n,
cap. vu, g. 2°(ed. Bassan., t. n, 122). — Gori, i. ci;.,
p. 177, sq.
4 Assemani, BiidiofAecee medice#?... codd. mss. orientai,
caiaioyas, tab. xxm et p. 1, 3. Notre Seigneur y est revetu
d'une sorte de tunique sans manches, fort semblable à celle
qui recouvre le crucifix publié par Et. Borgia dans son ou-
vrage sur la croix de Velletri, p. cxxxiij.
s J'en citerai plusieurs preuves quand je pourrai publier
en entier un travail sur les Diùiioidèyaes da moyen aye,
dont il a paru des fragments dans les Annales de p/diosop/de
edretieane en 1839.
MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE.
tifiëes d'un génie divin par le paganisme. Les cœurs, en un mot, avaient besoin d'être chan-
gés, et la société d'être remaniée profondément, avant de réussir à bien séparer de l'abus
antique le symbole nouveau dans sa vérité délicate. C'est pourquoi le ciseau ou l'ébauchoir
ne furent acceptés que pour des bas-reliefs, qui même n'étaient pas destinés à être offerts à
la vénération publique. Ce furent des pierres gravées, des lampes, des tombeaux; et qui, le
plus souvent, présentaient aux regards de simples emblèmes commémoratifs, plutôt que des
objets directs de culte. De statues proprement dites, on n'en cite point dans les églises
d'exemple bien irrécusable avant les dernières années du neuvième siècle b Le bas-relief
paraît d'assez bonne heure, et se multiplie à partir du règne de Constantin; mais aujourd'hui
encore, l'Église grecque n'a dépassé qu'à peine ce premier état de tolérance accordée à la
sculpture depuis si longtemps.
Quant à la croix, bien qu'elle semble avoir été présentée à l'adoration des chrétiens dès les
premiers temps de l'Église s, il ne paraît pas qu'on puisse citer avant le sixième siècle un
seul fait décisif qui établisse que la représentation de Jésus-Christ y ait été je ne dis pas
sculptée, mais peinte même ou gravée. Le P. Grætzer alléguait un poème attribué à Lactance,
et cette autorité a été reproduite par bien d'autres; mais quel que soit le véritable auteur
de cette pièce, et fût-elle bien certainement du siècle de Lactance, les vers qui y décrivent
assez clairement un crucifix sont suspects d'interpolation, et pourraient être l'œuvre d'une
époque moins reculée^. On n'a élevé aucune objection, que je sache, contre le crucifix peint
dans un manuscrit syriaque de 585 ou 586, qui est à Florence ^ ; et pourtant il ne manque
pas d'exemples qui montrent que plus d'une fois les miniatures d'un manuscrit sont d'une
époque fort antérieure ou fort postérieure à celle de la copie du textes Ce crucifix syriaque,
quelque important qu'il soit pour l'histoire de l'art et des rites chrétiens, ne pourrait donc
pas donner une date absolument définitive. Mais vers le même temps, et presque à la même
année où se rapporte le manuscrit oriental que je viens de citer, nous avons pour la France
le témoignage de Grégoire de Tours, qui parle
i Le savant florentin Jean Lami, dont l'érudition variée,
mais parfois trop expéditive, a reçu de ses contemporains des
louanges quelque peu exagérées, a consacré aux origines de
la sculpture en ronde-bosse dans l'Église une dissertation qui
mérite d'ctre lue, malgré ses défauts. Elle est disséminée dans
les divers fascicules des Aovede ieMerarie pour 1766 et
1767. L'auteur y soutenait évidemment une espèce de gageure
où il s'était fait un parti pris antérieurement à toute vérifica-
tion ; mais il paraît au moins résulter de ses recherches qu'il
est diiïicilc d'établir incontestablement l'existence de véri-
tables statues présentées à la vénération des fidèles avant le
dixième siècle. Je n'en pourrais parler que sur des ouï-dire,
si M. le comte de l'Escalopicr n'avait bien voulu me permettre
de consulter l'exemplaire qu'il possède dans sa bibliothèque,
formée avec tant de soin.
d'un crucifix que l'on honorait de son temps à
s Cf. Gori, <$y?n&oit%, Dec. florent., t. m, p.lOù, sqq.;151,
sqq. — Binterim, Die vor^ayi. Denfcwârd., iv B., 1 th.,
52Ù-527. — Etc.
s Cf. Pelliccia, De cdr. ecciesâa... poiiiia, libr. tv, sect. n,
cap. vu, g. 2°(ed. Bassan., t. n, 122). — Gori, i. ci;.,
p. 177, sq.
4 Assemani, BiidiofAecee medice#?... codd. mss. orientai,
caiaioyas, tab. xxm et p. 1, 3. Notre Seigneur y est revetu
d'une sorte de tunique sans manches, fort semblable à celle
qui recouvre le crucifix publié par Et. Borgia dans son ou-
vrage sur la croix de Velletri, p. cxxxiij.
s J'en citerai plusieurs preuves quand je pourrai publier
en entier un travail sur les Diùiioidèyaes da moyen aye,
dont il a paru des fragments dans les Annales de p/diosop/de
edretieane en 1839.