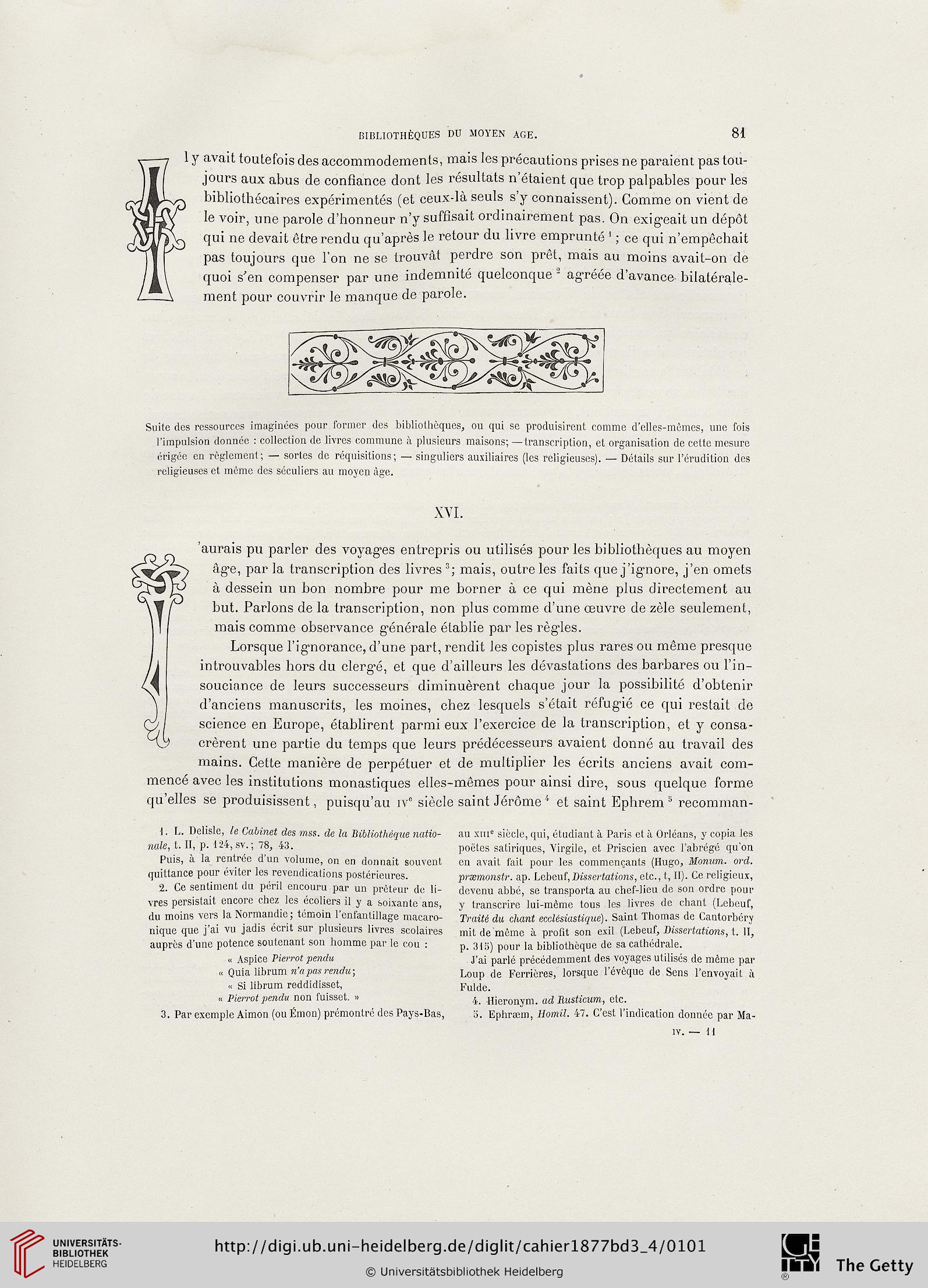BIBLIOTHÈQUES DU MOYEN AGE.
81
i-—y 1 y avait toutefois des accommodements, mais ies précautions prises ne paraient pas tou-
] W [ jours aux abus de confiance dont ies résultats n'étaient que trop paipables pour les
bibliothécaires expérimentés (et ceux-là seuls s'y connaissent). Gomme on vient de
le voir, une parole d'honneur n'y suffisait ordinairement pas. On exigeait un dépôt
qui ne devait être rendu qu'après le retour du livre emprunté ' ; ce qui n'empêchait
pas toujours que l'on ne se trouvât perdre son prêt, mais au moins avait-on de
/ quoi s'en compenser par une indemnité quelconque* ag'réée d'avance bilatérale-
A ment pour couvrir le manque de parole.
Suite des ressources imaginées pour former des bibliothèques, ou qui se produisirent comme d'eiies-mêmes, une fois
['impulsion donnée : colicction de [ivres commune à ptusieurs maisons; —transcription, et organisation de cette mesure
érigée en règlement; — sortes de réquisitions; — singuliers auxiliaires (les religieuses). — Détails sur l'érudition des
religieuses et même des séculiers au moyen âge.
XVI.
aurais pu parler des voyages entrepris ou utilisés pour les bibliothèques au moyen
âge, par la transcription des livres mais, outre les faits que j'ignore, j'en omets
à dessein un bon nombre pour me borner à ce qui mène plus directement au
but. Parlons de la transcription, non plus comme d'une œuvre de zèle seulement,
mais comme observance générale établie par les règles.
Lorsque l'ignorance, d'une part, rendit les copistes plus rares ou même presque
introuvables hors du clergé, et que d'ailleurs les dévastations des barbares ou l'in-
souciance de leurs successeurs diminuèrent chaque jour la possibilité d'obtenir
d'anciens manuscrits, les moines, chez lesquels s'était réfugié ce qui restait de
science en Europe, établirent parmi eux l'exercice de la transcription, et y consa-
crèrent une partie du temps que leurs prédécesseurs avaient donné au travail des
mains. Cette manière de perpétuer et de multiplier les écrits anciens avait com-
mencé avec les institutions monastiques elles-mêmes pour ainsi dire, sous quelque forme
qu'elles se produisissent, puisqu'au iv° siècle saint Jérôme* et saint Ephrem" recomman-
1. L. Detisle, te CaMaef des mss. de ta DiMiotttéqMe natio-
nale, t. II, p. 124, sv.; 78, 43.
Puis, à lu rentrée d un volume, on en donnait souvent
quittance pour éviter les revendications postérieures.
2. Ce sentiment du périt encouru par un prêteur de li-
vres persistait encore chez [es écoliers i[ y a soixante ans,
du moins vers la Normandie; témoin [ cntantihage niacaro-
nique que j'ai vu jadis écrit sur ptusieurs livres scolaires
auprès d'une potence soutenant son homme par [e cou :
« Aspice Pierrot pendn
« Quia librum w'apaxrcndM;
« Si librum reddidisset,
a p^rrot pendu non fuisset. "
3. Par exempie Aimon (ou Émon) prémontre des Pays-Bas,
au xm" siècie, qui, étudiant à Paris et à Orléans, y copia ies
poètes satiriques, Virgile, et Priscien avec t'abrégé qu'on
en avait fait pour les commençants (Hugo, Afomum. ord.
præwMHstr. ap. Lebeuf,Dissertations, etc., t. H). Ce religieux,
devenu abbé, se transporta au chef-lieu de son ordre pour
y transcrire lui-même tous les livres de chant (Lebeuf,
Traité da cAawf ecclésiastique). Saint Thomas de Cantorbéry
mit de même à profit son exil (Lebeuf, Dissertations, t. 11,
p. 313) pour la bibliothèque de sa cathédrale.
J'ai parlé précédemment des voyages utilisés de même par
Loup de Ferrières, lorsque l'évêque de Sens l'envoyait à
Fulde.
4. Hieronym. ad RMStieum, etc.
3. Ephræm, Domii. 47. C'est l'indication donnée par Ma-
81
i-—y 1 y avait toutefois des accommodements, mais ies précautions prises ne paraient pas tou-
] W [ jours aux abus de confiance dont ies résultats n'étaient que trop paipables pour les
bibliothécaires expérimentés (et ceux-là seuls s'y connaissent). Gomme on vient de
le voir, une parole d'honneur n'y suffisait ordinairement pas. On exigeait un dépôt
qui ne devait être rendu qu'après le retour du livre emprunté ' ; ce qui n'empêchait
pas toujours que l'on ne se trouvât perdre son prêt, mais au moins avait-on de
/ quoi s'en compenser par une indemnité quelconque* ag'réée d'avance bilatérale-
A ment pour couvrir le manque de parole.
Suite des ressources imaginées pour former des bibliothèques, ou qui se produisirent comme d'eiies-mêmes, une fois
['impulsion donnée : colicction de [ivres commune à ptusieurs maisons; —transcription, et organisation de cette mesure
érigée en règlement; — sortes de réquisitions; — singuliers auxiliaires (les religieuses). — Détails sur l'érudition des
religieuses et même des séculiers au moyen âge.
XVI.
aurais pu parler des voyages entrepris ou utilisés pour les bibliothèques au moyen
âge, par la transcription des livres mais, outre les faits que j'ignore, j'en omets
à dessein un bon nombre pour me borner à ce qui mène plus directement au
but. Parlons de la transcription, non plus comme d'une œuvre de zèle seulement,
mais comme observance générale établie par les règles.
Lorsque l'ignorance, d'une part, rendit les copistes plus rares ou même presque
introuvables hors du clergé, et que d'ailleurs les dévastations des barbares ou l'in-
souciance de leurs successeurs diminuèrent chaque jour la possibilité d'obtenir
d'anciens manuscrits, les moines, chez lesquels s'était réfugié ce qui restait de
science en Europe, établirent parmi eux l'exercice de la transcription, et y consa-
crèrent une partie du temps que leurs prédécesseurs avaient donné au travail des
mains. Cette manière de perpétuer et de multiplier les écrits anciens avait com-
mencé avec les institutions monastiques elles-mêmes pour ainsi dire, sous quelque forme
qu'elles se produisissent, puisqu'au iv° siècle saint Jérôme* et saint Ephrem" recomman-
1. L. Detisle, te CaMaef des mss. de ta DiMiotttéqMe natio-
nale, t. II, p. 124, sv.; 78, 43.
Puis, à lu rentrée d un volume, on en donnait souvent
quittance pour éviter les revendications postérieures.
2. Ce sentiment du périt encouru par un prêteur de li-
vres persistait encore chez [es écoliers i[ y a soixante ans,
du moins vers la Normandie; témoin [ cntantihage niacaro-
nique que j'ai vu jadis écrit sur ptusieurs livres scolaires
auprès d'une potence soutenant son homme par [e cou :
« Aspice Pierrot pendn
« Quia librum w'apaxrcndM;
« Si librum reddidisset,
a p^rrot pendu non fuisset. "
3. Par exempie Aimon (ou Émon) prémontre des Pays-Bas,
au xm" siècie, qui, étudiant à Paris et à Orléans, y copia ies
poètes satiriques, Virgile, et Priscien avec t'abrégé qu'on
en avait fait pour les commençants (Hugo, Afomum. ord.
præwMHstr. ap. Lebeuf,Dissertations, etc., t. H). Ce religieux,
devenu abbé, se transporta au chef-lieu de son ordre pour
y transcrire lui-même tous les livres de chant (Lebeuf,
Traité da cAawf ecclésiastique). Saint Thomas de Cantorbéry
mit de même à profit son exil (Lebeuf, Dissertations, t. 11,
p. 313) pour la bibliothèque de sa cathédrale.
J'ai parlé précédemment des voyages utilisés de même par
Loup de Ferrières, lorsque l'évêque de Sens l'envoyait à
Fulde.
4. Hieronym. ad RMStieum, etc.
3. Ephræm, Domii. 47. C'est l'indication donnée par Ma-