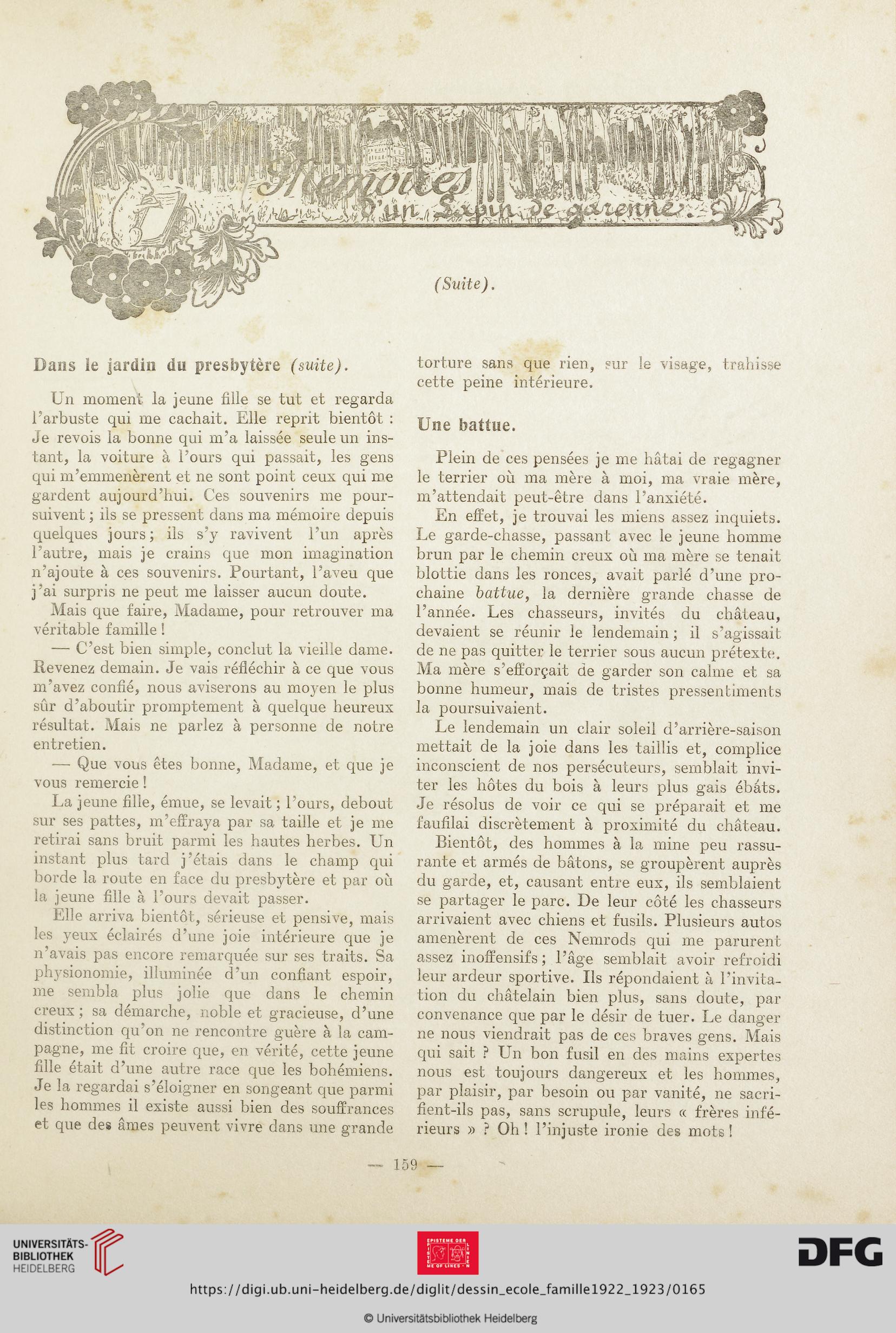Dans le jardin du presbytère (suite).
Un moment la jeune fille se tut et regarda
l’arbuste qui me cachait. Elle reprit bientôt :
Je revois la bonne qui m’a laissée seule un ins-
tant, la voiture à l’ours qui passait, les gens
qui m’emmenèrent et ne sont point ceux qui me
gardent aujourd’hui. Ces souvenirs me pour-
suivent ; iis se pressent dans ma mémoire depuis
quelques jours; ils s’y ravivent l’un après
l’autre, mais je crains que mon imagination
n’ajoute à ces souvenirs. Pourtant, l’aveu que
j’ai surpris ne peut me laisser aucun doute.
Mais que faire, Madame, pour retrouver ma
véritable famille !
— C’est bien simple, conclut la vieille dame.
Revenez demain. Je vais réfléchir à ce que vous
m’avez confié, nous aviserons au moyen le plus
sûr d’aboutir promptement à quelque heureux
résultat. Mais ne parlez à personne de notre
entretien.
— Que vous êtes bonne, Madame, et que je
vous remercie !
La jeune fille, émue, se levait ; l’ours, debout
sur ses pattes, m’effraya par sa taille et je me
retirai sans bruit parmi les hautes herbes. Un
instant plus tard j’étais dans le champ qui
borde la route en face du presbytère et par où
la jeune fille à l’ours devait passer.
Elle arriva bientôt, sérieuse et pensive, mais
les yeux éclairés d’une joie intérieure que je
n’avais pas encore remarquée sur ses traits. Sa
physionomie, illuminée d’un confiant espoir,
me sembla plus jolie que dans le chemin
creux ; sa démarche, noble et gracieuse, d’une
distinction qu’on ne rencontre guère à la cam-
pagne, me fît croire que, en vérité, cette jeune
fille était d’une autre race que les bohémiens.
Je la regardai s’éloigner en songeant que parmi
les hommes il existe aussi bien des souffrances
et que des âmes peuvent vivre dans une grande
torture sans que rien, sur le visage, trahisse
cette peine intérieure.
Une battue.
Plein de ces pensées je me hâtai de regagner
le terrier où ma mère à moi, ma vraie mère,
m’attendait peut-être dans l’anxiété.
En effet, je trouvai les miens assez inquiets.
Le garde-chasse, passant avec le jeune homme
brun par le chemin creux où ma mère se tenait
blottie dans les ronces, avait parlé d’une pro-
chaine battue, la dernière grande chasse de
l’année. Les chasseurs, invités du château,
devaient se réunir le lendemain ; il s’agissait
de ne pas quitter le terrier sous aucun prétexte.
Ma mère s’efforçait de garder son calme et sa
bonne humeur, mais de tristes pressentiments
la poursuivaient.
Le lendemain un clair soleil d’arrière-saison
mettait de la joie dans les taillis et, complice
inconscient de nos persécuteurs, semblait invi-
ter les hôtes du bois à leurs plus gais ébâts.
Je résolus de voir ce qui se préparait et me
faufilai discrètement à proximité du château.
Bientôt, des hommes à la mine peu rassu-
rante et armés de bâtons, se groupèrent auprès
du garde, et, causant entre eux, ils semblaient
se partager le parc. De leur côté les chasseurs
arrivaient avec chiens et fusils. Plusieurs autos
amenèrent de ces Nemrods qui me parurent
assez inoffensifs ; l’âge semblait avoir refroidi
leur ardeur sportive. Us répondaient à l’invita-
tion du châtelain bien plus, sans doute, par
convenance que par le désir de tuer. Le danger
ne nous viendrait pas de ces braves gens. Mais
qui sait ? Un bon fusil en des mains expertes
nous est toujours dangereux et les hommes,
par plaisir, par besoin ou par vanité, ne sacri-
fient-ils pas, sans scrupule, leurs « frères infé-
rieurs » ? Oh ! l’injuste ironie des mots !
159 —