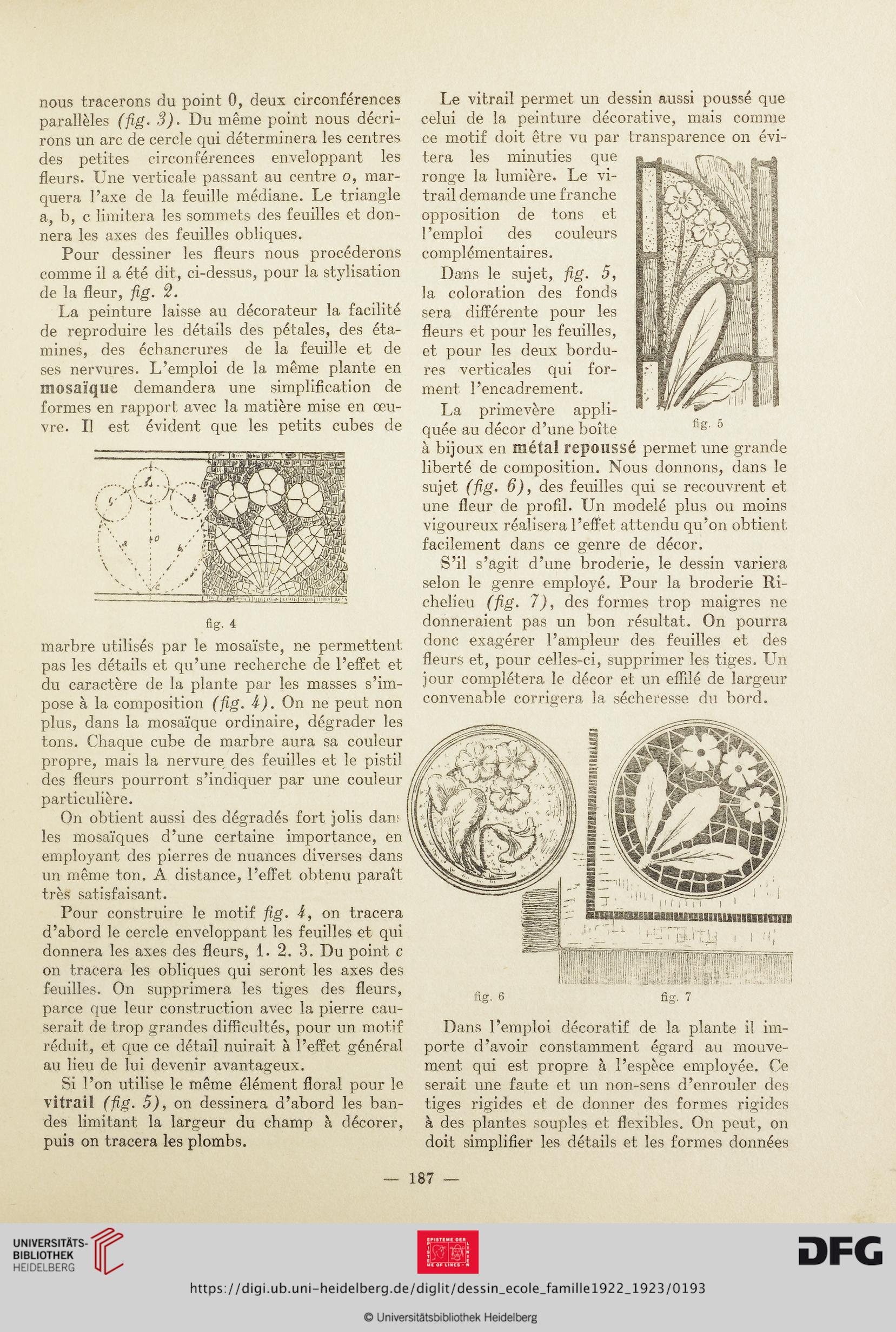nous tracerons du point 0, deux circonférences
parallèles (fig. S). Du même point nous décri-
rons un arc de cercle qui déterminera les centres
des petites circonférences enveloppant les
fleurs. Une verticale passant au centre o, mar-
quera l’axe de la feuille médiane. Le triangle
a, b, c limitera les sommets des feuilles et don-
nera les axes des feuilles obliques.
Pour dessiner les fleurs nous procéderons
comme il a été dit, ci-dessus, pour la stylisation
de la fleur, fig. 2.
La peinture laisse au décorateur la facilité
de reproduire les détails des pétales, des éta-
mines, des échancrures de la feuille et de
ses nervures. L’emploi de la même plante en
mosaïque demandera une simplification de
formes en rapport avec la matière mise en œu-
vre. Il est évident que les petits cubes de
fig. 4
marbre utilisés par le mosaïste, ne permettent
pas les détails et qu’une recherche de l’effet et
du caractère de la plante par les masses s’im-
pose à la composition (fig. 4). On ne peut non
plus, dans la mosaïque ordinaire, dégrader les
tons. Chaque cube de marbre aura sa couleur
propre, mais la nervure des feuilles et le pistil
des fleurs pourront s’indiquer par une couleur
particulière.
On obtient aussi des dégradés fort jolis dan;
les mosaïques d’une certaine importance, en
employant des pierres de nuances diverses dans
un même ton. A distance, l’effet obtenu paraît
très satisfaisant.
Pour construire le motif fig. 4, on tracera
d’abord le cercle enveloppant les feuilles et qui
donnera les axes des fleurs, 1. 2. 3. Du point c
on tracera les obliques qui seront les axes des
feuilles. On supprimera les tiges des fleurs,
parce que leur construction avec la pierre cau-
serait de trop grandes difficultés, pour un motif
réduit, et que ce détail nuirait à l’effet général
au lieu de lui devenir avantageux.
Si l’on utilise le même élément floral pour le
vitrail (fig. 5), on dessinera d’abord les ban-
des limitant la largeur du champ à décorer,
puis on tracera les plombs.
Le vitrail permet un dessin aussi poussé que
celui de la peinture décorative, mais comme
ce motif doit être vu par transparence on évi-
tera les minuties que
ronge la lumière. Le vi-
trail demande une franche
opposition de tons et
l’emploi des couleurs
complémentaires.
Dans le sujet, fig. 5,
la coloration des fonds
sera différente pour les
fleurs et pour les feuilles,
et pour les deux bordu-
res verticales qui for-
ment l’encadrement.
La primevère appli-
quée au décor d’une boîte
à bijoux en métal repoussé permet une grande
liberté de composition. Nous donnons, dans le
sujet (fig. 6), des feuilles qui se recouvrent et
une fleur de profil. Un modelé plus ou moins
vigoureux réalisera l’effet attendu qu’on obtient
facilement dans ce genre de décor.
S’il s’agit d’une broderie, le dessin variera
selon le genre employé. Pour la broderie Ri-
chelieu (fig. 7), des formes trop maigres ne
donneraient pas un bon résultat. On pourra
donc exagérer l’ampleur des feuilles et des
fleurs et, pour celles-ci, supprimer les tiges. Un
jour complétera le décor et un effilé de largeur
convenable corrigera la sécheresse du bord.
Dans l’emploi décoratif de la plante il im-
porte d’avoir constamment égard au mouve-
ment qui est propre à l’espèce employée. Ce
serait une faute et un non-sens d’enrouler des
tiges rigides et de donner des formes rigides
à des plantes souples et flexibles. On peut, on
doit simplifier les détails et les formes données
— 187 —
parallèles (fig. S). Du même point nous décri-
rons un arc de cercle qui déterminera les centres
des petites circonférences enveloppant les
fleurs. Une verticale passant au centre o, mar-
quera l’axe de la feuille médiane. Le triangle
a, b, c limitera les sommets des feuilles et don-
nera les axes des feuilles obliques.
Pour dessiner les fleurs nous procéderons
comme il a été dit, ci-dessus, pour la stylisation
de la fleur, fig. 2.
La peinture laisse au décorateur la facilité
de reproduire les détails des pétales, des éta-
mines, des échancrures de la feuille et de
ses nervures. L’emploi de la même plante en
mosaïque demandera une simplification de
formes en rapport avec la matière mise en œu-
vre. Il est évident que les petits cubes de
fig. 4
marbre utilisés par le mosaïste, ne permettent
pas les détails et qu’une recherche de l’effet et
du caractère de la plante par les masses s’im-
pose à la composition (fig. 4). On ne peut non
plus, dans la mosaïque ordinaire, dégrader les
tons. Chaque cube de marbre aura sa couleur
propre, mais la nervure des feuilles et le pistil
des fleurs pourront s’indiquer par une couleur
particulière.
On obtient aussi des dégradés fort jolis dan;
les mosaïques d’une certaine importance, en
employant des pierres de nuances diverses dans
un même ton. A distance, l’effet obtenu paraît
très satisfaisant.
Pour construire le motif fig. 4, on tracera
d’abord le cercle enveloppant les feuilles et qui
donnera les axes des fleurs, 1. 2. 3. Du point c
on tracera les obliques qui seront les axes des
feuilles. On supprimera les tiges des fleurs,
parce que leur construction avec la pierre cau-
serait de trop grandes difficultés, pour un motif
réduit, et que ce détail nuirait à l’effet général
au lieu de lui devenir avantageux.
Si l’on utilise le même élément floral pour le
vitrail (fig. 5), on dessinera d’abord les ban-
des limitant la largeur du champ à décorer,
puis on tracera les plombs.
Le vitrail permet un dessin aussi poussé que
celui de la peinture décorative, mais comme
ce motif doit être vu par transparence on évi-
tera les minuties que
ronge la lumière. Le vi-
trail demande une franche
opposition de tons et
l’emploi des couleurs
complémentaires.
Dans le sujet, fig. 5,
la coloration des fonds
sera différente pour les
fleurs et pour les feuilles,
et pour les deux bordu-
res verticales qui for-
ment l’encadrement.
La primevère appli-
quée au décor d’une boîte
à bijoux en métal repoussé permet une grande
liberté de composition. Nous donnons, dans le
sujet (fig. 6), des feuilles qui se recouvrent et
une fleur de profil. Un modelé plus ou moins
vigoureux réalisera l’effet attendu qu’on obtient
facilement dans ce genre de décor.
S’il s’agit d’une broderie, le dessin variera
selon le genre employé. Pour la broderie Ri-
chelieu (fig. 7), des formes trop maigres ne
donneraient pas un bon résultat. On pourra
donc exagérer l’ampleur des feuilles et des
fleurs et, pour celles-ci, supprimer les tiges. Un
jour complétera le décor et un effilé de largeur
convenable corrigera la sécheresse du bord.
Dans l’emploi décoratif de la plante il im-
porte d’avoir constamment égard au mouve-
ment qui est propre à l’espèce employée. Ce
serait une faute et un non-sens d’enrouler des
tiges rigides et de donner des formes rigides
à des plantes souples et flexibles. On peut, on
doit simplifier les détails et les formes données
— 187 —