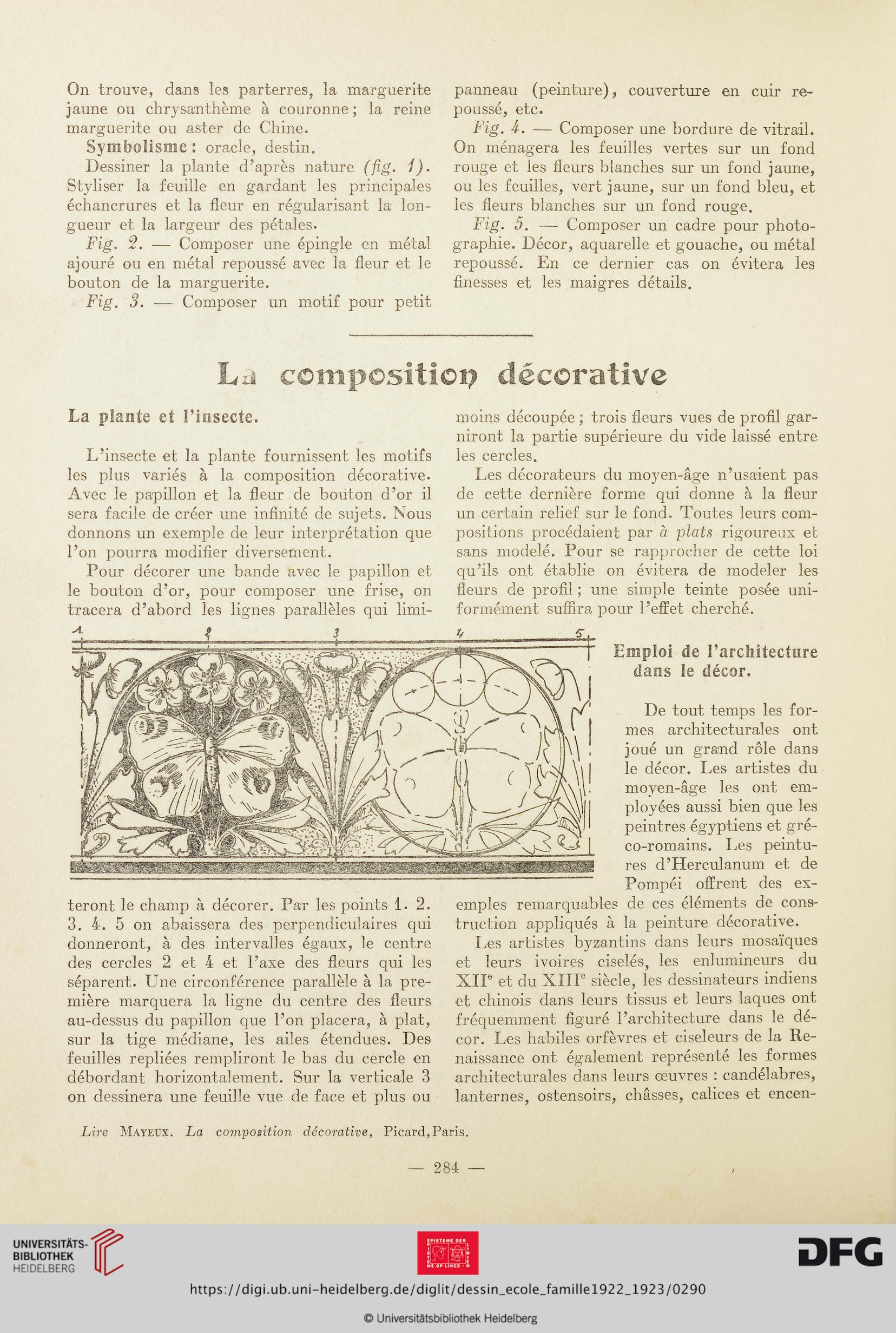On trouve, dans les parterres, la marguerite
jaune ou chrysanthème à couronne; la reine
marguerite ou aster de Chine.
Symbolisme : oracle, destin.
Dessiner la plante d’après nature (fig. 1).
Styliser la feuille en gardant les principales
échancrures et la fleur en régularisant la lon-
gueur et la largeur des pétales.
Fig. <2. — Composer une épingle en métal
ajouré ou en métal repoussé avec la fleur et le
bouton de la marguerite.
Fig. 3. — Composer un motif pour petit
panneau (peinture), couverture en cuir re-
poussé, etc.
Fig. 4. — Composer une bordure de vitrail.
On ménagera les feuilles vertes sur un fond
rouge et les fleurs blanches sur un fond jaune,
ou les feuilles, vert jaune, sur un fond bleu, et
les fleurs blanches sur un fond rouge.
Fig. 5. — Composer un cadre pour photo-
graphie. Décor, aquarelle et gouache, ou métal
repoussé. En ce dernier cas on évitera les
finesses et les maigres détails.
Lié composition? décorative
La plante et l’insecte.
L’insecte et la plante fournissent les motifs
les plus variés à la composition décorative.
Avec le papillon et la fleur de bouton d’or il
sera facile de créer une infinité de sujets. Nous
donnons un exemple de leur interprétation que
l’on pourra modifier diversement.
Pour décorer une bande avec le papillon et
le bouton d’or, pour composer une frise, on
tracera d’abord les lignes parallèles qui limi-
moins découpée ; trois fleurs vues de profil gar-
niront la partie supérieure du vide laissé entre
les cercles.
Les décorateurs du moyen-âge n’usaient pas
de cette dernière forme qui donne à la fleur
un cei'tain relief sur le fond. Toutes leurs com-
positions procédaient par à plats rigoureux et
sans modelé. Pour se rapprocher de cette loi
qu’ils ont établie on évitera de modeler les
fleurs de profil ; une simple teinte posée uni-
formément suffira pour l’effet cherché.
Emploi de l’architecture
dans le décor.
De tout temps les for-
mes architecturales ont
joué un grand rôle dans
le décor. Les artistes du
moyen-âge les ont em-
ployées aussi bien que les
peintres égyptiens et gré-
co-romains. Les peintu-
res d’LIerculanum et de
Pompéi offrent des ex-
teront le champ à décorer. Par les points 1. 2.
3. 4. 5 on abaissera des perpendiculaires qui
donneront, à des intervalles égaux, le centre
des cercles 2 et 4 et l’axe des fleurs qui les
séparent. Une circonférence parallèle à la pre-
mière marquera la ligne du centre des fleurs
au-dessus du papillon que l’on placera, à plat,
sur la tige médiane, les ailes étendues. Des
feuilles repliées rempliront le bas du cercle en
débordant horizontalement. Sur la verticale 3
on dessinera une feuille vue de face et plus ou
emples remarquables de ces éléments de cons-
truction appliqués à la peinture décorative.
Les artistes byzantins dans leurs mosaïques
et leurs ivoires ciselés, les enlumineurs du
XTP et du XIIIe siècle, les dessinateurs indiens
et chinois dans leurs tissus et leurs laques ont
fréquemment figuré l’architecture dans le dé-
cor. Les habiles orfèvres et ciseleurs de la Re-
naissance ont également représenté les formes
architecturales dans leurs œuvres : candélabres,
lanternes, ostensoirs, châsses, calices et encen-
Lire Mayeux. La composition décorative, Picard,Paris.
— 284 —
jaune ou chrysanthème à couronne; la reine
marguerite ou aster de Chine.
Symbolisme : oracle, destin.
Dessiner la plante d’après nature (fig. 1).
Styliser la feuille en gardant les principales
échancrures et la fleur en régularisant la lon-
gueur et la largeur des pétales.
Fig. <2. — Composer une épingle en métal
ajouré ou en métal repoussé avec la fleur et le
bouton de la marguerite.
Fig. 3. — Composer un motif pour petit
panneau (peinture), couverture en cuir re-
poussé, etc.
Fig. 4. — Composer une bordure de vitrail.
On ménagera les feuilles vertes sur un fond
rouge et les fleurs blanches sur un fond jaune,
ou les feuilles, vert jaune, sur un fond bleu, et
les fleurs blanches sur un fond rouge.
Fig. 5. — Composer un cadre pour photo-
graphie. Décor, aquarelle et gouache, ou métal
repoussé. En ce dernier cas on évitera les
finesses et les maigres détails.
Lié composition? décorative
La plante et l’insecte.
L’insecte et la plante fournissent les motifs
les plus variés à la composition décorative.
Avec le papillon et la fleur de bouton d’or il
sera facile de créer une infinité de sujets. Nous
donnons un exemple de leur interprétation que
l’on pourra modifier diversement.
Pour décorer une bande avec le papillon et
le bouton d’or, pour composer une frise, on
tracera d’abord les lignes parallèles qui limi-
moins découpée ; trois fleurs vues de profil gar-
niront la partie supérieure du vide laissé entre
les cercles.
Les décorateurs du moyen-âge n’usaient pas
de cette dernière forme qui donne à la fleur
un cei'tain relief sur le fond. Toutes leurs com-
positions procédaient par à plats rigoureux et
sans modelé. Pour se rapprocher de cette loi
qu’ils ont établie on évitera de modeler les
fleurs de profil ; une simple teinte posée uni-
formément suffira pour l’effet cherché.
Emploi de l’architecture
dans le décor.
De tout temps les for-
mes architecturales ont
joué un grand rôle dans
le décor. Les artistes du
moyen-âge les ont em-
ployées aussi bien que les
peintres égyptiens et gré-
co-romains. Les peintu-
res d’LIerculanum et de
Pompéi offrent des ex-
teront le champ à décorer. Par les points 1. 2.
3. 4. 5 on abaissera des perpendiculaires qui
donneront, à des intervalles égaux, le centre
des cercles 2 et 4 et l’axe des fleurs qui les
séparent. Une circonférence parallèle à la pre-
mière marquera la ligne du centre des fleurs
au-dessus du papillon que l’on placera, à plat,
sur la tige médiane, les ailes étendues. Des
feuilles repliées rempliront le bas du cercle en
débordant horizontalement. Sur la verticale 3
on dessinera une feuille vue de face et plus ou
emples remarquables de ces éléments de cons-
truction appliqués à la peinture décorative.
Les artistes byzantins dans leurs mosaïques
et leurs ivoires ciselés, les enlumineurs du
XTP et du XIIIe siècle, les dessinateurs indiens
et chinois dans leurs tissus et leurs laques ont
fréquemment figuré l’architecture dans le dé-
cor. Les habiles orfèvres et ciseleurs de la Re-
naissance ont également représenté les formes
architecturales dans leurs œuvres : candélabres,
lanternes, ostensoirs, châsses, calices et encen-
Lire Mayeux. La composition décorative, Picard,Paris.
— 284 —