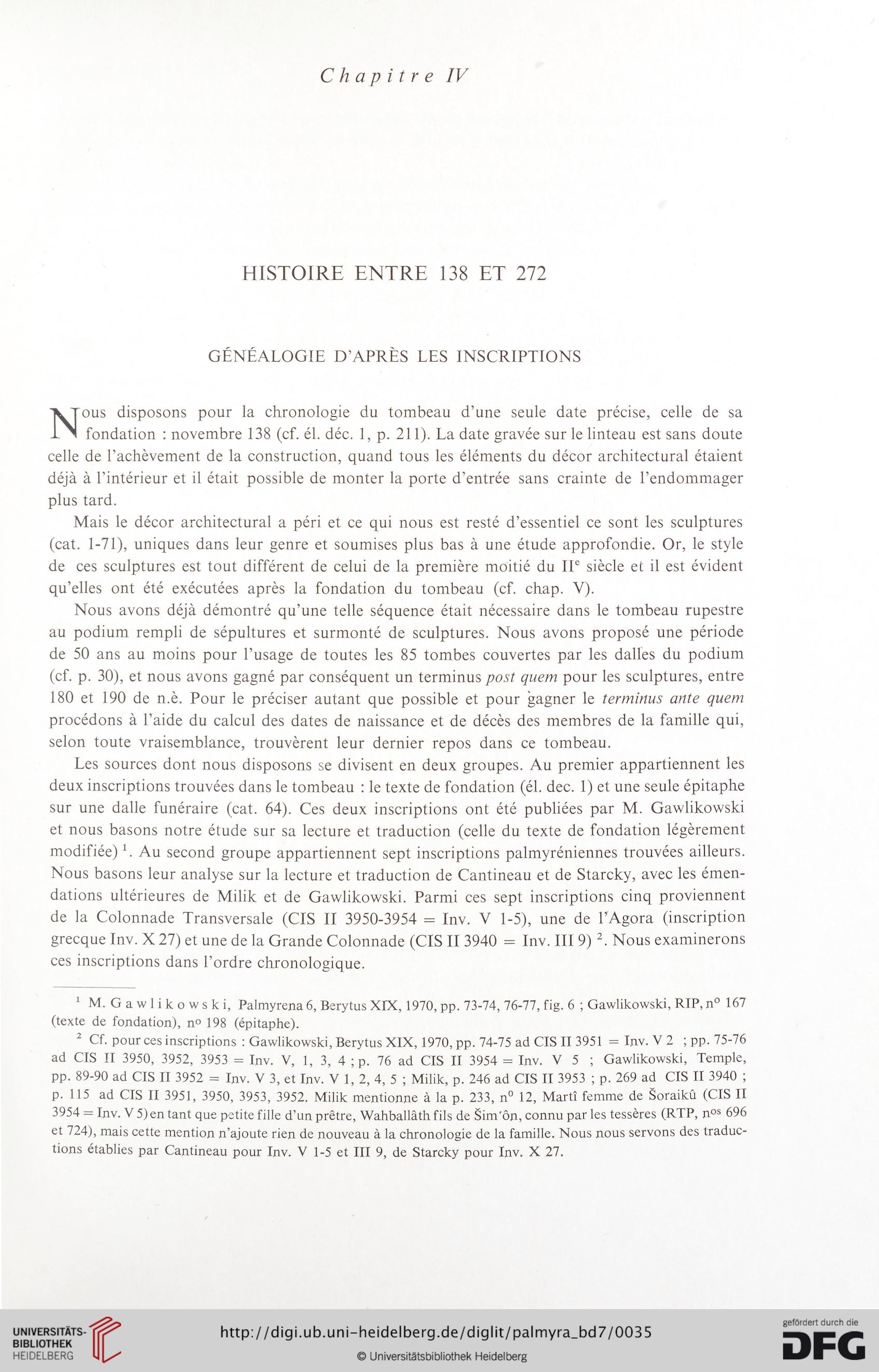Chapitre IV
HISTOIRE ENTRE 138 ET 272
GÉNÉALOGIE D’APRÈS LES INSCRIPTIONS
Nous disposons pour la chronologie du tombeau d’une seule date précise, celle de sa
fondation : novembre 138 (cf. él. déc. 1, p. 211). La date gravée sur le linteau est sans doute
celle de l’achèvement de la construction, quand tous les éléments du décor architectural étaient
déjà à l’intérieur et il était possible de monter la porte d’entrée sans crainte de l’endommager
plus tard.
Mais le décor architectural a péri et ce qui nous est resté d’essentiel ce sont les sculptures
(cat. 1-71), uniques dans leur genre et soumises plus bas à une étude approfondie. Or, le style
de ces sculptures est tout différent de celui de la première moitié du IIe siècle et il est évident
qu’elles ont été exécutées après la fondation du tombeau (cf. chap. Y).
Nous avons déjà démontré qu’une telle séquence était nécessaire dans le tombeau rupestre
au podium rempli de sépultures et surmonté de sculptures. Nous avons proposé une période
de 50 ans au moins pour l’usage de toutes les 85 tombes couvertes par les dalles du podium
(cf. p. 30), et nous avons gagné par conséquent un terminus post quem pour les sculptures, entre
180 et 190 de n.è. Pour le préciser autant que possible et pour gagner le terminus ante quem
procédons à l’aide du calcul des dates de naissance et de décès des membres de la famille qui,
selon toute vraisemblance, trouvèrent leur dernier repos dans ce tombeau.
Les sources dont nous disposons se divisent en deux groupes. Au premier appartiennent les
deux inscriptions trouvées dans le tombeau : le texte de fondation (él. dec. 1) et une seule épitaphe
sur une dalle funéraire (cat. 64). Ces deux inscriptions ont été publiées par M. Gawlikowski
et nous basons notre étude sur sa lecture et traduction (celle du texte de fondation légèrement
modifiée) h Au second groupe appartiennent sept inscriptions palmyréniennes trouvées ailleurs.
Nous basons leur analyse sur la lecture et traduction de Cantineau et de Starcky, avec les émen-
dations ultérieures de Milik et de Gawlikowski. Parmi ces sept inscriptions cinq proviennent
de la Colonnade Transversale (CIS II 3950-3954 = Inv. V 1-5), une de l’Agora (inscription
grecque Inv. X 27) et une de la Grande Colonnade (CIS II 3940 = Inv. III 9) 1 2. Nous examinerons
ces inscriptions dans l’ordre chronologique.
1 M. Gawlikowski, Palmyrena 6, Berytus XIX, 1970, pp. 73-74, 76-77, fig. 6 ; Gawlikowski, RIP, n° 167
(texte de fondation), n° 198 (épitaphe).
2 Cf. pour ces inscriptions : Gawlikowski, Berytus XIX, 1970, pp. 74-75 ad CIS II 3951 = Inv. V 2 ; pp. 75-76
ad CIS II 3950, 3952, 3953 = Inv. V, 1, 3, 4 ; p. 76 ad CIS II 3954 = Inv. V 5 ; Gawlikowski, Temple,
pp. 89-90 ad CIS II 3952 = Inv. V 3, et Inv. V 1, 2, 4, 5 ; Milik, p. 246 ad CIS II 3953 ; p. 269 ad CIS II 3940 ;
p. 115 ad CIS II 3951, 3950, 3953, 3952. Milik mentionne à la p. 233, n° 12, Marti femme de Soraikû (CIS II
3954 = Inv. V 5)en tant que petite fille d’un prêtre, Wahballâth fils de Sim'ôn, connu par les tessères (RTP, nos 696
et 724), mais cette mention n’ajoute rien de nouveau à la chronologie de la famille. Nous nous servons des traduc-
tions établies par Cantineau pour Inv. V 1-5 et III 9, de Starcky pour Inv. X 27.
HISTOIRE ENTRE 138 ET 272
GÉNÉALOGIE D’APRÈS LES INSCRIPTIONS
Nous disposons pour la chronologie du tombeau d’une seule date précise, celle de sa
fondation : novembre 138 (cf. él. déc. 1, p. 211). La date gravée sur le linteau est sans doute
celle de l’achèvement de la construction, quand tous les éléments du décor architectural étaient
déjà à l’intérieur et il était possible de monter la porte d’entrée sans crainte de l’endommager
plus tard.
Mais le décor architectural a péri et ce qui nous est resté d’essentiel ce sont les sculptures
(cat. 1-71), uniques dans leur genre et soumises plus bas à une étude approfondie. Or, le style
de ces sculptures est tout différent de celui de la première moitié du IIe siècle et il est évident
qu’elles ont été exécutées après la fondation du tombeau (cf. chap. Y).
Nous avons déjà démontré qu’une telle séquence était nécessaire dans le tombeau rupestre
au podium rempli de sépultures et surmonté de sculptures. Nous avons proposé une période
de 50 ans au moins pour l’usage de toutes les 85 tombes couvertes par les dalles du podium
(cf. p. 30), et nous avons gagné par conséquent un terminus post quem pour les sculptures, entre
180 et 190 de n.è. Pour le préciser autant que possible et pour gagner le terminus ante quem
procédons à l’aide du calcul des dates de naissance et de décès des membres de la famille qui,
selon toute vraisemblance, trouvèrent leur dernier repos dans ce tombeau.
Les sources dont nous disposons se divisent en deux groupes. Au premier appartiennent les
deux inscriptions trouvées dans le tombeau : le texte de fondation (él. dec. 1) et une seule épitaphe
sur une dalle funéraire (cat. 64). Ces deux inscriptions ont été publiées par M. Gawlikowski
et nous basons notre étude sur sa lecture et traduction (celle du texte de fondation légèrement
modifiée) h Au second groupe appartiennent sept inscriptions palmyréniennes trouvées ailleurs.
Nous basons leur analyse sur la lecture et traduction de Cantineau et de Starcky, avec les émen-
dations ultérieures de Milik et de Gawlikowski. Parmi ces sept inscriptions cinq proviennent
de la Colonnade Transversale (CIS II 3950-3954 = Inv. V 1-5), une de l’Agora (inscription
grecque Inv. X 27) et une de la Grande Colonnade (CIS II 3940 = Inv. III 9) 1 2. Nous examinerons
ces inscriptions dans l’ordre chronologique.
1 M. Gawlikowski, Palmyrena 6, Berytus XIX, 1970, pp. 73-74, 76-77, fig. 6 ; Gawlikowski, RIP, n° 167
(texte de fondation), n° 198 (épitaphe).
2 Cf. pour ces inscriptions : Gawlikowski, Berytus XIX, 1970, pp. 74-75 ad CIS II 3951 = Inv. V 2 ; pp. 75-76
ad CIS II 3950, 3952, 3953 = Inv. V, 1, 3, 4 ; p. 76 ad CIS II 3954 = Inv. V 5 ; Gawlikowski, Temple,
pp. 89-90 ad CIS II 3952 = Inv. V 3, et Inv. V 1, 2, 4, 5 ; Milik, p. 246 ad CIS II 3953 ; p. 269 ad CIS II 3940 ;
p. 115 ad CIS II 3951, 3950, 3953, 3952. Milik mentionne à la p. 233, n° 12, Marti femme de Soraikû (CIS II
3954 = Inv. V 5)en tant que petite fille d’un prêtre, Wahballâth fils de Sim'ôn, connu par les tessères (RTP, nos 696
et 724), mais cette mention n’ajoute rien de nouveau à la chronologie de la famille. Nous nous servons des traduc-
tions établies par Cantineau pour Inv. V 1-5 et III 9, de Starcky pour Inv. X 27.