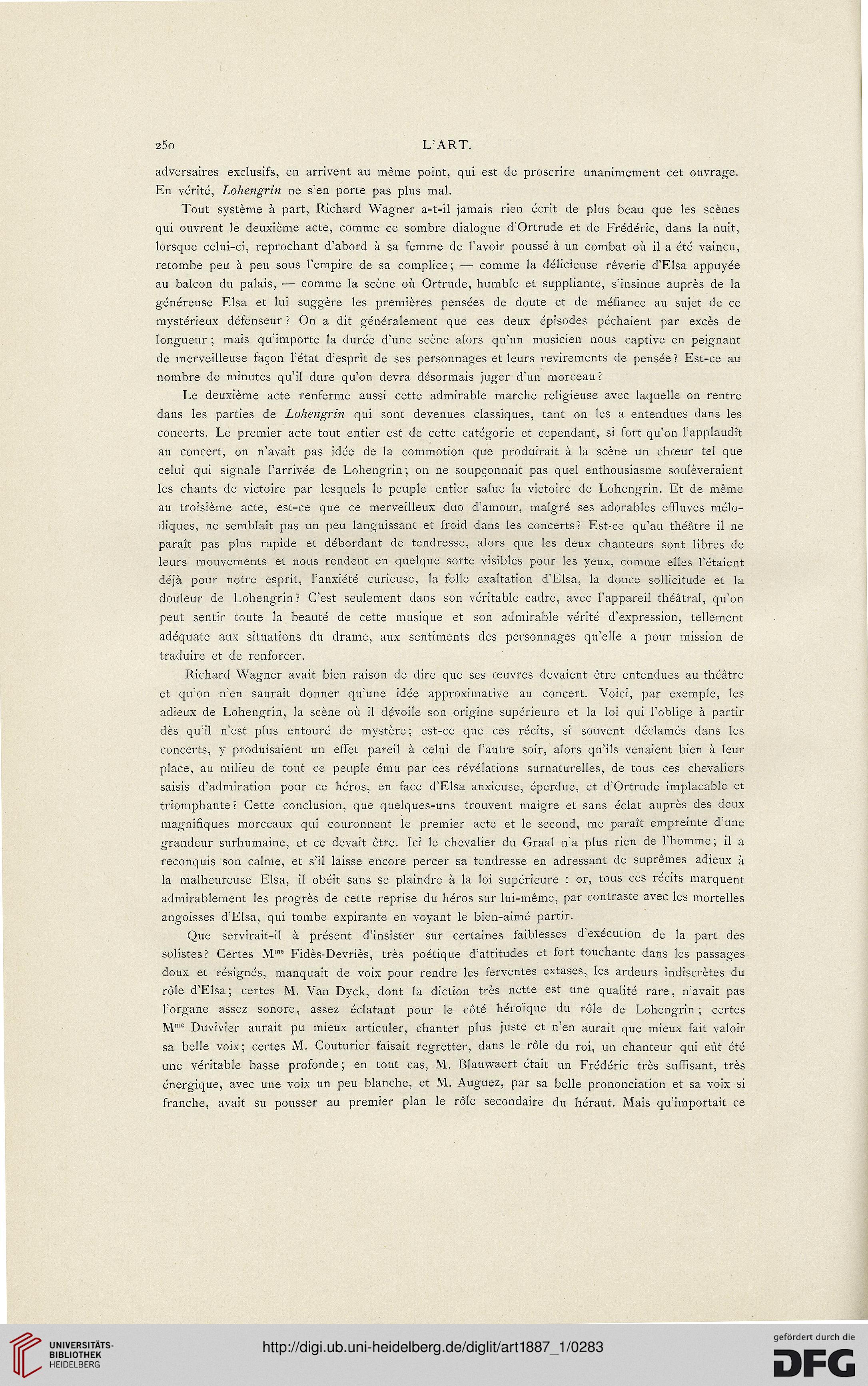25o
L’ART.
adversaires exclusifs, en arrivent au même point, qui est de proscrire unanimement cet ouvrage.
En vérité, Lohengrin ne s’en porte pas plus mal.
Tout système à part, Richard Wagner a-t-il jamais rien écrit de plus beau que les scènes
qui ouvrent le deuxième acte, comme ce sombre dialogue d’Ortrude et de Frédéric, dans la nuit,
lorsque celui-ci, reprochant d’abord à sa femme de l’avoir poussé à un combat où il a été vaincu,
retombe peu à peu sous l’empire de sa complice; — comme la délicieuse rêverie d’Eisa appuyée
au balcon du palais, — comme la scène où Ortrude, humble et suppliante, s’insinue auprès de la
généreuse Eisa et lui suggère les premières pensées de doute et de méfiance au sujet de ce
mystérieux défenseur ? On a dit généralement que ces deux épisodes péchaient par excès de
longueur ; mais qu’importe la durée d’une scène alors qu’un musicien nous captive en peignant
de merveilleuse façon l'état d’esprit de ses personnages et leurs revirements de pensée? Est-ce au
nombre de minutes qu’il dure qu’on devra désormais juger d’un morceau?
Le deuxième acte renferme aussi cette admirable marche religieuse avec laquelle on rentre
dans les parties de Lohengrin qui sont devenues classiques, tant on les a entendues dans les
concerts. Le premier acte tout entier est de cette catégorie et cependant, si fort qu’on l’applaudît
au concert, on n’avait pas idée de la commotion que produirait à la scène un choeur tel que
celui qui signale l’arrivée de Lohengrin ; on ne soupçonnait pas quel enthousiasme soulèveraient
les chants de victoire par lesquels le peuple entier salue la victoire de Lohengrin. Et de même
au troisième acte, est-ce que ce merveilleux duo d’amour, malgré ses adorables effluves mélo-
diques, ne semblait pas un peu languissant et froid dans les concerts? Est-ce qu’au théâtre il ne
paraît pas plus rapide et débordant de tendresse, alors que les deux chanteurs sont libres de
leurs mouvements et nous rendent en quelque sorte visibles pour les yeux, comme elles l’étaient
déjà pour notre esprit, l’anxiété curieuse, la folle exaltation d’Eisa, la douce sollicitude et la
douleur de Lohengrin? C’est seulement dans son véritable cadre, avec l’appareil théâtral, qu’on
peut sentir toute la beauté de cette musique et son admirable vérité d’expression, tellement
adéquate aux situations dù drame, aux sentiments des personnages qu’elle a pour mission de
traduire et de renforcer.
Richard Wagner avait bien raison de dire que ses oeuvres devaient être entendues au théâtre
et qu’on n’en saurait donner qu’une idée approximative au concert. Voici, par exemple, les
adieux de Lohengrin, la scène où il dévoile son origine supérieure et la loi qui l’oblige à partir
dès qu’il n’est plus entouré de mystère; est-ce que ces récits, si souvent déclamés dans les
concerts, y produisaient un effet pareil à celui de l’autre soir, alors qu’ils venaient bien à leur
place, au milieu de tout ce peuple ému par ces révélations surnaturelles, de tous ces chevaliers
saisis d’admiration pour ce héros, en face d’Eisa anxieuse, éperdue, et d’Ortrude implacable et
triomphante? Cette conclusion, que quelques-uns trouvent maigre et sans éclat auprès des deux
magnifiques morceaux qui couronnent le premier acte et le second, me paraît empreinte d’une
grandeur surhumaine, et ce devait être. Ici le chevalier du Graal n'a plus rien de 1 homme; il a
reconquis son calme, et s’il laisse encore percer sa tendresse en adressant de suprêmes adieux à
la malheureuse Eisa, il obéit sans se plaindre à la loi supérieure : or, tous ces récits marquent
admirablement les progrès de cette reprise du héros sur lui-même, par contraste avec les mortelles
angoisses d’Eisa, qui tombe expirante en voyant le bien-aimé partir.
Que servirait-il à présent d’insister sur certaines faiblesses d exécution de la part des
solistes? Certes Mine Fidès-Devriès, très poétique d’attitudes et fort touchante dans les passages
doux et résignés, manquait de voix pour rendre les ferventes extases, les ardeurs indiscrètes du
rôle d’Eisa; certes M. Van Dyck, dont la diction très nette est une qualité rare, n’avait pas
l’organe assez sonore, assez éclatant pour le côté héroïque du rôle de Lohengrin ; certes
Mme Duvivier aurait pu mieux articuler, chanter plus juste et n’en aurait que mieux fait valoir
sa belle voix; certes M. Couturier faisait regretter, dans le rôle du roi, un chanteur qui eût été
une véritable basse profonde; en tout cas, M. Blauwaert était un Frédéric très suffisant, très
énergique, avec une voix un peu blanche, et M. Auguez, par sa belle prononciation et sa voix si
franche, avait su pousser au premier plan le rôle secondaire du héraut. Mais qu’importait ce
L’ART.
adversaires exclusifs, en arrivent au même point, qui est de proscrire unanimement cet ouvrage.
En vérité, Lohengrin ne s’en porte pas plus mal.
Tout système à part, Richard Wagner a-t-il jamais rien écrit de plus beau que les scènes
qui ouvrent le deuxième acte, comme ce sombre dialogue d’Ortrude et de Frédéric, dans la nuit,
lorsque celui-ci, reprochant d’abord à sa femme de l’avoir poussé à un combat où il a été vaincu,
retombe peu à peu sous l’empire de sa complice; — comme la délicieuse rêverie d’Eisa appuyée
au balcon du palais, — comme la scène où Ortrude, humble et suppliante, s’insinue auprès de la
généreuse Eisa et lui suggère les premières pensées de doute et de méfiance au sujet de ce
mystérieux défenseur ? On a dit généralement que ces deux épisodes péchaient par excès de
longueur ; mais qu’importe la durée d’une scène alors qu’un musicien nous captive en peignant
de merveilleuse façon l'état d’esprit de ses personnages et leurs revirements de pensée? Est-ce au
nombre de minutes qu’il dure qu’on devra désormais juger d’un morceau?
Le deuxième acte renferme aussi cette admirable marche religieuse avec laquelle on rentre
dans les parties de Lohengrin qui sont devenues classiques, tant on les a entendues dans les
concerts. Le premier acte tout entier est de cette catégorie et cependant, si fort qu’on l’applaudît
au concert, on n’avait pas idée de la commotion que produirait à la scène un choeur tel que
celui qui signale l’arrivée de Lohengrin ; on ne soupçonnait pas quel enthousiasme soulèveraient
les chants de victoire par lesquels le peuple entier salue la victoire de Lohengrin. Et de même
au troisième acte, est-ce que ce merveilleux duo d’amour, malgré ses adorables effluves mélo-
diques, ne semblait pas un peu languissant et froid dans les concerts? Est-ce qu’au théâtre il ne
paraît pas plus rapide et débordant de tendresse, alors que les deux chanteurs sont libres de
leurs mouvements et nous rendent en quelque sorte visibles pour les yeux, comme elles l’étaient
déjà pour notre esprit, l’anxiété curieuse, la folle exaltation d’Eisa, la douce sollicitude et la
douleur de Lohengrin? C’est seulement dans son véritable cadre, avec l’appareil théâtral, qu’on
peut sentir toute la beauté de cette musique et son admirable vérité d’expression, tellement
adéquate aux situations dù drame, aux sentiments des personnages qu’elle a pour mission de
traduire et de renforcer.
Richard Wagner avait bien raison de dire que ses oeuvres devaient être entendues au théâtre
et qu’on n’en saurait donner qu’une idée approximative au concert. Voici, par exemple, les
adieux de Lohengrin, la scène où il dévoile son origine supérieure et la loi qui l’oblige à partir
dès qu’il n’est plus entouré de mystère; est-ce que ces récits, si souvent déclamés dans les
concerts, y produisaient un effet pareil à celui de l’autre soir, alors qu’ils venaient bien à leur
place, au milieu de tout ce peuple ému par ces révélations surnaturelles, de tous ces chevaliers
saisis d’admiration pour ce héros, en face d’Eisa anxieuse, éperdue, et d’Ortrude implacable et
triomphante? Cette conclusion, que quelques-uns trouvent maigre et sans éclat auprès des deux
magnifiques morceaux qui couronnent le premier acte et le second, me paraît empreinte d’une
grandeur surhumaine, et ce devait être. Ici le chevalier du Graal n'a plus rien de 1 homme; il a
reconquis son calme, et s’il laisse encore percer sa tendresse en adressant de suprêmes adieux à
la malheureuse Eisa, il obéit sans se plaindre à la loi supérieure : or, tous ces récits marquent
admirablement les progrès de cette reprise du héros sur lui-même, par contraste avec les mortelles
angoisses d’Eisa, qui tombe expirante en voyant le bien-aimé partir.
Que servirait-il à présent d’insister sur certaines faiblesses d exécution de la part des
solistes? Certes Mine Fidès-Devriès, très poétique d’attitudes et fort touchante dans les passages
doux et résignés, manquait de voix pour rendre les ferventes extases, les ardeurs indiscrètes du
rôle d’Eisa; certes M. Van Dyck, dont la diction très nette est une qualité rare, n’avait pas
l’organe assez sonore, assez éclatant pour le côté héroïque du rôle de Lohengrin ; certes
Mme Duvivier aurait pu mieux articuler, chanter plus juste et n’en aurait que mieux fait valoir
sa belle voix; certes M. Couturier faisait regretter, dans le rôle du roi, un chanteur qui eût été
une véritable basse profonde; en tout cas, M. Blauwaert était un Frédéric très suffisant, très
énergique, avec une voix un peu blanche, et M. Auguez, par sa belle prononciation et sa voix si
franche, avait su pousser au premier plan le rôle secondaire du héraut. Mais qu’importait ce