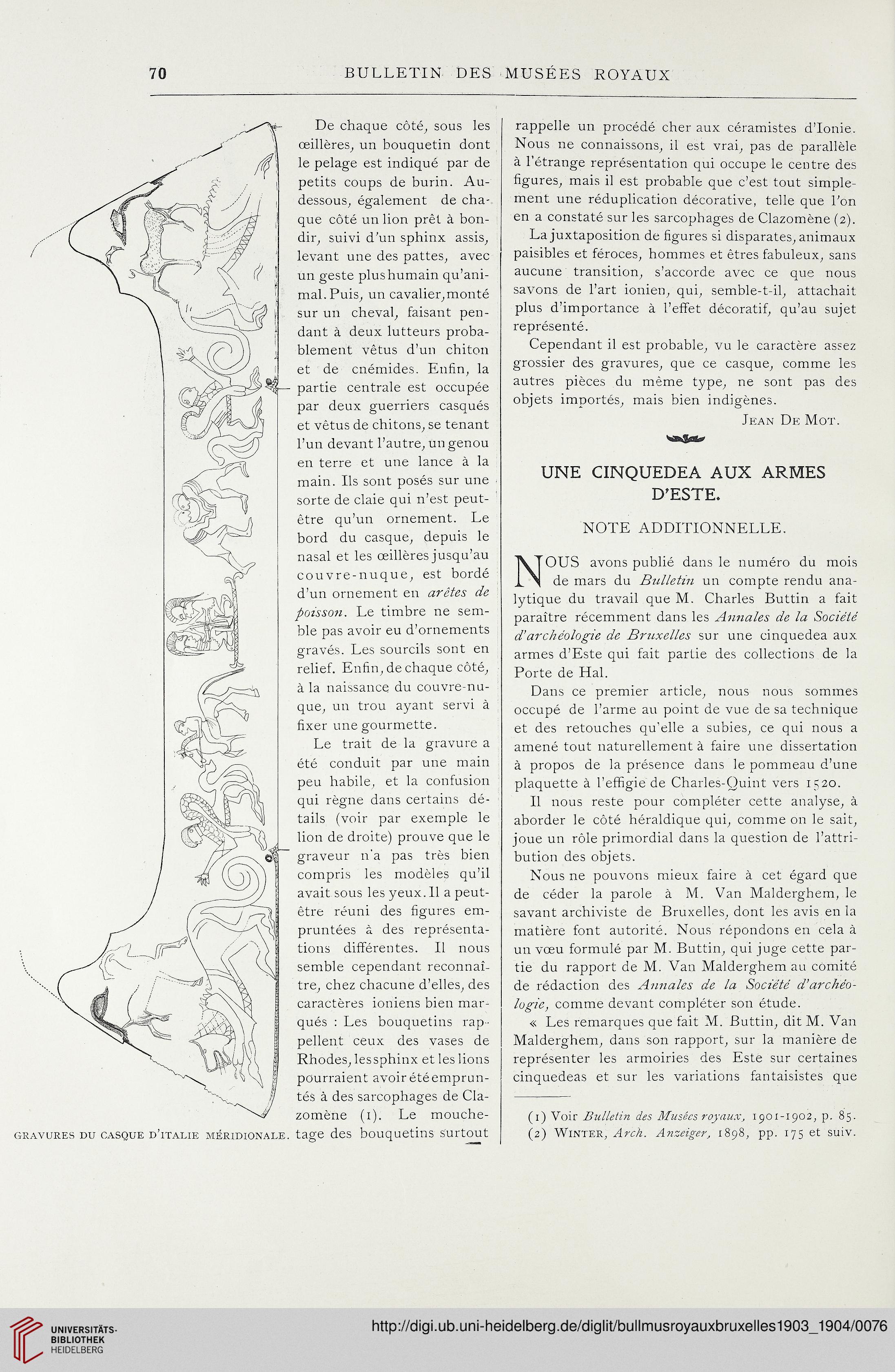70
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
GRAVURES DU CASQUE D’iTALIE MÉRIDIONALE.
De chaque côté, sous les
œillères, un bouquetin dont
le pelage est indiqué par de
petits coups de burin. Au-
dessous, également de cha-
que côté un lion prêt à bon-
dir, suivi d'un sphinx assis,
levant une des pattes, avec
un geste plushumain qu’ani-
mal. Puis, un cavalier, monté
sur un cheval, faisant pen-
dant à deux lutteurs proba-
blement vêtus d’un chiton
et de cnémides. Enfin, la
partie centrale est occupée
par deux guerriers casqués
et vêtus de chitons, se tenant
l’un devant l’autre, un genou
en terre et une lance à la
main. Ils sont posés sur une
sorte de claie qui n’est peut-
être qu’un ornement. Le
bord du casque, depuis le
nasal et les œillères jusqu’au
couvre-nu que, est bordé
d’un ornement en arêtes de
poisson. Le timbre ne sem-
ble pas avoir eu d’ornements
gravés. Les sourcils sont en
relief. Enfin, de chaque côté,
à la naissance du couvre-nu-
que, un trou ayant servi à
fixer une gourmette.
Le trait de la gravure a
été conduit par une main
peu habile, et la confusion
qui règne dans certains dé-
tails (voir par exemple le
lion de droite) prouve que le
graveur n'a pas très bien
compris les modèles qu’il
avait.sous les yeux. 11 a peut-
être réuni des figures em-
pruntées à des représenta-
tions différentes. Il nous
semble cependant reconnaî-
tre, chez chacune d’elles, des
caractères ioniens bien mar-
qués : Les bouquetins rap-
pellent ceux des vases de
Rhodes, lessphinx et les lions
pourraient avoir été emprun-
tés à des sarcophages de Cla-
zomène (i). Le mouche-
tage des bouquetins surtout
rappelle un procédé cher aux céramistes d’Ionie.
Nous ne connaissons, il est vrai, pas de parallèle,
à l’étrange représentation qui occupe le centre des
figures, mais il est probable que c’est tout simple-
ment une réduplication décorative, telle que l’on
en a constaté sur les sarcophages de Clazomène (2).
La juxtaposition de figures si disparates, animaux
paisibles et féroces, hommes et êtres fabuleux, sans
aucune transition, s’accorde avec ce que nous
savons de l’art ionien, qui, semble-t-il, attachait
plus d’importance à l’effet décoratif, qu’au sujet
représenté.
Cependant il est probable, vu le caractère assez
grossier des gravures, que ce casque, comme les
autres pièces du même type, ne sont pas des
objets importés, mais bien indigènes.
Jean De Mot.
UNE CINQUEDEA AUX ARMES
D’ESTE.
NOTE ADDITIONNELLE.
NOUS avons publié dans le numéro du mois
de mars du Bulletin un compte rendu ana-
lytique du travail que M. Charles Buttin a fait
paraître récemment dans les Annales de la Société
d’archéologie de Bruxelles sur une cinquedea aux
armes d’Este qui fait partie des collections de la
Porte de Hal.
Dans ce premier article, nous nous sommes
occupé de l’arme au point de vue de sa technique
et des retouches qu’elle a subies, ce qui nous a
amené tout naturellement à faire une dissertation
à propos de la présence dans le pommeau d’une
plaquette à l’effigie de Charles-Quint vers 1520.
Il nous reste pour compléter cette analyse, à
aborder le côté héraldique qui, comme on le sait,
joue un rôle primordial dans la question de l’attri-
bution des objets.
Nous ne pouvons mieux faire à cet égard que
de céder la parole à M. Van Malderghem, le
savant archiviste de Bruxelles, dont les avis en la
matière font autorité. Nous répondons en cela à
un vœu formulé par M. Buttin, qui juge cette par-
tie du rapport de M. Van Malderghem au comité
de rédaction des Annales de la Société d’archéo-
logie, comme devant compléter son étude.
« Les remarques que fait M. Buttin, dit M. Van
Malderghem, dans son rapport, sur la manière de
représenter les armoiries des Este sur certaines
cinquedeas et sur les variations fantaisistes que
(1) Voir Bulletin des Musées royaux, 1901-1902, p. 85.
(2) Winter, Arch. Anzeiger, 1898, pp. 175 et suiv.
BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX
GRAVURES DU CASQUE D’iTALIE MÉRIDIONALE.
De chaque côté, sous les
œillères, un bouquetin dont
le pelage est indiqué par de
petits coups de burin. Au-
dessous, également de cha-
que côté un lion prêt à bon-
dir, suivi d'un sphinx assis,
levant une des pattes, avec
un geste plushumain qu’ani-
mal. Puis, un cavalier, monté
sur un cheval, faisant pen-
dant à deux lutteurs proba-
blement vêtus d’un chiton
et de cnémides. Enfin, la
partie centrale est occupée
par deux guerriers casqués
et vêtus de chitons, se tenant
l’un devant l’autre, un genou
en terre et une lance à la
main. Ils sont posés sur une
sorte de claie qui n’est peut-
être qu’un ornement. Le
bord du casque, depuis le
nasal et les œillères jusqu’au
couvre-nu que, est bordé
d’un ornement en arêtes de
poisson. Le timbre ne sem-
ble pas avoir eu d’ornements
gravés. Les sourcils sont en
relief. Enfin, de chaque côté,
à la naissance du couvre-nu-
que, un trou ayant servi à
fixer une gourmette.
Le trait de la gravure a
été conduit par une main
peu habile, et la confusion
qui règne dans certains dé-
tails (voir par exemple le
lion de droite) prouve que le
graveur n'a pas très bien
compris les modèles qu’il
avait.sous les yeux. 11 a peut-
être réuni des figures em-
pruntées à des représenta-
tions différentes. Il nous
semble cependant reconnaî-
tre, chez chacune d’elles, des
caractères ioniens bien mar-
qués : Les bouquetins rap-
pellent ceux des vases de
Rhodes, lessphinx et les lions
pourraient avoir été emprun-
tés à des sarcophages de Cla-
zomène (i). Le mouche-
tage des bouquetins surtout
rappelle un procédé cher aux céramistes d’Ionie.
Nous ne connaissons, il est vrai, pas de parallèle,
à l’étrange représentation qui occupe le centre des
figures, mais il est probable que c’est tout simple-
ment une réduplication décorative, telle que l’on
en a constaté sur les sarcophages de Clazomène (2).
La juxtaposition de figures si disparates, animaux
paisibles et féroces, hommes et êtres fabuleux, sans
aucune transition, s’accorde avec ce que nous
savons de l’art ionien, qui, semble-t-il, attachait
plus d’importance à l’effet décoratif, qu’au sujet
représenté.
Cependant il est probable, vu le caractère assez
grossier des gravures, que ce casque, comme les
autres pièces du même type, ne sont pas des
objets importés, mais bien indigènes.
Jean De Mot.
UNE CINQUEDEA AUX ARMES
D’ESTE.
NOTE ADDITIONNELLE.
NOUS avons publié dans le numéro du mois
de mars du Bulletin un compte rendu ana-
lytique du travail que M. Charles Buttin a fait
paraître récemment dans les Annales de la Société
d’archéologie de Bruxelles sur une cinquedea aux
armes d’Este qui fait partie des collections de la
Porte de Hal.
Dans ce premier article, nous nous sommes
occupé de l’arme au point de vue de sa technique
et des retouches qu’elle a subies, ce qui nous a
amené tout naturellement à faire une dissertation
à propos de la présence dans le pommeau d’une
plaquette à l’effigie de Charles-Quint vers 1520.
Il nous reste pour compléter cette analyse, à
aborder le côté héraldique qui, comme on le sait,
joue un rôle primordial dans la question de l’attri-
bution des objets.
Nous ne pouvons mieux faire à cet égard que
de céder la parole à M. Van Malderghem, le
savant archiviste de Bruxelles, dont les avis en la
matière font autorité. Nous répondons en cela à
un vœu formulé par M. Buttin, qui juge cette par-
tie du rapport de M. Van Malderghem au comité
de rédaction des Annales de la Société d’archéo-
logie, comme devant compléter son étude.
« Les remarques que fait M. Buttin, dit M. Van
Malderghem, dans son rapport, sur la manière de
représenter les armoiries des Este sur certaines
cinquedeas et sur les variations fantaisistes que
(1) Voir Bulletin des Musées royaux, 1901-1902, p. 85.
(2) Winter, Arch. Anzeiger, 1898, pp. 175 et suiv.