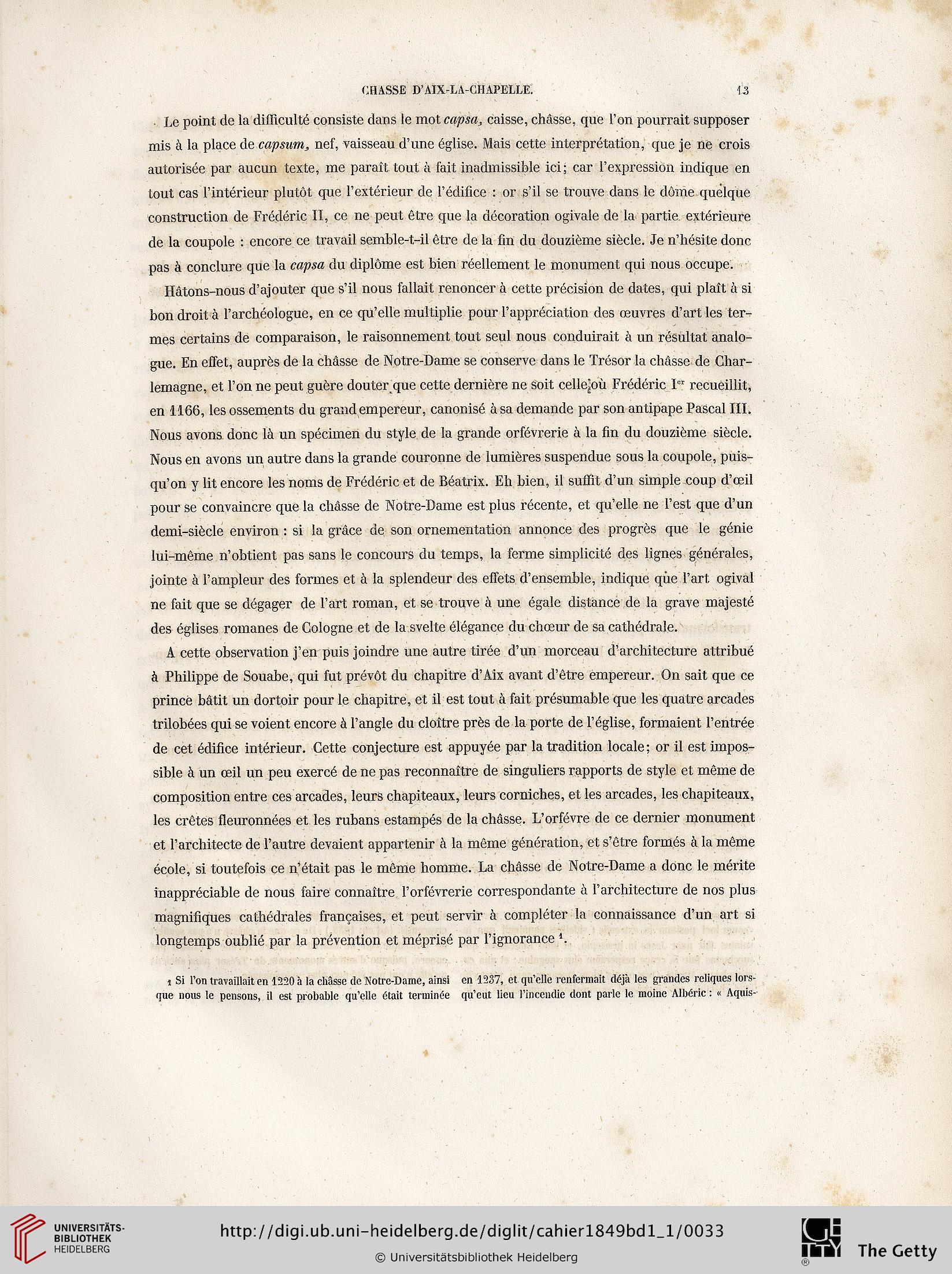CHASSE D'AIX-LA-CHAPELLE.
n
Le point de la difficulté consiste dans ie mot caisse, châsse, que l'on pourrait supposer
mis à la place de nef, vaisseau d'une église. Mais cette interprétation, que je ne crois
autorisée par aucun texte, me paraît tout à fait inadmissible ici; car l'expression indique en
tout cas l'intérieur plutôt que l'extérieur de l'édifice : or s'il se trouve dans le dôme quelque
construction de Frédéric ïï, ce ne peut être que la décoration ogivale de la partie extérieure
de la coupole : encore ce travail semble-t-il être de la fin du douzième siècle. Je n'hésite donc
pas à conclure que la du diplôme est bien réellement le monument qui nous occupe.
Hâtons-nous d'ajouter que s'il nous fallait renoncer à cette précision de dates, qui plaît à si
bon droit à l'archéologue, en ce qu'elle multiplie pour l'appréciation des œuvres d'art les ter-
mes certains de comparaison, le raisonnement tout seul nous conduirait à un résultat analo-
gue. En effet, auprès de la châsse de Notre-Dame se conserve dans le Trésor la châsse de Char-
lemagne, et l'on ne peut guère douter que cette dernière ne soit celle^où Frédéric I" recueillit,
en 1166, les ossements du grand empereur, canonisé à sa demande par son antipape Pascal III.
Nous avons donc là un spécimen du style de la grande orfèvrerie à la fin du douzième siècle.
Nous en avons un autre dans la grande couronne de lumières suspendue sous la coupole, puis-
qu'on y lit encore les noms de Frédéric et de Béatrix. Eh bien, il suffit d'un simple coup d'œil
pour se convaincre que ia châsse de Notre-Dame est plus récente, et qu'elle ne l'est que d'un
demi-siècle environ : si la grâce de son ornementation annonce des progrès que le génie
lui-même n'obtient pas sans le concours du temps, la ferme simplicité des lignes générales,
jointe à l'ampleur des formes et à la splendeur des effets d'ensemble, indique que l'art ogival
ne fait que se dégager de l'art roman, et se trouve à une égale distance de la grave majesté
des églises romanes de Cologne et de la svelte élégance du chœur de sa cathédrale.
A cette observation j'en puis joindre une autre tirée d'un morceau d'architecture attribué
à Philippe de Souabe, qui fut prévôt du chapitre d'Aix avant d'être empereur. On sait que ce
prince bâtit un dortoir pour le chapitre, et il est tout à fait présumable que les quatre arcades
trilobées qui se voient encore à l'angle du cloître près de la porte de l'église, formaient l'entrée
de cet édifice intérieur. Cette conjecture est appuyée par la tradition locale; or il est impos-
sible à un œil un peu exercé de ne pas reconnaître de singuliers rapports de style et même de
composition entre ces arcades, leurs chapiteaux, leurs corniches, et les arcades, les chapiteaux,
les crêtes fleuronnées et les rubans estampés de la châsse. L'orfèvre de ce dernier monument
et l'architecte de l'autre devaient appartenir à la même génération, et s'être formés à ia même
école, si toutefois ce n'était pas le même homme. La châsse de Notre-Dame a donc le mérite
inappréciable de nous faire connaître l'orfèvrerie correspondante à l'architecture de nos plus
magnifiques cathédrales françaises, et peut servir à compléter la connaissance d'un art si
longtemps oublié par la prévention et méprisé par l'ignorance L
i Si ton travaiiiait en 1320 à ia châsse de Notre-Dame, ainsi en 1237, et qu'ciic renfermait déjà ics grandes reliques iors-
que nous ie pensons, H est probabie qu'ciic était terminée qu'eut iieu l'incendie dont parie ie moine Aibéric : « Aquis-
n
Le point de la difficulté consiste dans ie mot caisse, châsse, que l'on pourrait supposer
mis à la place de nef, vaisseau d'une église. Mais cette interprétation, que je ne crois
autorisée par aucun texte, me paraît tout à fait inadmissible ici; car l'expression indique en
tout cas l'intérieur plutôt que l'extérieur de l'édifice : or s'il se trouve dans le dôme quelque
construction de Frédéric ïï, ce ne peut être que la décoration ogivale de la partie extérieure
de la coupole : encore ce travail semble-t-il être de la fin du douzième siècle. Je n'hésite donc
pas à conclure que la du diplôme est bien réellement le monument qui nous occupe.
Hâtons-nous d'ajouter que s'il nous fallait renoncer à cette précision de dates, qui plaît à si
bon droit à l'archéologue, en ce qu'elle multiplie pour l'appréciation des œuvres d'art les ter-
mes certains de comparaison, le raisonnement tout seul nous conduirait à un résultat analo-
gue. En effet, auprès de la châsse de Notre-Dame se conserve dans le Trésor la châsse de Char-
lemagne, et l'on ne peut guère douter que cette dernière ne soit celle^où Frédéric I" recueillit,
en 1166, les ossements du grand empereur, canonisé à sa demande par son antipape Pascal III.
Nous avons donc là un spécimen du style de la grande orfèvrerie à la fin du douzième siècle.
Nous en avons un autre dans la grande couronne de lumières suspendue sous la coupole, puis-
qu'on y lit encore les noms de Frédéric et de Béatrix. Eh bien, il suffit d'un simple coup d'œil
pour se convaincre que ia châsse de Notre-Dame est plus récente, et qu'elle ne l'est que d'un
demi-siècle environ : si la grâce de son ornementation annonce des progrès que le génie
lui-même n'obtient pas sans le concours du temps, la ferme simplicité des lignes générales,
jointe à l'ampleur des formes et à la splendeur des effets d'ensemble, indique que l'art ogival
ne fait que se dégager de l'art roman, et se trouve à une égale distance de la grave majesté
des églises romanes de Cologne et de la svelte élégance du chœur de sa cathédrale.
A cette observation j'en puis joindre une autre tirée d'un morceau d'architecture attribué
à Philippe de Souabe, qui fut prévôt du chapitre d'Aix avant d'être empereur. On sait que ce
prince bâtit un dortoir pour le chapitre, et il est tout à fait présumable que les quatre arcades
trilobées qui se voient encore à l'angle du cloître près de la porte de l'église, formaient l'entrée
de cet édifice intérieur. Cette conjecture est appuyée par la tradition locale; or il est impos-
sible à un œil un peu exercé de ne pas reconnaître de singuliers rapports de style et même de
composition entre ces arcades, leurs chapiteaux, leurs corniches, et les arcades, les chapiteaux,
les crêtes fleuronnées et les rubans estampés de la châsse. L'orfèvre de ce dernier monument
et l'architecte de l'autre devaient appartenir à la même génération, et s'être formés à ia même
école, si toutefois ce n'était pas le même homme. La châsse de Notre-Dame a donc le mérite
inappréciable de nous faire connaître l'orfèvrerie correspondante à l'architecture de nos plus
magnifiques cathédrales françaises, et peut servir à compléter la connaissance d'un art si
longtemps oublié par la prévention et méprisé par l'ignorance L
i Si ton travaiiiait en 1320 à ia châsse de Notre-Dame, ainsi en 1237, et qu'ciic renfermait déjà ics grandes reliques iors-
que nous ie pensons, H est probabie qu'ciic était terminée qu'eut iieu l'incendie dont parie ie moine Aibéric : « Aquis-