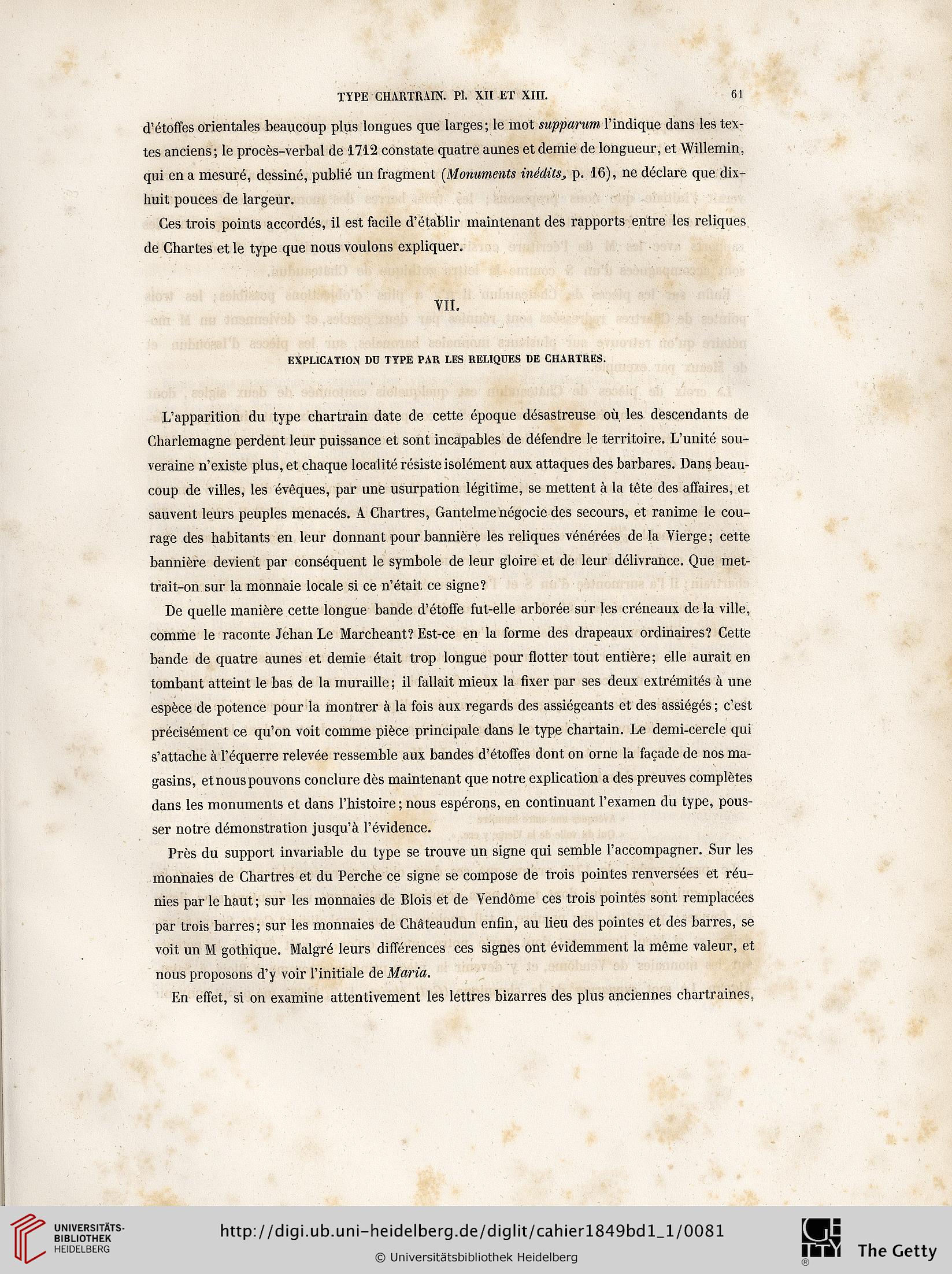TYPE CHARTRAIN. PL XII ET XIII.
61
d'étoffes orientales beaucoup plus longues que larges; le mot l'indique dans les tex-
tes anciens; le procès-verbal de 1712 constate quatre aunes et demie de longueur, et Willemin,
qui en a mesuré, dessiné, publié un fragment p. 16), ne déclare que dix-
huit pouces de largeur.
Ces trois points accordés, il est facile d'établir maintenant des rapports entre les reliques
de Chartes et le type que nous voulons expliquer.
VII.
EXPLICATION DU TYPE PAR LES RELIQUES DE CHARTRES.
L'apparition du type chartrain date de cette époque désastreuse où les descendants de
Charlemagne perdent leur puissance et sont incapables de défendre le territoire. L'unité sou-
veraine n'existe plus, et chaque localité résiste isolément aux attaques des barbares. Dans beau-
coup de villes, les évêques, par une usurpation légitime, se mettent à la tête des affaires, et
sauvent leurs peuples menacés. A Chartres, Cantelme négocie des secours, et ranime le cou-
rage des habitants en leur donnant pour bannière les reliques vénérées de la Vierge ; cette
bannière devient par conséquent le symbole de leur gloire et de leur délivrance. Que met-
trait-on sur la monnaie locale si ce n'était ce signe?
De quelle manière cette longue bande d'étoffe fut-elle arborée sur les créneaux de la ville,
comme le raconte Jehan Le Marcheant? Est-ce en la forme des drapeaux ordinaires? Cette
bande de quatre aunes et demie était trop longue pour flotter tout entière; elle aurait en
tombant atteint le bas de la muraille ; il fallait mieux la fixer par ses deux extrémités à une
espèce de potence pour la montrer à la fois aux regards des assiégeants et des assiégés ; c'est
précisément ce qu'on voit comme pièce principale dans le type chartain. Le demi-cercle qui
s'attache à l'équerre relevée ressemble aux bandes d'étoffes dont on orne la façade de nos ma-
gasins, et nous pouvons conclure dès maintenant que notre explication a des preuves complètes
dans les monuments et dans l'histoire ; nous espérons, en continuant l'examen du type, pous-
ser notre démonstration jusqu'à l'évidence.
Près du support invariable du type se trouve un signe qui semble l'accompagner. Sur les
monnaies de Chartres et du Perche ce signe se compose de trois pointes renversées et réu-
nies par le haut ; sur les monnaies de Blois et de Vendôme ces trois pointes sont remplacées
par trois barres; sur les monnaies de Châteaudun enfin, au lieu des pointes et des barres, se
voit un M gothique. Malgré leurs différences ces signes ont évidemment la même valeur, et
nous proposons d'y voir l'initiale de
En effet, si on examine attentivement les lettres bizarres des plus anciennes chartraines,
61
d'étoffes orientales beaucoup plus longues que larges; le mot l'indique dans les tex-
tes anciens; le procès-verbal de 1712 constate quatre aunes et demie de longueur, et Willemin,
qui en a mesuré, dessiné, publié un fragment p. 16), ne déclare que dix-
huit pouces de largeur.
Ces trois points accordés, il est facile d'établir maintenant des rapports entre les reliques
de Chartes et le type que nous voulons expliquer.
VII.
EXPLICATION DU TYPE PAR LES RELIQUES DE CHARTRES.
L'apparition du type chartrain date de cette époque désastreuse où les descendants de
Charlemagne perdent leur puissance et sont incapables de défendre le territoire. L'unité sou-
veraine n'existe plus, et chaque localité résiste isolément aux attaques des barbares. Dans beau-
coup de villes, les évêques, par une usurpation légitime, se mettent à la tête des affaires, et
sauvent leurs peuples menacés. A Chartres, Cantelme négocie des secours, et ranime le cou-
rage des habitants en leur donnant pour bannière les reliques vénérées de la Vierge ; cette
bannière devient par conséquent le symbole de leur gloire et de leur délivrance. Que met-
trait-on sur la monnaie locale si ce n'était ce signe?
De quelle manière cette longue bande d'étoffe fut-elle arborée sur les créneaux de la ville,
comme le raconte Jehan Le Marcheant? Est-ce en la forme des drapeaux ordinaires? Cette
bande de quatre aunes et demie était trop longue pour flotter tout entière; elle aurait en
tombant atteint le bas de la muraille ; il fallait mieux la fixer par ses deux extrémités à une
espèce de potence pour la montrer à la fois aux regards des assiégeants et des assiégés ; c'est
précisément ce qu'on voit comme pièce principale dans le type chartain. Le demi-cercle qui
s'attache à l'équerre relevée ressemble aux bandes d'étoffes dont on orne la façade de nos ma-
gasins, et nous pouvons conclure dès maintenant que notre explication a des preuves complètes
dans les monuments et dans l'histoire ; nous espérons, en continuant l'examen du type, pous-
ser notre démonstration jusqu'à l'évidence.
Près du support invariable du type se trouve un signe qui semble l'accompagner. Sur les
monnaies de Chartres et du Perche ce signe se compose de trois pointes renversées et réu-
nies par le haut ; sur les monnaies de Blois et de Vendôme ces trois pointes sont remplacées
par trois barres; sur les monnaies de Châteaudun enfin, au lieu des pointes et des barres, se
voit un M gothique. Malgré leurs différences ces signes ont évidemment la même valeur, et
nous proposons d'y voir l'initiale de
En effet, si on examine attentivement les lettres bizarres des plus anciennes chartraines,